|
|
|
|
 |
|
Une nouvelle maladie génétique liée au chromosome X explique les troubles de l’immunité face aux mycobactéries |
|
|
| |
|
| |
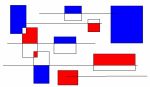
Une nouvelle maladie génétique liée au chromosome X explique les troubles de l’immunité face aux mycobactéries
06 Nov 2023 | Par Inserm (Salle de presse) | Génétique, génomique et bio-informatique
L’équipe de recherche « Génétique Humaine des Maladies Infectieuses » de l’Université Paris Cité, de l’Inserm et de l’AP-HP, dirigée par le Pr Jean-Laurent Casanova et le Dr Laurent Abel, au sein de l’Institut Imagine, a identifié des variants rares du gène MCTS1 responsable d’une susceptibilité aux maladies mycobactériennes, comme la tuberculose. Ces travaux, publiés le 23 octobre dans la revue Cell, qui décrivent une nouvelle maladie génétique, confirment que l’interféron-gamma (IFN-g) – une protéine activant la réponse immunitaire – est le principal acteur de la réaction immunitaire dans ce type d’infection et que la protéine JAK2 est également nécessaire pour déclencher la réponse immunitaire en cas d’infection par une mycobactérie.
La tuberculose, causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis, est une maladie infectieuse mortelle qui a fait au moins un milliard de morts au cours des 2,000 dernières années et fait encore 1,5 millions de morts chaque année dans le monde. Pour 90% des personnes infectées, l’infection par M. tuberculosis est silencieuse ou bénigne. Dans de très rares cas (1 personne sur 50,000 environ), une défaillance de la réponse immunitaire peut être révélée par une infection sévère voire fatale, suite à l’injection du vaccin contre la tuberculose (dit vaccin BCG ou Bacille de Calmette et Guérin), qui contient pourtant une forme atténuée de la bactérie.
Jonathan Bohlen, post-doctorant, sous la direction du Pr Jean-Laurent Casanova, du Dr Qian Zhang et du Dr Jacinta Bustamante, a travaillé à l’identification des facteurs génétiques d’un groupe de maladies génétiques rares, prédisposant aux infections à des mycobactéries (comme celle de la tuberculose), et au bacille vaccinal de Calmette et Guérin (BCG). Ce groupe de maladies, dit MSMD (pour « Mendelian Susceptibility to mycobacterial diseases » en anglais) est présent à une fréquence plus élevée chez les hommes que chez les femmes.
Pour lire la suite consulter le LIEN
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Quand les neurones s’inspirent des virus pour communiquer |
|
|
| |
|
| |
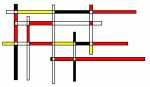
Quand les neurones s’inspirent des virus pour communiquer
13.03.2018, par Alexandra Gros (post-doctorante à l’université d’Edimbourg) et Antoine Besnard (post-doctorant au Massachusetts General Hospital de Boston)
Viendrait-on de découvrir un nouveau mode de communication entre neurones ? En janvier, des chercheurs ont montré qu’un gène impliqué dans l’apprentissage et la mémorisation était capable de former des capsides virales pour transmettre une information. Deux de ces scientifiques nous parlent de leur découverte dans le blog « Aux frontières du cerveau ».
? ?En janvier dernier, deux articles publiés dans la revue Cell créaient une onde de choc dans le monde des neurosciences en montrant qu’un gène particulièrement important dans les processus d’apprentissage et de mémorisation est capable de former des capsides* virales pour transmettre une information aux cellules voisines ! Serait-ce une nouvelle forme de communication entre neurones ? Les chercheurs Jason Shepherd (J. S.), neuroscientifique et spécialiste du gène Arc de l’université de l’Utah, et Cédric Feschotte (C. F.), généticien et spécialiste des transposons* de l’université de Cornell, nous racontent leur découverte.
Pour lire la suite consulter le LIEN
DOCUMENT cnrs LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Les fibres alimentaires améliorent le contrôle de la glycémie grâce à des cellules immunitaires |
|
|
| |
|
| |
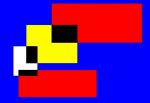
Les fibres alimentaires améliorent le contrôle de la glycémie grâce à des cellules immunitaires
11 Juil 2024 | Par Inserm (Salle de presse) | Physiopathologie, métabolisme, nutrition
© Photo de Jannis Brandt sur Unsplash
Le système immunitaire intestinal est un intermédiaire indispensable dans l’association complexe entre alimentation et métabolisme : sans lui, les fibres alimentaires présentes dans les fruits et les légumes ne peuvent participer correctement à la régulation de la glycémie dans l’organisme. Des chercheuses et des chercheurs de l’Inserm et de Sorbonne Université viennent de mettre en évidence qu’un certain type de cellules immunitaires serait indispensable à cet effet bénéfique des fibres alimentaires sur le métabolisme glucidique. Ces résultats sont publiés dans la revue Nature Communications.
Les bénéfices pour la santé des fibres alimentaires, présentes en particulier dans les fruits et les légumes, sont désormais bien documentés : celles-ci contribuent à la gestion du poids, aux équilibres glucidique et lipidique dans l’organisme et joueraient un rôle protecteur contre le cancer du côlon. Selon de précédents travaux, les fibres seraient aidées dans leur tâche par le système immunitaire intestinal. Ce dernier comprend en effet différentes populations de cellules immunitaires qui assurent notamment la tolérance alimentaire ou interviennent pour lutter contre les agents infectieux au niveau de la paroi intestinale. Toutefois, son rôle précis en lien avec les fibres alimentaires demeure encore mal compris.
Une équipe dirigée par le chercheur Inserm Emmanuel Gautier au sein de l’Unité de recherche sur les maladies cardiovasculaires et métaboliques (Inserm/Sorbonne Université) a voulu en savoir plus. Les scientifiques ont travaillé sur un modèle de souris nourri avec un régime riche en graisses et pauvre en fibres, mimant un régime alimentaire de type « occidental ». Durant quatre semaines, la moitié de ces animaux a reçu en addition une supplémentation en fibres de type fructo-oligosaccharides (FOS), vendues dans le commerce à des fins alimentaires.
Pour lire la suite consulter le LIEN
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Alzheimer : les espoirs de la piste sanguin |
|
|
| |
|
| |
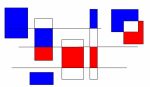
Alzheimer : les espoirs de la piste sanguine
26.10.2016, par Stéphanie Belaud
Temps de lecture : 7 minutes
Artériographie révélant la circulation sanguine dans le cerveau.
BSIP
En modélisant la circulation sanguine dans les vaisseaux les plus fins du cerveau, des chercheurs en mécanique des fluides tentent d’expliquer l’origine de la maladie d’Alzheimer. Avec, à la clé, un diagnostic plus précoce et peut-être des nouvelles pistes de traitement.
Avec 900 000 personnes atteintes aujourd’hui en France, la maladie d’Alzheimer est la plus fréquente des maladies neurodégénératives. Bien que, depuis plus de dix ans, plusieurs pistes aient été explorées1, aucun traitement n’existe à l’heure actuelle pour guérir la maladie ni même en ralentir l’évolution. Devant cette impasse, des voies de recherches alternatives et parfois inattendues émergent. Parmi elles : la mise en cause de dysfonctionnements précoces au niveau de la circulation sanguine du cerveau. Cette hypothèse soutenue par l’équipe du projet BrainMicroFlow
(link is external)
2 pointe précisément le rôle des capillaires qui irriguent le cerveau, un réseau d’environ mille milliards de vaisseaux sanguins, chacun dix fois plus fins que le diamètre d’un cheveu, et qui viendraient à s’obstruer par milliers dès le stade initial de la maladie.
Une origine vasculaire de la maladie ?
« Notre hypothèse a de quoi surprendre puisque, depuis longtemps, la maladie d’Alzheimer est classée parmi les maladies neurodégénératives sans origine vasculaire », commente Sylvie Lorthois, chercheuse à l’Institut de mécanique des fluides de Toulouse3 et porteuse du projet. Une hypothèse pourtant prise très au sérieux : le projet s’est vu attribuer en 2014 le prestigieux prix du Conseil européen de la recherche (ERC), qui récompense des travaux de recherche de pointe, originaux et porteurs d’idées en rupture. Avec à la clé 2 millions d’euros sur cinq ans, de quoi donner un véritable coup d’accélérateur aux travaux initiés depuis plusieurs années par la chercheuse.
Pour lire la suite, consulter le LIEN
DOCUMENT cnrs LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ] - Suivante |
|
|
|
|
|
|
