|
|
|
|
 |
|
La lumière du soleil : amie ou ennemie ? |
|
|
| |
|
| |
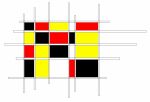
La lumière du soleil : amie ou ennemie ?
02 JUIL 2021 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) |
La France connaît des périodes de fortes chaleur ces dernières années, avec des canicules de plus en plus fréquentes entre juin et septembre. Cette période estivale est l’occasion pour l’Inserm de revenir sur les bienfaits mais aussi les dangers liés à la lumière du soleil.
Une exposition prolongée aux rayons UV favorise le développement du mélanome
L’exposition aux rayons ultraviolets du soleil est la principale cause de cancer de la peau, connu aussi sous le nom de mélanome. A chaque exposition, l’action des rayons altère les cellules de la peau. Les cellules disposent de mécanismes d’adaptation qui leur permettent de réparer les dommages qu’elles subissent, mais ils ne sont pas inépuisables : en cas d’expositions brutales et répétées, la peau ne parvient plus à se défendre contre les dégâts causés et des cellules cancéreuses peuvent se développer.
Lorsque le mélanome n’est pas traité à temps, il forme des métastases qui se disséminent dans les tissus et font diminuer les chances de survie.
En 2010, des chercheurs de l’Inserm dirigés par Alain Mauviel à l’Institut Curie ont identifié une protéine appelée GLI-2, qui interagit avec l’ADN et l’ARN pour favoriser le développement de métastases. Comprendre le rôle de cette protéine ouvre des pistes pour élaborer des stratégies thérapeutiques plus efficaces pour freiner l’évolution du mélanome.
En 2014, des chercheurs du laboratoire « Biomarqueurs prédictifs et nouvelles stratégies moléculaires » ont révélé qu’un complexe protéique appelé Eif4f était impliqué dans la résistance des métastases aux traitements. Cette découverte permet de mieux comprendre pourquoi ces traitements deviennent inefficaces et ouvre sur de nouvelles stratégies pour freiner le développement de ces tumeurs agressives.
En 2016, des chercheurs de l’Inserm en collaboration avec le service de dermatologie du CHU de Nice, ont révélé qu’une nouvelle famille de molécules, les Thiazole Benzensulfonamides (TZB), présentaient des propriétés anti-cancéreuses. En modifiant leur structure en laboratoire, les chercheurs sont parvenus à obtenir une molécule appelée HA15 qui induit la mort des cellules cancéreuses sans agresser les cellules normales. L’objectif à la fin des essais cliniques est d’utiliser ces molécules dans le traitement du mélanome mais aussi pour d’autres formes de cancers.
Ces avancées prometteuses ne garantissent cependant pas à ce jour une protection contre le cancer de la peau. Il est donc nécessaire de se protéger avant toute exposition au soleil.
Lire le communiqué du 09/08/2010 Cancer de la peau : une molécule impliquée dans le développement des métastases
Lire le communiqué du 28/07/2014 Des nouveaux mécanismes de résistance aux thérapies ciblées du mélanome : implication de la traduction des ARN en protéines
Regarder la vidéo de l’Inserm « Une nouvelle molécule contre le cancer de la peau »
La lumière influence nos fonctions cognitives et physiologiques
Pour fonctionner correctement, notre horloge biologique se base sur des signaux qu’elle reçoit de l’extérieur et qu’elle interprète comme des indicateurs temporels pour se synchroniser sur 24h. La lumière, en particulier la lumière naturelle, constitue un stimulant puissant pour l’éveil et la cognition. Elle permet notamment de lutter contre la somnolence ou le « blues hivernal ».
En 2014, des chercheurs de l’Inserm et du Centre de Recherche du Cyclotron de l’Université de Liège ont révélé que nous possédions une sorte de « mémoire de la lumière » (ou mémoire photique). Ils ont observé que notre cerveau pouvait mieux réaliser une tâche cognitive lorsque nous avons été exposés à la lumière quelques heures auparavant. Ce processus est possible grâce à la mélanopsine, un photorécepteur de l’œil sensible à la lumière qui transmet l’information lumineuse vers de nombreux centres du cerveau dits « non-visuels ». Sans ce photorécepteur, les fonctions non-visuelles sont perturbées, l’horloge biologique est déréglée et l’effet stimulant de la lumière est amoindri.
Au-delà des bénéfices cognitifs, sortir régulièrement dehors quand il fait beau au printemps et en été (sans toutefois s’exposer de façon prolongée) permet de garantir un apport suffisant en vitamine D, laquelle n’est pas synthétisée par notre corps et ne se retrouve que de façon très limitée dans les aliments.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
20 % des réactions aux produits de contraste en radiologie sont de réelles allergies |
|
|
| |
|
| |
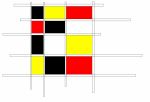
20 % des réactions aux produits de contraste en radiologie sont de réelles allergies
COMMUNIQUÉ | 27 SEPT. 2018 - 17H51 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION, INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE | PHYSIOPATHOLOGIE, MÉTABOLISME, NUTRITION | TECHNOLOGIE POUR LA SANTE
Une équipe du Pôle Imagerie-Explorations-Recherche de l’hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP, de l’université Paris Descartes et de l’Inserm pilotée par le Pr Olivier Clément, et une équipe du CHU et de l’université de Caen Normandie, dirigée par le Dr Dominique Laroche, ont mené la première étude multicentrique prospective nationale sur les réactions allergiques aux produits de contraste en radiologie. 31 centres en France réunissant des investigateurs radiologues, allergologues, anesthésistes et biologistes ont permis d’étudier 245 cas d’hypersensibilité aux produits de contraste. Promue par l’AP-HP, cette étude, financée par le programme hospitalier de recherche clinique régional de 2003, montre que l’allergie est responsable de plus de 20% des réactions d’hypersensibilité aux produits de contraste et recommande que les patients diagnostiqués allergiques, ayant un grand risque de récidive, fassent l’objet d’un suivi s’appuyant sur des tests cutanés réalisés chez un allergologue spécialisé en allergologie médicamenteuse. Ces travaux ont été publiés dans la revue EClinicalMedicine du Lancet dans son numéro de juillet 2018.
En radiologie, les patients peuvent manifester des réactions d’hypersensibilité immédiate aux produits de contraste iodés (pour les scanners) et gadolinés (pour les IRM) qu’on leur injecte lors de l’examen. Les réactions sont de type urticaire, angioedème, bronchospasme, hypotension ou choc anaphylactique. Les réactions sévères, rares, surviennent quelques minutes après l’injection et nécessitent de la part des équipes d’imagerie un diagnostic et une prise en charge rapides.
Pour les produits de contraste iodés, les réactions ont été longtemps faussement étiquetées « allergie à l’iode » et confondues avec les réactions aux produits de la mer ou aux désinfectants cutanés.
Mais la réelle allergie à un produit de contraste est diagnostiquée par une élévation des marqueurs plasmatiques de tryptase et d’histamine durant la première heure suivant la réaction et par des tests cutanés intradermiques à réaliser entre six semaines et six mois après celle-ci. Les quelques études rétrospectives menées a posteriori sur la performance de ce type de test cutané ont montré qu’entre 13 et 65% des réactions étaient réellement d’origine allergique, selon les populations testées. Néanmoins ces études péchaient par un manque de données cliniques, en particulier le nom du produit injecté, ou par des tests incomplets ou pratiqués tardivement, ou elles mélangeaient les réactions immédiates et les réactions retardées.
Une équipe du Pôle imagerie-explorations-recherche de l’hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP, de l’université Paris Descartes et de l’Inserm, pilotée par le Pr Olivier Clément, et une équipe du CHU et de l’université de Caen Normandie, dirigée par le Dr Dominique Laroche, ont étudié de manière prospective les réactions d’hypersensibilité immédiate aux produits iodés et gadolinés. Cette étude multicentrique a été menée dans 31 centres français équipés pour réaliser les tests cutanés six semaines à six mois après une réaction.
Après avoir reçu un produit de contraste pour un examen de radiologie, 245 patients présentant une réaction immédiate ont eu un prélèvement sanguin dans la première heure suivant celle-ci afin de mesurer le taux d’histamine et de tryptase dans leur plasma. Ils se sont vus proposer, six semaines après, un rendez-vous chez l’allergologue afin de tester tous les produits de contraste existants (10 iodés ou 5 gadolinés).
Les tests cutanés ont révélé trois types de réactions : allergiques (si test positif au produit de contraste dilué); potentiellement allergiques (si test positif uniquement au produit pur) et non allergiques. Ils ont permis d’identifier 41 patients allergiques aux produits iodés et 10 patients allergiques aux produits gadolinés.
Les résultats obtenus ont montré que plus la réaction était sévère, plus le mécanisme allergique révélé par le test cutané était fréquent : 9,5% dans les réactions cutanées ; 22,9% dans les réactions modérées ; 52,9% dans les réactions mettant en jeu le pronostic vital et 100% quand il y avait arrêt cardiaque.
De la même façon, les taux d’histamine et de tryptase plasmatique augmentaient en fonction de la sévérité de la réaction. La présence de signes cardiovasculaires était également très fortement liée à un mécanisme allergique.
Le groupe de patients potentiellement allergiques présentait des symptômes cliniques et des dosages d’histamine et de tryptase intermédiaires entre le groupe des patients allergiques et ceux non allergiques. Ce qui suggère qu’une partie d’entre eux sont véritablement allergiques au produit de contraste.
Les équipes ont également étudié les réactions croisées avec d’autres produits de contraste différents de celui responsable de la réaction : 62,7% des patients allergiques avaient une réaction croisée à un ou plusieurs produits testés purs.
Cette étude montre ainsi que 21% des réactions d’hypersensibilité en radiologie sont véritablement dus à une allergie aux produits de contraste.
Les patients allergiques présentent un grand risque de récidive si on leur réinjecte un produit de contraste donnant un test cutané positif.
Les patients ayant manifesté des symptômes sévères (choc anaphylactique ou signes cardiovasculaires) devraient bénéficier d’un dosage d’histamine et de tryptase au décours de la réanimation et de tests allergologiques dans les six mois qui suivent, afin de déterminer l’origine allergique ou non de leur réaction, et surtout de savoir quels produits seront contre indiqués ou autorisés pour les injections futures.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
L'ADN : DÉCHIFFRER POUR MIEUX COMPRENDRE LE VIVANT |
|
|
| |
|
| |

L'ADN : DÉCHIFFRER POUR MIEUX COMPRENDRE LE VIVANT
L'émergence d'outils et de disciplines
© CEA
La connaissance de l'ADN et de son fonctionnement a fortement progressé ces dernières années grâce aux progrès technologiques.
Publié le 25 janvier 2018
L'évolution des technologies a été fulgurante. Dans les années 1990, il a fallu 13 ans pour séquencer les 3,3 milliards de bases du génome humain alors qu'aujourd'hui, une vingtaine de séquenceurs utilisés en simultané permettent de le faire en 15 minutes. Rapidité, faible coût et surtout faible quantité d'ADN requise ouvrent le champ à de nouvelles applications, notamment dans l'épigénétique et le diagnostic médical.
LE SÉQUENÇAGE
Des révolutions technologiques
En 40 ans, le séquençage a connu de vraies révolutions technologiques grâce aux avancées en physique, chimie et aux nanotechnologies. L'activité, coûteuse à ses débuts, a développé une organisation de type industriel et optimise les rendements grâce à des séquenceurs automatiques. Les dépôts d'échantillons se faisaient à la main sur les premiers séquenceurs à gel. Aujourd'hui, un séquenceur (destiné à analyser des génomes autres qu'humains) est intégré dans une clef USB et s'acquiert pour moins de 1 000 euros. La première technique largement utilisée dès 1977 a été la méthode Sanger, du nom du double prix Nobel de chimie qui l'a mise au point. À partir de 2005, apparaissent de nouvelles technologies de séquençage dites de 2e génération, tel que le pyroséquençage. Des millions de molécules, toutes issues du même échantillon, sont traitées en même temps ; c'est l'heure du séquençage haut débit ! Bien qu'elles aient toutes des spécificités très différentes, trois phases les caractérisent. La première, la préparation d'une collection d'ADN d'intérêt. La deuxième : l'amplification de l'ensemble des fragments afin de générer un signal suffisant pour que le séquenceur le détecte. Et enfin la phase de séquençage elle-même : pendant la synthèse du brin complémentaire, un signal est généré à chaque fois qu'un nouveau nucléotide est incorporé. Inconvénient : les séquences sont plus courtes et le taux d'erreur plus élevé que précédemment ; ce problème est aujourd'hui résolu sur les séquenceurs de dernière génération.
Les années 2010 voient se développer de nouvelles plateformes, dites de 3e génération. Ces appareils sont si sensibles qu’ils sont capables de séquencer une seule molécule d’ADN en quelques dizaines de minutes ! La dernière innovation présente un avantage majeur : pas besoin de répliquer l'ADN ni d'utiliser de fluorochromes, substance chimique capable d'émettre de la lumière par fluorescence. Sous la forme d’une puce dotée de nanopores (des canaux qui traversent une membrane), la machine capte directement les signaux électriques de chaque base d'ADN qui traverse le canal et permet de séquencer en un temps record. Cette méthode est pour l’instant réservée à de petits génomes, pas au génome humain.
Reportage
L'Institut de génomique
* Pipetage robotisé de puces à ADN
* Etapes automatisées de pipetage des robots sur la plateforme Illumina. Toutes les étapes de séquençage sont suivies grâce à des codes barres, scanners et logiciels.
Crédits photo : F.Rhodes/CEA / Date : 8 janvier 2008 / Lieu : Centre national de génotypage (CNG) Evry
La course aux génomes
La quête des gènes débute dans les années 1970. Lire la séquence de l’ADN devient indispensable pour les étudier, comprendre leur fonction et déceler les mutations responsables de maladies. Objectif ultime : déchiffrer les quelques 3,3 milliards de bases (3 300 Mb) du génome humain. Le projet est aussi ambitieux et presque aussi fou que celui d’envoyer un homme sur la Lune ! Les chercheurs commencent par de petits génomes. En 1995, le premier séquencé et publié est celui d’Haemophilus influenzae (1,8 Mb), une bactérie responsable de la méningite chez l’enfant. Suivra en 1996 celui d’un génome eucaryote unicellulaire, la levure Saccharomyces cerevisiae (12,5 Mb). Puis ce sera le tour du ver Caenorhabditis elegans (97 Mb) en 1998.
En 30 ans, les séquenceurs ont vu leur capacité augmenter d'un facteur 100 millions !
Quant au projet "Human genome", il démarre officiellement en 1989, pour une durée prévue de 15 ans et un budget global estimé à 3 milliards de dollars. Plus de 20 laboratoires de 7 pays différents sont impliqués. Les deux plus importants sont le Sanger Center (Grande-Bretagne) et le Whitehead Institute (États-Unis). En 1997, la France s'équipe d'une plateforme nationale, le Genoscope, et prend en charge le chromosome 14. La version complète de la séquence du génome humain sera publiée en avril 2003, avec plusieurs années d'avance (les chercheurs la complètent encore aujourd'hui). La course aux génomes continue : en août 2016, la base de données génomique internationale, en libre accès sur le site Gold (Genome On Line Database), faisait état de 13 647 organismes séquencés et publiés.
LA GÉNOMIQUE FONCTIONNELLE
La quête des gènes ressemble souvent à une pêche miraculeuse ! Une fois détectés et annotés, leur fonction reste à vérifier et les conditions de leur expression à découvrir. C'est là que la génomique structurelle atteint ses limites et que la génomique fonctionnelle prend le relais.
Cette dernière dresse un inventaire qualitatif et quantitatif sur deux niveaux : le transcriptome et le protéome. Le premier désigne l’ensemble des transcrits (ARNm) et le deuxième l’ensemble des protéines fabriquées. Alors que le génome est unique pour un organisme donné, il existe autant de transcriptomes et de protéomes que de stades de développement cellulaire ! Grâce aux nouvelles technologies de séquençage, l’étude de l’ensemble des transcrits permet non seulement de réaliser un catalogue des gènes exprimés mais aussi de quantifier l’expression des gènes et de déterminer la structure de chaque transcrit à un moment donné. Une deuxième technologie, les puces à ADN, permet aussi d’étudier le transcriptome par l’observation simultanée de l’expression de plusieurs milliers de gènes dans une cellule ou un tissu donné. L’analyse d’un transcriptome peut, par exemple, indiquer le stade de développement d’un cancer et permettre ainsi d’adapter au mieux le traitement du patient.
LE GÉNOTYPAGE : Le génotypage cherche les différences dans la séquence des génomes d'individus d'une même espèce. Ces différences constituent des " marqueurs génétiques ". Pour les trouver, le génotypage fait appel à trois technologies différentes ; le séquençage, les puces à ADN et la spectrométrie de masse. Les marqueurs potentiellement intéressants sont ceux qui se transmettent au sein d'une famille de la même manière et en même temps que le gène impliqué dans une maladie. Les études génétiques à haut débit consistent à analyser des centaines de milliers de ces marqueurs sur des milliers d'individus afin d'identifier et localiser les gènes prédisposant à des pathologies
LA MÉTAGÉNOMIQUE
Les technologies de séquençage permettent aujourd’hui d’appréhender le génome de tous les organismes d’un même écosystème en même temps ; la génomique fait place à la métagénomique.
Le projet international "MetaHIT ”, auquel participe le CEA, a pour objectif d’étudier le génome de l'ensemble des bactéries constituant la flore intestinale humaine. Lourde tâche : le métagénome contient 100 fois plus de gènes que le génome humain et 85 % des bactéries sont encore inconnues. Premier résultat obtenu en mars 2010 : le séquençage de l’ensemble des gènes révèle que chaque individu abrite au moins 170 espèces différentes de bactéries intestinales.
En avril 2011, les chercheurs font une découverte assez inattendue. Ce ne sont pas les 3 signatures bactériennes intestinales identifiées qui sont corrélées à l'origine géographique, à l’âge ou à la masse corporelle des individus mais bien quelques poignées… de gènes bactériens ! La preuve de concept est faite : ces derniers pourront être utilisés comme biomarqueurs pour aider au diagnostic des patients touchés par des maladies comme l’obésité ou la maladie de Crohn. En 2014, une nouvelle approche permet de reconstituer le génome de 238 espèces complètement inconnues. Les chercheurs ont également trouvé plus de 800 relations de dépendance qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement global de cet écosystème intestinal.
L'ÉPIGÉNÉTIQUE
Peut-on tout expliquer par la génétique ? Dès 1942, Conrad Waddington souligne l'incapacité de cette discipline à expliquer le développement embryonnaire. Comment, en effet, expliquer la différence entre une cellule du foie et un neurone alors que toutes renferment le même programme ? Ce généticien désigne l'épigénétique comme le lien entre les caractères observables (phénotypes) et l'ensemble des gènes (génotypes).
Comparons l'organisme à une voiture ; la génétique serait l'établi sur lequel sont exposées toutes les pièces mécaniques et l'épigénétique la chaîne d'assemblage des différents éléments. Ainsi, l'épigénétique jouerait les chefs d'orchestre en indiquant pour chaque gène à quel moment et dans quel tissu il doit s'exprimer. Suite à la découverte des premiers mécanismes épigénétiques qui régulent l'expression des gènes, les chercheurs ont appris à « museler » un gène à des fins thérapeutiques.
Première méthode : par modification des protéines sur lesquelles s'enroule l'ADN. Le gène se compacte et devient alors inaccessible à la transcription ; il ne s'exprime plus. Seconde méthode : inactiver directement son ARNm avec des ARN interférence qui bloquent sa traduction. Depuis les années 1990, de nouvelles molécules associées à la régulation épigénétique sont découvertes. L'ensemble de ces molécules, le plus souvent trouvées dans l'ADN non-codant, forme l'épigénome. Complémentaire de la génétique, l'épigénétique donne une vue plus complète de la machinerie cellulaire et révèle une surprenante complexité dans les régulations de l'expression génique. Elle ouvre des perspectives dans la compréhension et le traitement de nombreuses maladies.
CNRGH et GENOSCOPE - Au sein de l'Institut de biologie François Jacob, ces deux services développent des stratégies et thématiques scientifiques distinctes, sur un socle de ressources technologiques communes. Le Centre national de recherche en génomique humaine (CNRGH) est axé sur la génomique humaine et la recherche translationnelle. Les recherches du Genoscope (aussi appelé Centre national de séquençage) portent sur l'exploration et l'exploitation de la biodiversité génomique et biochimique.
LE PROJET TARA
L'expédition « Tara Oceans » a débuté en septembre 2009. Pour explorer la diversité et évaluer la concentration du plancton, 40 000 prélèvements ont été réalisés. Leur analyse permet d'étudier l'effet du réchauffement climatique sur les systèmes planctoniques et coralliens, ses conséquences sur la vie marine et donc la chaîne alimentaire. Elle aidera à mieux comprendre l'origine de la vie sur Terre. Enfin, le plancton représente une ressource de biomolécules potentiellement intéressante pour la chimie verte, l'énergie ou encore la pharmacie. Le Genoscope est chargé de l'analyse génétique des 2 000 échantillons « protistes » et « virus » ! En mai 2016, la goélette est repartie pour l'expédition « Tara Pacific ».
Objectif : Mieux comprendre la biodiversité des récifs coralliens, leur capacité de résistance, d'adaptation et de résilience face aux changements climatiques et à la pollution et dégradations dues à l'Homme. À bord et à terre, les chercheurs continuent leur travail de séquençage pour établir une base de données de tous les échantillons prélevés.
DOCUMENT cea LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
https://www.univ-nantes.fr/decouvrir-luniversite/espace-presse/therapie-genique-un-gene-medicament-prometteur-ouvre-la-voie-au-traitement-de-la-myopat |
|
|
| |
|
| |
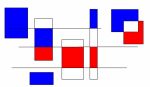
Thérapie génique : un "gène-médicament" prometteur ouvre la voie au traitement de la myopathie de Duchenne
*
Le 12 novembre 2014
Une collaboration impliquant trois laboratoires soutenus par l’AFM-Téléthon, Atlantic Gene Therapies (AFM-Téléthon, Inserm UMR 1089, Université de Nantes, CHU de Nantes), Généthon et l’Institut de Myologie, a permis de démontrer l’efficacité d’un traitement innovant de thérapie génique chez chien atteint de la myopathie de Duchenne. Impliquant notamment des chercheurs du Laboratoire de thérapie génique (Université de Nantes/Inserm) ces travaux ouvrent la voie à la mise en place d’un essai clinique.
La dystrophie musculaire de Duchenne est la maladie neuromusculaire la plus fréquente chez l'enfant (1 garçon atteint sur 3 500 à 5 000 naissances) due à une anomalie génétique dans un gène entraînant l'absence d'une protéine indispensable au bon fonctionnement des muscles : la dystrophine. Des chercheurs nantais ont eu l'idée de développer un traitement basé sur l'utilisation d'un vecteur (Adeno Associated Virus) portant un transgène et permettant la production de dystrophine dans le muscle du malade.
* Sécurité, efficacité et stabilité du traitement chez le chien
Le "gène-médicament" développé a été administré dans les pattes antérieures de 18 chiens. "Le traitement a bien été toléré par les chiens. Les tests ont montré que la dégénérescence musculaire était stoppée dans la patte traitée" explique Caroline Le Guiner, responsable du projet de recherche au sein du laboratoire de thérapie génique translationnelle des maladies neuromusculaires et de la rétine (UMR 1089). Les résultats ont également indiqués que le traitement produit dans le tissu musculaire un effet prolongé et stable dans le temps d'observation de l'étude et ne nécessite pas d'être ré-administré régulièrement.
"La synthèse de "nouvelle" dystrophine est dépendante de la dose de vecteur injectée : plus la dose est forte et plus le saut d'exon est efficace. La force musculaire augmente également avec la dose injectée. 80 % des fibres musculaires expriment la "nouvelle" dystrophine avec la dose la plus élevée", souligne Caroline Le Guiner. "Un résultat extrêmement encourageant car une expression minimum de 40 % de la dystrophine dans les fibres musculaires est nécessaire pour que la force soit réellement améliorée."
* Vers un essai clinique
Ces résultats ouvrent la voie à la mise en place d'un essai clinique qui visera à traiter, par voie locorégionale, le membre supérieur de personnes atteintes de dystrophie musculaire de Duchenne et dont la dystrophine peut être corrigée. Les études de toxicologie et biodistribution réglementaires viennent de s'achever et le dépôt d'un dossier auprès des autorités réglementaires est prévu pour 2015. Ces travaux, financés en majeure partie par les dons du Téléthon, ont également bénéficié de financements dans le cadre du programme ADNA (Advanced Diagnostics for New Therapeutic Approaches), un programme dédié au développement de la médecine personnalisée et soutenu par la Banque Publique d'Investissement.
DOCUMENT univ-nantes.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
