|
|
|
|
 |
|
ÉPIGÉNÉTIQUE |
|
|
| |
|
| |
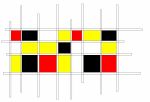
Épigénétique
L'épigénétique (mot-valise de épigenèse et génétique2) est la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible (lors des divisions cellulaires) et adaptative l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléotidique (ADN)3. Alors que la génétique correspond à l’étude des gènes, l’épigénétique s’intéresse à une “couche” d’informations complémentaires qui définit comment ces gènes sont susceptibles d'être utilisés par une cellule.
Dans l'histoire de ce sujet d'étude, l'épigénétique est d'abord mise en évidence par la différenciation cellulaire puisque toutes les cellules d'un organisme multicellulaire ont le même patrimoine génétique, mais l'expriment de façon très différente selon le tissu auquel elles appartiennent. Puis ce sont les possibilités d'évolution d'un même œuf en mâle ou femelle chez les tortues, en reine ou ouvrière chez les abeilles, qui prouvent que des mécanismes peuvent lier des facteurs environnementaux et l'expression du patrimoine génétique.
En matière d'évolution, l'épigénétique permet d'expliquer comment des traits peuvent être acquis, éventuellement transmis d'une génération à l'autre ou encore perdus après avoir été hérités4. La mise en lumière récente de ces moyens épigénétiques d'adaptation d'une espèce à son environnement est, selon Joël de Rosnay en 2011, « la grande révolution de la biologie de ces cinq dernières années »5 car elle montre que dans certains cas, notre comportement agit sur l'expression de nos gènes6. Elle explique aussi le polyphénisme, par exemple les changements de couleur en fonction des saisons (tel le renard polaire qui devient blanc en hiver).
L'épigénétique a des applications possibles en médecine7, avec des perspectives thérapeutiques nouvelles notamment à l'aide d'« épi-médicaments »8, mais aussi en biologie du développement, agronomie ou nutrition.
Un même œuf fécondé d'abeille donnera soit une ouvrière s'il est pondu dans une cellule normale (hexagonale, au fond de l'image) où la larve est nourrie successivement à la gelée royale et à la bouille larvaire, soit une reine s'il est pondu dans une cellule royale (au premier plan) où elle est nourrie exclusivement à la gelée royale. C'est une sélection épigénétique de l'expression d'un même génome.
« Alors que la génétique correspond à l’étude des gènes, l’épigénétique s’intéresse à une “couche” d’informations complémentaires qui définit comment ces gènes vont être utilisés par une cellule ou… ne pas l’être8. »
« L'épigénétique est l'étude des changements d'activité des gènes — donc des changements de caractères — qui sont transmis au fil des divisions cellulaires ou des générations, sans faire appel à des mutations de l'ADN9. »
Par exemple, une même larve d'abeille deviendra une reine ou une ouvrière en fonction de la façon dont elle est nourrie10, et un même œuf de tortue peut éclore en mâle ou femelle en fonction de la température11. Il s'agit bien de l’expression du même code génétique global, mais des facteurs environnementaux ont sélectionné une expression plutôt qu'une autre, chacune étant disponible dans la « base de données » génétique.
Autrement dit, l'épigénétique concerne l'ensemble des mécanismes qui gouvernent la façon dont le génotype est utilisé pour créer un phénotype.
Principe
Par analogie, on peut rapprocher le couple génétique - épigénétique à l'écriture et à la lecture d'un livre.
« On peut sans doute comparer la distinction entre la génétique et l'épigénétique à la différence entre l'écriture d'un livre et sa lecture. Une fois que le livre est écrit, le texte (les gènes ou l'information stockée sous forme d'ADN) sera le même dans tous les exemplaires distribués au public. Cependant, chaque lecteur d'un livre donné aura une interprétation légèrement différente de l'histoire, qui suscitera en lui des émotions et des projections personnelles au fil des chapitres. D'une manière très comparable, l'épigénétique permettrait plusieurs lectures d'une matrice fixe (le livre ou le code génétique), donnant lieu à diverses interprétations, selon les conditions dans lesquelles on interroge cette matrice12. »
S'il existe une « base de données génétique », sa lecture s'effectue de façon éminemment diverse en fonction des modifications épigénétiques qui sont apportées au génome et à la chromatine. La transmission de l'héritage génétique s'accompagne également de celle d'un héritage épigénétique.
Mise en évidence
Article détaillé : différenciation cellulaire.
Sauf cas exceptionnel de mutation spontanée ou lors du développement des lymphocytes T, les cellules issues d'une seule cellule œuf et dupliquées par mitose partagent exactement le même patrimoine génétique. Pourtant un neurone, un globule blanc, ou encore une cellule épithéliale sont très différentes les unes des autres. « Cadre classique de l'épigénétique »9, cette différenciation cellulaire sur la base d'un même code génétique est un objet d'étude de la biologie du développement.
L'existence de phénomènes épigénétiques se trouve également illustrée par les différences physiques et biologiques constatées chez des animaux de laboratoire clonés13, ou chez les clones naturels que sont les vrais jumeaux (monozygotes) chez qui les empreintes épigénétiques sont beaucoup plus semblables à 3 ans qu'à 50 ans14. Une vaste étude est toujours en cours pour caractériser les différences entre jumeaux monozygotes15.
Si ces mises en évidence concernent principalement des êtres pluricellulaires Eucaryotes, des phénomènes épigénétiques ont aussi été mis en évidence chez des êtres unicellulaires aussi bien eucaryotes (par exemple la levure)16 que procaryotes17.
Histoire
En 1999, on met en évidence chez la linaire commune qu'une symétrie de ses fleurs (ci-dessus) se transmet sur plusieurs générations tout en restant réversible18. Il est question d'épimutation et non pas de mutation de l’ADN, rare et définitive.
Article connexe : Histoire de la pensée évolutionniste.
L'histoire de l'épigénétique peut se rapporter aux théories qui se demandent si la totalité des caractéristiques d'un individu est contenue dans l'œuf dont il est issu, aux théories de l'influence du contexte sur la génétique, ou encore à la mise en évidence moléculaire de ces mécanismes et de la réversibilité sur quelques générations d'un caractère, en particulier s'il est créé par l'environnement.
Par ailleurs, le terme ou des formes dérivées, telle que « épigénisation »N 1, sont également utilisés dans d'autres disciplines, par exemple la géologie.
Épigenèse
Le mot épigenèse remonte à Aristote qui nommait ainsi le développement d'un œuf informe de façon graduelle aboutissant à un organisme aux tissus différenciés. Cette théorie s'opposa au préformationnisme dont les tenants qui se réclamaient d'Hippocrate postulaient que l'être vivant préexistait en miniature dans le germe19. La théorie de l'épigenèse fut soutenue par l'embryologiste William Harvey qui postulait en 1651 dans son ouvrage intitulé Exercitationes de generatione animalium que « tout ce qui vit vient initialement d'un œuf20». À la même époque, la théorie préformationniste (ou préformiste) avait l'appui de Marcello Malpighi tandis que Nicolas Hartsoeker n’était pas préformiste, mais disséminationniste (hypothèse selon laquelle les germes des animaux sont incréés et dispersés à travers le monde)21.
Le débat entre épigénisme et préformationnisme fut une controverse majeure de la biologie au cours des siècles suivants, à travers notamment l'ovisme et l'animalculisme. Elle prendra fin au milieu du xixe siècle avec le développement de la théorie cellulaire et du rôle de la cellule, déjà envisagée par Buffon dans son Histoire naturelle générale et particulière22, dont la publication en volumes s'étend de 1749 à 1804.
Bénédict Morel propose, en 1857, une théorie de la dégénérescence expliquant que le « crétin des Alpes » était le dernier rejeton d’une longue lignée d'individus de plus en plus dégénérés, rejetant l'hypothèse d'un manque d'iode, pourtant confirmée depuis23.
Émergence de l'épigénétique
Andrew Fire et Craig Mello ont reçu conjointement le Prix Nobel de médecine 2006 pour leur travail sur l'interférence par ARN de Caenorhabditis elegans, ver chez qui l'attirance pour une odeur acquise par l'expérience peut être transmise sur 3 générations, et jusqu'à 40 si cette caractéristique acquise est renforcée24 ; et chez qui l'épigénétique est associée à des modifications de longévité, transmises d'une génération à l'autre25.
L'hypothèse de changements épigénétiques affectant l'expression des chromosomes a été émise par le biologiste russe Nikolaï Koltsov26. On attribue la paternité de l'épigénétique dans son sens moderne au biologiste et embryologiste Conrad Hal Waddington qui la définit en 194227 comme une branche de la biologie étudiant les implications entre les systèmes gènes + environnement et leurs produits donnant naissance au phénotype d'un individu. Cette idée venait combler des lacunes du modèle génétique postulant une équivalence unique entre phénotype et génotype qui ne pouvait expliquer tous les phénomènes liés à la différenciation cellulaireN 2. Il fut alors élaboré une théorie dans laquelle chaque cellule indifférenciée passait par un état critique qui serait responsable de son développement futur non uniquement lié à ses gènes, et pour cette raison qualifié d'épigénétique.
Dans les années 1960 et 1970, les expérimentations en biologie moléculaire fleurissent et donnent lieu à des Prix Nobel. En 1965, pour François Jacob, Jacques Monod et André Lwoff, qui mettent en évidence le rôle de l'ARN dans le contrôle génétique des synthèses enzymatiques et virales28 ; en 1975, pour David Baltimore et Howard Temin, qui mettent en évidence le phénomène de transcription inverse, la synthèse d'un brin d'ADN à partir d'une matrice ARN29. Ces mécanismes annexes à la génétique sont fondamentaux dans la compréhension et l'émergence de l'épigénétique, mais ils ne remettent pas en cause le modèle standard de compréhension de l'évolution, la théorie synthétique de l'évolution, où seuls le hasard des mutations génétiques et la sélection naturelle sont en cause.
Cette certitude scientifique reste inébranlable jusque dans les années 1990 pendant lesquelles cette théorie synthétique est confrontée au séquençage complet de plusieurs génomes ce qui suggère qu'elle doit être complétée, car la communauté scientifique n'y découvre pas la totalité des effets phénotypiques dont elle espérait l'explication. Cette difficulté inattendue remet au goût du jour la recherche de facteurs externes au génome30. L'épigénétique ainsi redéfinie revendique alors sa place comme prolongement et complément de la génétique classique, notamment dans le domaine de la nutrition31, de la reproduction32, et comme « aspect de la post-génomique » accompagnant la recherche dans son passage de l'étude du génome à celui de l'épigénome33.
Dans les années 1980, Robin Holliday nomme « hérédité épigénétique »34 l'hérédité mise en évidence chez les mammifères en 1999 par Emma Whitelaw (en)35. L'étape suivante qui se développe depuis les années 2000 est le travail sur le rôle de facteurs environnementaux sur l'expression génétique, comme en 2007 avec l'exposition au bisphénol A qui perturbe la méthylation de l'ADN de souris35. On étudie alors la possibilité de transmission des caractères acquis et le rôle des gamètes pour savoir s'ils peuvent conserver certains des marqueurs épigénétiques36.
Souvent polémique parce que non prévue par la théorie synthétique de l'évolution (bien que son principe ait été suggéré par Lamarck hors de toute connaissance génétique, et que Darwin lui-même laisse ouverte explicitement dans L'Origine des espèces la possibilité chez les chiens pointers d'effets cumulatifs du dressage), mais surtout parce que prises à tort par le grand public pour une réfutation de l'existant plutôt qu'un complément, ces études accordent volontiers à l'épigénétique un rôle davantage marginal pour expliquer quelques mécanismes d'adaptation et d'évolution des formes vivantes4.
D'autres dimensions du rôle de l'épigénétique sont aussi explorées comme son incidence sur les neurones pour stabiliser leurs connexions synaptiques, ce qui aurait un rôle sur la mémoire à long terme37 ; ou l'effet d'un stress infantile sur la sensibilité au stress à l'âge adulte par son effet sur la méthylation de l'ADN des récepteurs au glucocorticoïde38.
Codage épigénétique et évolution
Incarnation des idées évolutionnistes, Charles Darwin examine, contrairement au schéma simplificateur voulant l'opposer radicalement à Lamarck, l'idée que l'ensemble de l'organisme participe à l'hérédité, c'est ce qu'il nomme pangenèse en 186839,40.
Articles détaillés : Évolution, Histoire de la pensée évolutionniste et Transmission des caractères acquis.
L'épigénétique propose des explications au sujet de la transmission des caractères acquis4.
La sélection naturelle combinée à la génétique et au hasard des mutations étaient les seuls facteurs reconnus de l'évolution depuis August Weismann, et jusqu'à l'apparition de l'épigénétique dans les années 1990. Pourtant l'idée de la possibilité de transmettre des caractères acquis est abordée entre autres par Aristote, Jean-Baptiste de Lamarck, Charles Darwin, ou encore Ivan Mitchourine et Lyssenko.
Les caractères épigénétiques ne s'opposent pas aux théories génétiques associées à la sélection naturelle, mais les complètent. Ainsi, l'hérédité épigénétique « présente une plus grande sensibilité à l'environnement et une stabilité inférieure à celle des modifications de la séquence de l'ADN »41.
Selon Jean-Claude Ameisen qui vulgarise le sujet4, les expérimentations scientifiques dans le domaine se sont multipliées dans les années 2000 et 2010. Par exemple sur la transmission de caractères provoqués par le contexte, comme la présence d'une odeur24,42 ou un vécu traumatique. Chez la souris par exemple, un trauma précoce semble avoir des répercussions comportementales et métaboliques sur les générations suivantes, y compris si les descendants n'ont jamais été mis en contact avec les parents (fécondation in vitro et « mère porteuse »)43. Globalement l'étude de ce qui est transmis par les cellules séminales paternelles est utilisée afin d'isoler des caractères exclusivement innés44,45.
On a récemment montré (2017) chez le rat de laboratoire que l'exposition d'une mère à de l'atrazine (désherbant) au moment de la formation des gonades de ses embryons faisait que cette molécule (ou le stress induit in utero par cette molécule) pouvait reprogrammer durablement des cellules souches gonadiques et être source de problèmes épigénétiques dans les générations suivantes (susceptibilité aux maladies induites par l'atrazine, chez les mâles et les femelles)46.
De même, une chimiothérapie subie par un adolescent semble induire des effets épigénétiques (transmis donc à la descendance) via une modification qualitative du sperme (anomalies de l'ADN)47. C'est la 1re démonstration du fait qu'une exposition chimique précoce peut reprogrammer durablement l'épigénome des cellules souches spermatogènes. Les épimutations de la lignée germinale (cellules du sperme) identifiées suggèrent que la chimiothérapie peut changer l'hérédité épigénétique à la génération suivante47.
Mécanismes
Articles détaillés : biologie cellulaire et biologie moléculaire.
Le problème de la différenciation cellulaire (des cellules différentes ayant toutes le même génome) a trouvé son expression moléculaire lorsqu'il est apparu que les mêmes gènes n'étaient pas exprimés d'un type cellulaire à l'autre. Ainsi, la combinaison de gènes nécessaires et suffisants à spécifier un type cellulaire donné est en général exprimée exclusivement dans ce type cellulaire. Dans de nombreux cas, ces gènes restent exprimés tout au long de la vie du lignage cellulaire (l'ensemble des divisions au sein d'un même type cellulaire). Il est donc important de comprendre comment se mettent en place ces spécificités cellulaires (comment les gènes deviennent activés ou réprimés au cours du développement) mais également, comment cette expression est par la suite propagée au cours des divisions cellulaires (par exemple pour maintenir l'expression de gènes spécifiques de l'identité musculaire dans des cellules de muscle). Une grande partie des recherches en épigénétique se concentre justement sur les mécanismes de propagation temporelle de l'expression des gènes, plus particulièrement sur la transcription qui constitue le premier niveau de régulation de l'expression des gènes. En effet, même si l'expression des gènes peut être régulée à plusieurs niveaux (transcription, épissage, export nucléaire des ARNs, traduction, etc.) la transcription semble être le principal niveau de contrôle. L'état « épigénétique » d'une cellule semble dépendre principalement de deux variables: 1- les régulateurs transcriptionnels présents (par exemple, les facteurs de transcription) et 2- l'état de compaction de l'ADN, qui va déterminer la capacité des régulateurs transcriptionnels à moduler l'expression des gènes. En résumé, la question posée en épigénétique consiste à comprendre comment, à partir d'un même génome, peuvent se mettre en place et se propager au cours de divisions cellulaires des états transcriptionnels (exprimé versus non exprimé) distincts.
Transcription de l'ADN en ARN
Pour créer des structures biologiques à partir des gènes, l'ADN est d'abord recopié, transcrit en ARN.
Article détaillé : Transcription (biologie).
La transcription est la copie du code génétique de l'ADN en ARN. La double hélice de l'ADN est ouverte et une chaîne d'ARN complémentaire de l'ADN matrice est formée par le complexe de l'ARN polymérase II. Dans le cas des gènes dits « codants » (c'est-à-dire qui codent des protéines), cet ARN messager sert de matrice à la synthèse de protéines lors de l'étape de traduction. De nombreux gènes codent des protéines régulatrices appelées facteurs de transcription, dont la fonction est de moduler l'expression d'autres gènes.
Boucles d'autorégulation
Certains facteurs de transcription comme HNF4 et MyoD sont susceptibles d'activer leur propre expression, engendrant ainsi une boucle dite d'autorégulation48. Ce mécanisme par autorégulation permet la persistance temporelle de l'expression des gènes après que le stimulus déclencheur ait cessé d'opérer. Notamment, après la division cellulaire par méiose ou mitose, si le stimulus à l'origine de l'activation d'un gène est absent, les cellules filles peuvent hériter de cette activation (par exemple par la présence de ces facteurs de transcription). Une telle régulation qui opère en trans, est retrouvée chez des procaryotes (exemple du phage Lambda49) comme chez les eucaryotes. Chez les eucaryotes multicellulaires, ce mécanisme « trans-épigénétique » par autorégulation concerne de nombreux facteurs de transcription impliqués dans la spécification de l'identité cellulaire, et est à ce titre un mécanisme épigénétique majeur.
Structure de la chromatine
Schéma illustrant les modifications de la chromatine soit au niveau de l'ADN (méthylation) soit au niveau des histones.
Article détaillé : Chromatine.
La chromatine des eucaryotes, association entre l'ADN et les protéines histones, autour desquelles l'ADN s'enroule en bobine, constitue une couche régulatrice supplémentaire au contrôle de l'expression des gènes. Celle-ci peut être soit décondensée ou « ouverte » (euchromatine), permettant ainsi l'accès à la machinerie transcriptionnelle et à l'expression génique, soit condensée ou « fermée » (hétérochromatine), empêchant ainsi l'expression d'un gène.
Certaines régions du génome sont constamment dans un état chromatinien fermé, on parle d'hétérochromatine constitutive. C'est ainsi le cas des centromères et des télomères.
L'état de la chromatine dépend de plusieurs facteurs qui régulent sa structure en modifiant chimiquement l'ADN ou l'état post-traductionnel des protéines d'histones ou l'action de remodeleurs de la chromatine et de protéines chaperons.
Plusieurs mécanismes de propagation épigénétique de l'information utilisant des modifications de la chromatine se sont mis en place chez les eucaryotes.
Pour lire la suite, consulter le LIEN
DOCUMENT wikipédia LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
FOURMI ROUSSE |
|
|
| |
|
| |

fourmi rousse
Issues d'un ancêtre commun avec les guêpes et les abeilles il y a plus de 100 millions d'années, les fourmis se sont répandues dans le monde entier, dans tous les milieux naturels au cours des siècles. Elles sont sans doute 20 000 espèces à peupler la Terre. Les fourmis rousses sont parmi les plus évoluées des espèces connues.
INTRODUCTION
Les premières fourmis, descendant d'un ancêtre aculéate (les aculéates sont des insectes hyménoptères dont les femelles portent un aiguillon, ou dard, à l'extrémité de l'abdomen), sont apparues au crétacé, il y a probablement 110 à 130 millions d'années. Les plus anciens fossiles connus, comme par exemple Gerontoformica cretacica, mis au jour dans l'ambre de France, sont vieux d'environ 100 millions d'années.
La plus primitive sous-famille de fourmis connue par des fossiles est celle des sphécomyrminés. Ces insectes du milieu du crétacé possèdent à la fois les mandibules et le thorax d'une guêpe solitaire, ainsi que la taille étroite entre l'abdomen et le thorax, signe distinctif des fourmis et de tous les aculéates, témoignant ainsi, dans sa morphologie, d'une souche primitive commune aux guêpes, aux abeilles et aux fourmis. Plusieurs espèces ont été découvertes dans l'hémisphère Nord, dans les ambres du crétacé d'Amérique du Nord (Canada, New Jersey) et d'Asie, réparties en plusieurs genres, notamment : Sphecomyrma, Cretomyrma, Biakuris et Dlusskyidris.
Les fourmis se diversifient très vite : on trouve des fossiles appartenant à plusieurs sous-familles actuelles dès le crétacé (ponérinés, formicinés, myrmicinés, dolichodérinés). À la suite du crétacé, au tertiaire, sur plusieurs milliers de restes fossiles retrouvés, la grande majorité appartient à des genres actuels. Empreintes incomplètes datant de l'éocène, fossiles vieux de 38 à 26 millions d'années (oligocène) et très bien conservés dans l'ambre de la Baltique et dans celui de Sicile, restes plus récents exhumés de l'argile du miocène dans l'Ohio témoignent de cette diversification ancienne et d'une remarquable adaptation de ces insectes aux diverses modifications climatiques. Hôtes sans doute des milieux secs à l'origine, les fourmis primitives étaient terricoles. Certaines espèces, plus évoluées, nidifiaient dans les arbres. Au cours des âges, elles ont colonisé tous les types d'habitat, des déserts arides aux sommets des montagnes et aux régions polaires.
Le nombre total d'espèces de fourmis est estimé à 20 000. On en connaît quelque 12 000 espèces, qui représentent environ 1 % de la totalité des insectes connus dans le monde. Certaines portent des aiguillons, d'autres sécrètent des substances corrosives ; les unes voient bien, les autres sont aveugles ; mais toutes sont sociales et possèdent des ouvrières sans ailes. Elles sont regroupées dans la grande famille des formicidés. Les fourmis rousses, Formica rufa, appartiennent, comme d'autres espèces parmi les plus spécialisées, à la sous-famille des formicinés. Appelées aussi fourmis des bois, elles vivent en sociétés nombreuses et très organisées, dans les forêts de conifères ou les forêts mixtes, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
LA VIE DES FOURMIS ROUSSES
DES KILOMÈTRES DE GALERIES SOUTERRAINES
Les fourmis rousses vivent en colonie. Celle-ci comporte une ou plusieurs reines qui se consacrent uniquement à la ponte des œufs, et de multiples ouvrières, stériles, chargées de toutes les autres tâches. Au printemps, certains œufs donnent naissance à des fourmis ailées sexuées, mâles et femelles, qui assurent la reproduction. Seules quelques-unes de ces femelles survivront et deviendront reines.
La colonie vit dans une fourmilière, située en lisière d'un bois ou dans une clairière, près des sources de nourriture, et souvent exposée au sud-est pour profiter de l'ensoleillement maximum. Plus le climat est rude, plus sa partie visible, le dôme, est élevée, l'accumulation de branchettes, de débris de feuilles et de cailloux très solidement imbriqués assurant l'étanchéité.
Pour étendre son territoire ou maintenir la croissance de sa population, la colonie forme parfois des supercolonies de deux à plusieurs dizaines de fourmilières (sociétés polycaliques) reliées à la fourmilière mère par 5 à 8 pistes de liaison, longues de 50 à 100 mètres.
À l'intérieur, les effets de l'insolation et la chaleur dégagée par la digestion des fourmis contribuent à réchauffer la température ambiante. L'été, des ouvertures supplémentaires sont pratiquées sur la face ensoleillée du dôme en début de matinée pour réchauffer le nid, ou sur la face ombragée l'après-midi pour évacuer le surplus de chaleur.
Ce maintien d'une température élevée permet un développement rapide du couvain et une activité permanente de toute la colonie, dont chaque individu, par sa tâche précise, assure le déroulement.
En hiver, après avoir dévoré œufs, larves et nymphes, les fourmis ralentissent leur activité et se calfeutrent. Les reines sont les premières à s'enfoncer dans le nid, entre 30 et 50 cm au-dessous de la surface du sol. À cette profondeur, quand la température extérieure est de - 10 °C, il fait entre 0 et - 2,5 °C. Seules les ouvrières « messagères thermiques » restent dans les zones supérieures.
Au printemps, ce sont elles les premières à sortir du nid pour se réchauffer, descendant ensuite porter leur chaleur en profondeur et réactivant ainsi reines et ouvrières, qui, à leur tour, convergent vers le sommet du dôme. Les ouvrières chargées des réparations rétablissent alors l'étanchéité du nid, dégagent les pistes et évacuent les fourmis mortes.
LA FOURMILIÈRE
La fourmilière
Installée dans une vieille souche d'arbre, elle est creusée de galeries. Au-dessus des chambres de ponte, au centre, brindilles et feuilles forment un dôme, où se trouvent les chambres à chaleur sèche pour les cocons. Les chambres de la partie souterraine sont plus fraîches.
QUELQUES FOURMIS CHASSENT POUR TOUTE LA COLONIE
Les fourmis rousses sont omnivores. Elles se nourrissent de proies animales (33 %), de la sève des arbres (4,5 %), de champignons (0,3 %) et de graines (0,2 %), ainsi que de miellat de pucerons.
Nourrir la colonie est la tâche des ouvrières les plus âgées ; à la fois plus rapides et plus entreprenantes, elles sont les « initiatrices du travail », ou « fourrageuses ». Celles qui chassent sont les plus agressives. Dès le printemps, de jour comme de nuit, mais surtout entre 7 heures et 19 heures, la fourrageuse part seule pour retrouver les pistes. Lorsqu'elle rentre à la fourmilière, la fourmi marque son trajet en déposant sur le sol des gouttes d'une sécrétion odorante appelée « phéromone de piste » (produite par des glandes de son abdomen). Cette piste odorante sert à retrouver le chemin et à guider les autres ouvrières vers les sources de nourriture ; la quantité de phéromone déposée augmente avec la richesse de la source de nourriture.
ATTAQUES À L'ACIDE
La fourmi palpe de ses antennes toute autre fourmi qu'elle rencontre. Si celle-ci ne porte pas « l'odeur de la colonie » et appartient à un nid étranger, les deux insectes tentent de se paralyser réciproquement – par un jet d'acide formique ou par morsure pour répandre l'acide formique sur les plaies – et émettent des phéromones d'alarme pour alerter des ouvrières guerrières de leur colonie. Les hostilités ont lieu de jour et peuvent durer plusieurs jours, l'agressivité des fourmis augmentant à mesure que la température ambiante croît. Lorsque celle-ci n'augmente plus, il se crée une zone neutre entre les deux fourmilières, qui modifie le territoire des colonies.
En chasse, la fourrageuse se déplace dans un rayon de 100 m autour du nid à la recherche de chenilles, papillons, guêpes, punaises, coléoptères et araignées, chassant aussi les fourmis des autres espèces. Lorsqu'elle a détecté une proie, elle pointe ses antennes vers celle-ci et, ouvrant ses mandibules pour s'en saisir, elle la paralyse d'un jet d'acide formique.
La proie est parfois charriée jusqu'au nid, puis déchiquetée, mâchée et réduite en bouillie par les ouvrières et par les larves. Mais, le plus souvent, elle est dépecée et avalée sur place. Une partie est absorbée par la fourrageuse pour sa propre alimentation, le reste est stocké dans son jabot social et sert à l'échange de nourriture (ou trophallaxie) avec les fourmis nourrices restées au nid.
Lorsqu'elle sent sur son corps ou sur sa tête les antennes d'une quémandeuse, la fourrageuse s'arrête : les deux fourmis, dressées sur leurs pattes antérieures, se font face, tête contre tête. Caressée par les antennes de la solliciteuse, la pourvoyeuse ouvre ses mandibules et régurgite une goutte de nourriture. Son jabot rempli, l'ouvrière approvisionnée va à son tour nourrir d'autres membres de la colonie.
L'ÉLEVAGE DES PUCERONS ET LA RÉCOLTE DU MIELLAT
Les fourmis rousses sont incapables de prélever la sève à l'intérieur des tiges des végétaux, que seuls les pucerons, les cochenilles, les psylles et autres homoptères peuvent extraire. Les pucerons aspirent la sève avec leur rostre, sorte de stylet buccal, et en assimilent les produits azotés, rejetant le surplus de matière sucrée, ou miellat. Pour récolter ce miellat, les fourmis entretiennent des colonies de pucerons ou de cochenilles d'espèces différentes, qu'elles sollicitent continuellement, provoquant ainsi chez ces insectes une sécrétion accrue de miellat. Cette relation est appelée « trophobiose ».
Les fourmis chargées de repérer les colonies de pucerons ne sont pas les mêmes fourrageuses que celles qui chassent. Ces fourmis trayeuses sont toutefois capables de tuer et de dévorer les ennemis de leurs précieux pucerons.
Ainsi, les gardiennes des pucerons tuent les coccinelles adultes (qui consomment, chacune, une soixantaine de pucerons par jour) ainsi que leurs larves (1 000 à 2 000 pucerons dévorés au cours de la vie larvaire). De même, les fourmis chassent les phalènes, dont les chenilles se nourrissent des feuilles dont la sève alimente les pucerons.
LA TRAITE DES PUCERONS
Pour récolter le miellat, la fourmi trayeuse sollicite le puceron avec ses antennes. Ce dernier relève alors son abdomen, excrétant par l'anus une gouttelette de miellat, que la fourmi stocke dans son jabot social.
Une ouvrière est capable de transporter de 3 à 8 mg de miellat à chacun de ses voyages, pouvant ainsi doubler son propre poids. Le miellat récolté par une fourmilière peut être estimé à 20 kg par saison d'activité.
UN VOL NUPTIAL ÉPHÉMÈRE
Les fourmis sexuées sont issues des premiers œufs pondus par les reines du nid, au printemps, quand la colonie redevient active. Ces « œufs d'hiver » donnent, après 35 à 45 jours, des mâles et des femelles ailés, qui, par une journée chaude et humide d'été, sortent en masse à la surface de la fourmilière par de nombreuses ouvertures pratiquées par les ouvrières. Tous s'envolent à quelques dizaines de mètres du sol, dans la direction du soleil, d'un vol lourd et maladroit qui n'excède pas une demi-heure. Lorsque leur poids, 30 mg environ, les fait retomber au sol, ils s'accouplent presque immédiatement, chaque femelle étant entourée de nombreux mâles qui attendent patiemment leur tour. Le stock de spermatozoïdes accumulé dans la spermathèque de la femelle assurera la reproduction de la fourmilière pendant des années. Puis, les jeunes reines, s'étant amputées de leurs ailes, rejoignent la fourmilière dont elles sont issues pour pondre ou s'installent dans un autre nid ; il arrive aussi qu'elle investisse une colonie d'une autre espèce (le plus souvent Formica fusca), tuant la reine et prenant sa place. Dans ce cas, les ouvrières de l'espèce « envahie » s'occupent de la nouvelle reine et de sa progéniture, qui finit par supplanter les occupants initiaux de la fourmilière.
Les mâles, eux, meurent peu après l'accouplement.
DIX ŒUFS PAR JOUR ET PAR REINE
La ponte est l'unique tâche qui échoit aux reines. Tous les jours, chacune monte jusqu'à une chambre de ponte, dans les étages supérieurs du nid, et pond une dizaine d'œufs, puis regagne les profondeurs de la fourmilière.
Jaunes ou blanchâtres, ces minuscules œufs, de 0,2 à 1 mm, composent, avec les larves, le couvain. Sitôt pondus, ils sont immédiatement transportés par les ouvrières nourrices dans des chambres spéciales, les couveuses, à différents niveaux de la fourmilière, pour bénéficier des meilleures conditions climatiques (humidité et chaleur). Constamment léchés, les œufs deviennent collants, ce qui facilite leur transport. Les ouvrières qui s'occupent du couvain, nées au cours de l'été précédent, élèvent les jeunes larves avec les réserves de graisse qu'elles ont accumulées.
Les larves muent trois fois, parfois quatre, et se transforment en nymphes au bout de quatorze jours. La métamorphose complète nécessite au moins six semaines. Pour tisser leur cocon, elles sécrètent un liquide qui, au contact de l'air, prend la consistance d'un fil de soie. Lorsqu'elles rompent ce cocon, les jeunes fourmis adultes ont la tête et l'abdomen gris, le thorax brun et les pattes très pâles. Il faut plusieurs jours pour que leur corps mou acquière la taille et la consistance propres à l'adulte. Au début, elles ne sollicitent pas de nourriture et leur démarche est souvent hésitante. Aussi, au moindre danger, les nourrices les saisissent dans leurs mandibules par une patte ou par une antenne pour les déplacer à l'abri.
LA FÉCONDATION
La fécondation
Les œufs fécondés donnent naissance à des ouvrières ou, si les nourrices sont nombreuses (un millier environ), à des femelles sexuées. Lorsque la température du nid est inférieure à 19 °C, les muscles de la reine, qui libèrent d'ordinaire les spermatozoïdes, n'agissent pas, et les œufs pondus, non fécondés, donnent des mâles (parthénogenèse arrhénotoque).
POUR TOUT SAVOIR SUR LES FOURMIS ROUSSES
FOURMIS ROUSSES (FORMICA RUFA)
Le corps d'une fourmi rousse, ou fourmi des bois, se compose, comme celui de tous les insectes, de trois parties : la tête, le thorax et l'abdomen. Les ouvrières peuvent être une fois et demie plus grandes que les reines ou les mâles, mais les femelles sexuées vivent environ 15 ans de plus.
La tête, plus petite chez la femelle, porte des yeux composés (formés de très nombreuses unités, les facettes, ou ommatidies), des yeux simples (ou ocelles), des pièces buccales de type broyeur-lécheur, et une paire d'antennes.
Le système nerveux est le siège de la mémoire et de la coordination des instincts. Le cerveau et les ganglions nerveux sont inégalement développés dans les différentes castes. Chez le mâle, dont la vie est courte, leur faible activité est tendue vers la reproduction ; chez les autres membres de la colonie, elle est plus variée.
Les yeux à facettes permettent à la fourmi de percevoir les mouvements ; elle détecte avec netteté le déplacement d'une proie ou d'un prédateur ; en revanche, elle perçoit assez mal un paysage. Sa vision des couleurs, ou vision chromatique, est médiocre. Des études ont montré que, le spectre des couleurs étant déplacé dans l'ultraviolet, la fourmi ne voit donc pratiquement pas le rouge. Les yeux simples, sensibles uniquement à la luminosité, aident à la vision nocturne.
La tête et les antennes (de même que le thorax et les tibias des pattes antérieures) contiennent des organes auditifs (organes chordotonaux), qui perçoivent des vibrations sonores. Les antennes jouent un rôle extrêmement précis dans la perception du goût, de l'odorat, de l'ouïe et surtout du toucher. Elles sont munies de nombreux poils tactiles courts, dont la base est soutenue par des terminaisons nerveuses particulièrement développées, puisque la majeure partie des activités de la fourmi est déclenchée par la perception de substances chimiques variées, les phéromones.
La fourmi émet des sons, comparables à des petits cris ou à des grincements, parfaitement audibles à l'oreille humaine.
Les mandibules, atrophiées chez les mâles, sont au contraire puissantes chez les femelles et les ouvrières. La langue est courte ; les pièces buccales annexes servent au léchage et au nettoyage.
Le thorax diffère aussi selon les castes. Chez la femelle ailée et la reine désailée, le mésonotum (premier article du thorax) est très développé, car il porte l'articulation des ailes. Les deux paires d'ailes des individus sexués sont membraneuses – les fourmis appartiennent (comme les guêpes et les abeilles), à l'ordre des hyménoptères, littéralement « ailes en membranes » (du grec hymen, membrane, et pteron, aile). Sur le thorax, voûté chez le mâle et réduit chez l'ouvrière, s'articulent les pattes, composées de la hanche, du trochanter (tubérosités du fémur, où s'attachent les muscles qui actionnent la cuisse), du fémur, du tibia et des tarses. À l'extrémité des tibias des pattes antérieures se trouve un organe de nettoyage destiné aux antennes. À la base des pattes, les glandes métathoraciques sécrètent un produit odorant qui contribue sans doute à la défense. Si les six pattes sont longues chez les femelles et les ouvrières, elles sont atrophiées chez les mâles.
Le système digestif est composé du pharynx, de l'œsophage, situé dans le thorax, du jabot, du gésier (ou intestin moyen) et de l'intestin postérieur, localisé dans le gastre. À l'inverse du jabot, très extensible, le gésier est fortement rétréci et musclé. À hauteur de l'anus, la glande à poison renferme l'acide formique – que l'insecte peut projeter, si nécessaire, à 1 m de distance –, et la glande de Dufour sécrète des phéromones essentielles pour la communication.
Les divers organes de l'appareil génital de la reine (ovaires, utérus et poche copulatrice contenant les spermatozoïdes déposés par les mâles) sont entourés de forts muscles transversaux, qui aident à la descente des œufs et facilitent l'accès des spermatozoïdes aux ovocytes. Chez l'ouvrière, la poche copulatrice est absente ou peu développée. Chez les mâles, deux testicules déversent leurs spermatozoïdes dans deux vésicules séminales aboutissant à un conduit éjaculateur unique, terminé par un pénis.
La respiration s'effectue par un système de tubes, les trachées, qui atteint toutes les parties du corps de l'insecte et s'ouvre à l'extérieur par les stigmates.
FOURMIS ROUSSES
Nom
(genre, espèce)
: Formica rufa
Famille : Formicidés
Ordre : Hyménoptères
Classe : Insectes
Identification : Trois castes : ouvrières, femelles sexuées (reines) et mâles ; couleur noire ou rousse ; antennes coudées ; yeux composés latéraux, plus gros chez les mâles ; trois paires de pattes thoraciques, atrophiées chez les mâles ; deux paires d'ailes chez les individus sexués. Deuxième et troisième segment abdominal étranglé en pétiole
Taille : Ouvrières : de 4 à 9 mm ; reines et mâles : de 9 à 11 mm
Poids : Ouvrières : de 7 à 10 mg, reines et mâles : 30 mg
Répartition : Toute l'Europe (excepté le Sud), Caucase, Sibérie, Amérique du Nord
Habitat : Forêts de conifères en plaine et en altitude
Régime alimentaire : Omnivore ; essentiellement miellat des pucerons et proies animales
Structure sociale : Colonie de plusieurs milliers d'individus par fourmilière ; société monogyne (une seule reine) ou polygyne (plusieurs centaines de reines), monocalique (une seule fourmilière) ou polycalique (plusieurs dizaines de fourmilières [supercolonies])
Longévité : Ouvrières : de 5 à 6 ans ; reines : jusqu'à 20 ans et plus ; mâles : quelques semaines
Statut : Espèce protégée dans plusieurs pays d'Europe ; considérée comme « quasi-menacée » par l' U.I.C.N. (Union internationale pour la conservation de la nature)
Remarque : Espèce utilisée dans la lutte biologique contre les insectes ravageurs forestiers
SIGNES PARTICULIERS
YEUX
Les yeux composés des ouvrières comptent de 400 à 600 ommatidies, ou facettes oculaires ; les reines ont des yeux plus larges, composés de 100 à 900 ommatidies. Mais ce sont les mâles qui possèdent les plus gros yeux, avec de 200 à 2 000 ommatidies, ce qui leur permet de repérer plus précisément les femelles lors du vol nuptial. De même, les ocelles sont plus gros chez les mâles que chez les femelles, mais sont plus visibles chez ces dernières que chez les ouvrières.
PIÈCES BUCCALES
De type broyeur-lécheur, les pièces buccales annexes sont molles et servent au léchage et au nettoyage. La langue de la fourmi est souvent courte et ridée en travers. Les mandibules sont puissantes chez les ouvrières. La sécrétion des glandes mandibulaires est peu fluide et sert à malaxer les aliments durs. L'appareil buccal est également équipé de palpes labiaux et de palpes maxillaires, qui ont un rôle sensitif.
COUPE D'UNE REINE
Le système nerveux est bien développé. Le système digestif se prolonge de la bouche dans le thorax par l'œsophage, puis dans l'abdomen par le jabot, ou estomac social. Celui-ci est très extensible grâce à la dilatation des muscles abdominaux. Le gésier, ou intestin moyen, très rétréci et musclé, ne laisse passer que les aliments destinés à l'intestin postérieur. Les tubes de Malpighi (de 4 à 20 tubes) récupèrent les déchets et font office de reins. Le système reproducteur est entièrement dans l'abdomen. La poche copulatrice d'une reine vivant dans un nid de plus de 100 000 ouvrières est de 1 mm environ de diamètre. La glande à poison des fourmis des genres Formica et Cataglyphis contient de l'acide formique concentré à plus de 50 %.
LES AUTRES FOURMIS
Les fourmis, qui forment la famille des formicidés de l'ordre des hyménoptères, sont dans leur grande majorité tropicales ou équatoriales. Environ 12 000 espèces ont été décrites, mais leur nombre total est estimé à environ 20 000. Toutes les fourmis sont sociales, mais les stades d'évolution sont très inégaux. Certaines sociétés se composent d'une demi-douzaine d'individus, d'autres de plusieurs millions. Martialis heureka, une espèce de fourmi amazonienne découverte en 2003, est extrêmement primitive : elle se situe, génétiquement parlant, à la base de l'arbre évolutif des fourmis ; ainsi est-elle sans doute identique aux toutes premières fourmis qui vivaient sur Terre, il y a plus de 100 millions d'années.
La famille des formicidés est répartie en une vingtaine de sous-familles. Les fourmis présentées ci-dessous appartiennent à huit d'entre elles.
LES FOURMIS PRIMITIVES
Sous-famille des ponérinés. Ce sont les fourmis porte-aiguillon.
Environ 1 800 espèces.
Identification : morphologiquement proches des guêpes ; reines et ouvrières semblables ; très peu développées ; exclusivement terricoles et carnivores ; se nourrissent de mille-pattes, cloportes, termites, chaque fourmi subvenant à ses besoins.
Répartition : monde entier, surtout Australie et Amérique du Nord.
Genre le mieux connu :
Genre Myrmecia. Ce sont les « fourmis sauteuses » (jumper ants), ou « fourmis bulldogs » (bulldog ants).
Une centaine d'espèces qui vivent en Australie et en Tasmanie. Jusqu'à 2,5 cm de long.
Très féroces ; leur piqûre est douloureuse ; fourmilières souterraines n'abritant que quelques centaines d'individus.
LES FOURMIS CHASSERESSES OU LÉGIONNAIRES
Sous-familles des dorylinés (200 espèces), des cérapachyinés tropicaux (environ 100 espèces) et des leptanillinés (environ 200 espèces).
Les colonies alternent phases nomade et sédentaire. En phase nomade, migrations nocturnes et chasse diurne pendant 14 à 17 jours. Puis nymphose des larves et phase sédentaire de repos (21 jours), au cours de laquelle la reine pond plus de 100 000 œufs. Reproduction de sexués au début de la saison sèche et division de la colonie selon le nombre de reines fécondées.
Quelques genres :
Genre Dorylus (sous-genre Anomma). Ce sont les fourmis magnans d'Afrique. Comme toutes les fourmis légionnaires, yeux petits, parfois aveugles. Colonies peu évoluées socialement, mais très importantes sur le plan numérique (parfois plus de un million et demi d'individus, et jusqu'à 10 ou 20 millions chez certaines espèces, telle Dorylus nigricans), avec une seule reine. Polymorphisme des ouvrières. Migrations en colonnes serrées (20 m/h) et « bivouacs » périodiques.
Carnivores, elles chassent en groupes insectes, arthropodes et petits vertébrés, et dévastent tout sur leur passage.
Genre Eciton d'Amérique du Sud ; mâles ailés, ouvrières polymorphes, les plus grosses étant des soldats. Au bivouac, reine et couvain sont à l'abri au milieu d'un agrégat des fourmis de la colonie, accrochées les unes aux autres et suspendues dans une cavité naturelle.
LES FOURMIS MOISSONNEUSES ET CHAMPIGNONNISTES
Sous-famille des myrmicinés, ou fourmis à nœuds, essentiellement.
300 espèces connues.
Répartition : presque partout dans le monde, surtout sous les climats chauds.
Identification : 2 segments pédoncules ; la plupart possède un organe émetteur de sons et un aiguillon ; ouvrières de quelques millimètres ; échanges de nourriture continuels.
Quelques genres :
Genre Myrmica, fourmis rouges, primitives, nid dans la terre ; proies animales et végétales.
Genre Messor, fourmis méditerranéennes, et genre Pogonomyrmex, fourmis d'Amérique du Nord, récoltent des graines et les amassent en prévision des saisons sèches ; nids à plusieurs mètres sous terre ; soldats non belliqueux.
Genre Cataglyphis, fourmis des régions méditerranéennes, se reproduisent à terre.
Genre Atta, les fourmis coupeuses de feuilles, ou fourmis parasols, d'Amérique tropicale et subtropicale, cultivent des champignons en mâchant feuilles et fleurs découpées, pour se nourrir des tubercules mycéliens qui y poussent. Chaque espèce a sa propre variété. Colonies gigantesques, souterraines, sur des centaines de mètres ; polymorphisme des ouvrières ; soldats aux mandibules coupantes. Les reines mangent les 9/10 de leurs œufs.
LES FOURMIS PASTORALES OU ÉLEVEUSES
Sous-familles des formicinés (environ 2 500 espèces), des camponotinés et des dolichodérinés, ou fourmis puantes.
Répartition : monde entier. Elles élèvent des pucerons, cochenilles, cicadelles, chenilles de papillons rhopalocères, dont elles utilisent le miellat.
Quelques genres :
Genre Crematogaster, espèces enfermant leur « bétail » dans des galeries de terre cimentée ou de matières végétales mâchées, le « carton ».
Genre Lasius, ces fourmis entretiennent des pucerons très nuisibles aux cultures et les transportent d'une plante à l'autre (Lasius americana) ; elles les maintiennent en vie, en hiver, en rentrant les œufs dans la fourmilière.
L'espèce Myrmecocystus mexicanus, ou fourmi pseudo-mellifère, la plus évoluée du groupe, utilise certaines ouvrières, les « replètes », comme récipients ou sacs à miel. Suspendues au plafond d'une chambre par dizaines, celles-ci sont gavées par les fourrageuses, puis elles nourriront les autres par trophallaxie.
Genre Acropyga : chez ces espèces, lors du vol nuptial, chaque reine emporte quelques cochenilles.
LES FOURMIS TISSERANDES
Sous-famille des formicinés ; un seul genre, Œcophylla, deux espèces.
Identification : dans les arbres, construisent leur nid en tirant et en rabattant les feuilles, qu'elles cousent en promenant des larves d'un bord à l'autre, pour leur faire sécréter des fils de soie, qui forment un tissu dense maintenant la feuille roulée. L'unique reine engendre plusieurs centaines de milliers d'ouvrières et colle ses œufs sur les feuilles. Le couvain se développe dans ces berceaux. Pour envahir un territoire, elles montent l'une sur l'autre, construisant des chaînes et des pyramides, jusqu'à former des ponts au-dessus du vide.
Répartition : Afrique, sud de l'Asie.
LES FOURMIS VOLEUSES ET ESCLAVAGISTES
Sous-familles des formicinés et des myrmicinés. Très petites et très agiles, les voleuses dérobent nourriture et couvain d'espèces plus grandes ; les esclavagistes, comme Raptiformica, les fourmis sanguines d'Amérique du Nord, capturent ouvrières et nymphes d'espèces voisines pour les mettre à leur service.
Répartition : Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud (voleuses).
Quelques genres :
Genre Dorymyrmex ; odeur repoussante pour les féroces fourmis moissonneuses Pogonomyrmex, chez qui elles construisent leur nid.
Genre Carebara vidua d'Amérique du Sud : envahit les nids des termites.
MILIEU NATUREL ET ÉCOLOGIE ...
Pour lire la suite, consulter le LIEN ...
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Une étape vers la fabrication de cellules artificielles |
|
|
| |
|
| |

Une étape vers la fabrication de cellules artificielles
Courant octobre, une étude parue dans EMBO journal a mis en lumière les avancées du CEA-Irig sur la fabrication de cellules artificielles. Ces cellules construites de toutes pièces vont servir à terme à fabriquer de la matière vivante, matériau d’avenir qui pourrait permettre de développer des applications industrielles durables et résilientes. Le point avec Manuel Théry, co-directeur, avec Laurent Blanchoin, du laboratoire Cytomorpholab.
Publié le 28 octobre 2022
Quelles recherches menez-vous au Cytomorpholab ?
Nous menons des recherches sur les cellules, leur squelette et leur mécanisme. Un des objectifs du laboratoire est notamment de participer à un élan international visant à essayer de fabriquer de la matière vivante. La matière vivante étant, comme tous les organismes vivants, composée de cellules, la fabriquer implique pour nous de construire de toute pièces une cellule.
Comment fabrique-t-on ces cellules
artificielles ?
Aujourd’hui, des dizaines de groupes de recherche dans le monde sont impliqués dans les cellules artificielles. Certains sont concentrés sur la production d’énergie, d’autres sur la synthèse et la dégradation de composants cellulaires. D’autres encore vont utiliser ces fonctions pour étudier les propriétés de la matière vivante : c’est dans ce cadre-là que travaille notre laboratoire. On essaye de comprendre comment les cellules « ressentent », interagissent avec leur environnement par l’intermédiaire de leur squelette qui est dynamique, et s’orientent dans l’espace.
Comprendre ces mécanismes de « sensation » et d’organisation du squelette des cellules est essentiel pour ensuite les reconstituer au sein d’une cellule artificielle. Nous suivons ainsi le postulat réductionniste de Feynman qui dit « ce que je comprends, je peux le construire ».
Plutôt que d’observer les cellules pour comprendre comment elles fonctionnent, on isole les composants de la cellule, on les fait se réassembler en dehors d’un contexte cellulaire, dans un tube à essai, et ces composants reconstruisent l’architecture des cellules.
A quoi ça sert de fabriquer de la matière vivante avec des cellules artificielles ?
La matière vivante, par opposition à la matière inerte, est une matière qui consomme de l’énergie, pour ne pas se dégrader et pour maintenir sa structure au cours du temps. Par ailleurs c’est une matière à l’intérieur de laquelle les composants sont renouvelés en permanence. Cette matière peut donc changer et s’adapter à son environnement. Cela pourrait donc devenir un matériau d’avenir, pour de nombreuses applications.
Ces cellules artificielles pourraient servir à construire des matériaux fonctionnant différemment, en réintégrant un cycle naturel. Des matériaux qui respirent, qui stockent du CO2, qui produisent des biocarburants, qui utilisent l’énergie propre au vivant, qu’on appelle l’ATP. Des matériaux qui, en se dégradant en permanence, sont intrinsèquement auto-réparants, auto-dégradables. Cette matière vivante pourrait s'intégrer pleinement dans des cycles écologiques, contrairement à tous les matériaux que l’on utilise aujourd'hui dans l'industrie. Elle permettrait de développer des systèmes durables et résilients et pourrait être une des briques importantes pour la construction des prochaines révolutions industrielles.
Ces cellules artificielles ne vont pas servir à faire de la thérapie et du soin. Pour cela, on va utiliser des cellules qui existent déjà, que l’on va modifier pour accomplir des tâches d’intérêt visant à traiter des patients.
En quoi l’étude publiée récemment dans EMBO journal constitue une avancée ?
Cette étude montre comment nous avons réussi à reconstituer, dans un micro-compartiment fermé de la taille d’une cellule, la dynamique de deux des composants du squelette cellulaire : les microtubules et les filaments d’actine. C’est la première fois que nous avons été capables de comprendre les paramètres physiques et géométriques qui font qu’en réponse à un signal externe, une cellule se « polarise » en réorganisant son squelette interne et en repositionnant ses organelles selon un axe défini par la position du signal.
Pourquoi le CEA est impliqué dans ces travaux ?
Le CEA a la particularité de développer et de contrôler toute la chaine de valeur depuis la recherche la plus fondamentale jusqu'au développement des prototypes et leur mise en application dans des protocoles industriels. Si le CEA s’implique aujourd'hui dans des recherches très amont sur le vivant, c'est parce qu’un jour, il deviendra possible d'utiliser ces mécanismes du vivant pour aller jusqu'à des applications industrielles.
QUELS SONT LES DEUX COMPOSANTS QUI FORMENT L’ARCHITECTURE DES CELLULES ?
L’architecture des cellules est multiple. Elle est composée d’un réseau de filaments en périphérie qui tapissent le bord des cellules : c’est le premier réseau qui va interagir avec l’environnement. L’autre réseau, fait de microtubules, est une forme d’étoile partant du centre des cellules et qui va interagir avec la première architecture. C’est la discussion entre ces deux réseaux qui va permettre aux cellules de sentir l’information en différents points de l’espace, de les intégrer en un point, et ensuite de produire une réponse en s’orientant dans l’espace. Cela peut servir à la cellule à s’orienter vers une source de nourriture, à échapper à un prédateur. C’est un mécanisme élémentaire primitif de toutes les cellules vivantes.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
APOPTOSE |
|
|
| |
|
| |

Apoptose
L'apoptose (ou mort cellulaire programmée) est le processus par lequel des cellules déclenchent leur autodestruction en réponse à un signal. C'est l'une des voies possibles de la mort cellulaire, qui est physiologique, génétiquement programmée, nécessaire à la survie des organismes multicellulaires. Elle est en équilibre constant avec la prolifération cellulaire. Contrairement à la nécrose, elle ne provoque pas d'inflammation : les membranes plasmiques ne sont pas détruites, du moins dans un premier temps, et la cellule émet des signaux (en particulier, elle expose sur le feuillet externe de sa membrane plasmique de la phosphatidylsérine, un phospholipide normalement constitutif de son feuillet interne) qui permettront sa phagocytose par des globules blancs, notamment des macrophages.
L'apoptose (du grec : apo, « au loin » et ptosis, « chute ») a été mise en évidence en 1972 par John Kerr, Andrew Wyllie et Alastair Currie lors de l'étude de tissu par microscopie électronique1.
Ils choisirent ce mot apoptosis pour décrire le phénomène de mort cellulaire naturelle. Ce mot provient d'une locution grecque évoquant la « chute des feuilles »2. Elle avait déjà été employée en médecine par Hippocrate de Kos (460-377 av. J.-C.) dans son traité Des Instruments de réduction pour décrire la décomposition des tissus après la mort (« chute des os »)2,3.
Exemples de rôles physiologiques[modifier | modifier le code]
Morphogenèse[modifier | modifier le code]
L'apoptose joue un rôle dans la formation du corps d'un organisme, par exemple l'émergence des doigts. Au début de sa formation, la main ressemble à une moufle (ou une palme), puis les cellules se trouvant entre les futurs doigts disparaissent. De même, la disparition de l'appendice caudal, chez le fœtus humain, est due à ce phénomène d'apoptose. La régression de la queue chez les têtards lors de leur métamorphose en grenouille est elle aussi due à l'apoptose.
Elle joue un rôle dans la formation du cerveau : très tôt dans l'embryogenèse, le cerveau subit une vague apoptotique qui le remodèle. Ensuite, les neurones forment entre eux des liaisons synaptiques au hasard [réf. nécessaire], et une deuxième vague apoptotique élimine ceux qui n'ont pas établi de liaisons utiles.
Elle peut également avoir un rôle moteur, la rétraction des cellules mortes entraînant la mobilisation des tissus voisins. Ce mécanisme a notamment été décrit chez l'embryon de la drosophile4.
Système immunitaire[modifier | modifier le code]
En réponse à l'apparition d'un antigène étranger dans le corps, des lymphocytes B se mettent à produire chacun un anticorps particulier, en recombinant au hasard leurs gènes d'immunoglobulines (recombinaison VDJ). Ceux qui produisent des anticorps inactifs ou autoimmuns sont éliminés par apoptose. En cas d'infection virale, les lymphocytes T cytotoxiques produisent des molécules toxiques pour les cellules infectées ; ils sont détruits par apoptose lorsque l'infection est maîtrisée. C'est le cas dans l'infection par le VIH, mais cette voie entraîne par la suite des effets néfastes car les LT4 détruits en grande quantité ne peuvent plus sécréter les interleukines à l'origine de la sélection et de l'amplification clonale.
Différenciation intestinale[modifier | modifier le code]
Les cellules intestinales sont en perpétuel renouvellement (avec une durée de vie de quelques jours seulement) et migrent du bas des cryptes vers le sommet des villosités intestinales de l'intestin grêle où elles assurent leur fonction d'absorption des nutriments. Ultimement elles se décrochent et enclenchent un phénomène apoptotique particulier appelé anoïkose, dû à la perte de contact cellule-cellule ou cellule-matrice extracellulaire.
Dédifférenciation mammaire[modifier | modifier le code]
Les acini des glandes mammaires après la période d'allaitement, et en absence du maintien du signal de prolifération/différenciation dû à la prolactine, vont se résorber, et perdre un nombre important de cellules épithéliales par un processus d'apoptose.
Causes[modifier | modifier le code] • Une cellule normale a constamment besoin que le corps lui confirme son utilité, aux moyens de facteurs de croissance. La perte de ces signaux peut déclencher un processus apoptotique. • Des signaux émis à la suite des dommages subis par l'ADN (par exemple à la suite d'une irradiation aux rayons UV ou aux rayons X) sont capables de déclencher l'apoptose: en effet c'est alors soit une cellule potentiellement cancéreuse, soit une cellule totalement dysfonctionnelle. Dans les deux cas, cette cellule doit être éliminée sans dommage pour le reste du tissu adjacent. • Des signaux hormonaux, notamment par les glucocorticoïdes, peuvent déclencher l'apoptose. C'est un mécanisme important, de régulation du système immunitaire. • Pression sur le réticulum endoplasmique : lorsqu'une cellule a un problème dans la conformation d'une protéine, qui aboutit à une accumulation de cette protéine dans le réticulum endoplasmique, elle peut entrer en apoptose. • La perte des contacts entre certaines cellules, ou bien entre ces cellules et leur matrice extracellulaire environnante induit de façon extrêmement rapide un processus apoptotique appelé anoïkose. • L'apoptose peut aussi être causée par la dégradation des télomères des chromosomes. Elle peut être inhibée par les télomérases. Ce processus est aussi appelé horloge biologique.
Une cellule enclenche un processus apoptotique. Il s'agit là d'un des multiples scénarios de l'apoptose : le processus est ici déclenché à la suite des signaux émis par une cellule voisine. La cellule en apoptose transmet un signal indiquant aux phagocytes, qui font partie du système immunitaire, d'effectuer leur travail de phagocytose. L'apoptose se manifeste sur ces cellules isolées (non regroupées). On constate sur les cellules concernées une compaction et une marginalisation de la chromatine nucléaire (pycnose) ainsi qu'une convolution des membranes cytoplasmiques et nucléaires et une condensation du cytoplasme.
L'intégrité des membranes est conservée au cours du processus apoptotique évitant ainsi toute réaction inflammatoire. Les corps apoptotiques sont protégés par une enveloppe membranaire issue de la convolution des membranes.
Désassemblage cellulaire au cours de l'apoptose5[modifier | modifier le code]
Étape 1 : purge de la membrane apoptotique[modifier | modifier le code]
Lors de l'induction de l'apoptose par voie extrinsèque (activée par les récepteurs transmembranaires) ou intrinsèque (par l'intermédiaire des mitochondries)6, la cellule en train de mourir peut générer des renflements ou des blebs ou bulles à la surface de la cellule, un processus connu sous le nom de claquage d'une membrane apoptotique6. La purge membranaire apoptotique est considérée comme la première étape (étape 1) du désassemblage des cellules apoptotiques, qui peut apparaître sous la forme de petites bulles superficielles aux premiers stades de l'apoptose ou de grandes bulles dynamiques membranaires aux étapes ultérieures7,8. La formation de grandes bulles de membrane dynamiques pourrait faciliter la fragmentation des organites tels que le noyau au cours de la progression de l'apoptose7,9. Le saignement des membranes apoptotiques est régulé par un certain nombre de facteurs moléculaires, en particulier le facteur protéine kinase 1 associée à la famille Rho des petites GTPases contenant un enroulement hélicoïdal (ROCK1 (en)) activée par la caspase10,11.
Étape 2 : formation de protubérances membranaires apoptotiques[modifier | modifier le code]
Après le débordement de la membrane apoptotique, une cellule peut subir d'autres modifications morphologiques pour générer une variété de saillies minces de la membrane apoptotique, notamment des pointes de microtubules, des « apoptopodes » et des « apoptopodes en perles »12,13,14. La formation de ces saillies membranaires apoptotiques dépend souvent du type de cellule et représente la deuxième étape (étape 2) du désassemblage des cellules apoptotiques7,8 (figure 1). Par exemple, des pointes de microtubules ont été observées sur des cellules épithéliales squameuses apoptotiques12. Mécaniquement, la formation de pointes de microtubules dépend de la polymérisation des microtubules et de l'établissement du réseau de microtubules12. La formation de pointes de microtubules se réalise pour faciliter la séparation des bulles de membrane, ainsi que la distribution du contenu nucléaire dans les bulles de membrane12. Plus récemment, un autre type de saillie de la membrane apoptotique moins rigide et semblable à des cordes, appelée « apoptopodes » (« pieds de la mort »), a été identifié sur les cellules T, les thymocytes et les fibroblastes apoptotiques13. À l'instar des pointes de microtubules, la formation d'apoptopodes peut induire une séparation des blebs de la membrane13. En outre, les monocytes apoptotiques peuvent générer un autre type de saillie de la membrane apoptotique, appelée apoptopode perlée, qui ressemble à une « perle sur chaîne »14. La formation d'apoptopodes perlés commence par la génération et l'allongement d'une saillie semblable à l'apoptopode, qui se segmente et se présente sous la forme d'une chaîne de perles14. Actuellement, le seul régulateur moléculaire connu de la formation d'apoptopodes perlés et d'apoptopodes est le canal membranaire activé par la caspase PANX1 (en) (pannexine 1)13,14.
Étape 3 : fragmentation cellulaire[modifier | modifier le code]
Enfin, la libération de corps apoptotiques individuels liés à la membrane (généralement considérés comme ayant un diamètre d'environ 1 à 5 microns) représente l'étape finale (étape 3) du désassemblage des cellules apoptotiques7,8. Bien que le mécanisme à la base du processus de fragmentation final ne soit pas bien défini, la dissociation des corps apoptotiques de différents types de saillies membranaires apoptotiques peut nécessiter une contrainte de cisaillement ou peut-être même une interaction avec les cellules voisines7. Il convient de noter qu’en plus des corps apoptotiques, des vésicules membranaires d’un diamètre inférieur à 1 micron sont également libérées au cours de l’apoptose15.
* La libération de corps apoptotiques à partir de la cellule en train de mourir a été proposée pour faciliter la communication entre cellules par le biais de protéines, de micro-ARN et d'ADN présents sur / dans des corps apoptotiques16,7,17,18. Il a également été proposé que le désassemblage des cellules apoptotiques pourrait faciliter l'élimination des cellules mortes, car il pourrait s'avérer plus efficace pour une cellule phagocytaire d’engloutir des fragments cellulaires plus petits (c'est-à-dire des corps apoptotiques) plutôt qu'une cellule apoptotique comme un tout7,19.
* apoptotique. Mécanismes moléculaires[modifier | modifier le code]
* Mécanismes intracellulaires de régulation de l'apoptose. Le mécanisme d’apoptose est gouverné par deux voies principales d’activation : • une voie dite extrinsèque, impliquant des récepteurs appartenant à la super-famille de protéines des récepteurs au facteur de nécrose tumorale (TNF de l'anglais : tumor necrosis factor) ;
• une voie dite intrinsèque mettant en jeu la mitochondrie ; cette voie est gouvernée principalement par des protéines appartenant à la super-famille de Bcl-2.
Syndactylie, différenciation incomplète de deux orteils du fait d'une activité apoptotique défectueuse.
Ces deux voies conduisent à l’activation de protéases à cystéine (caspases) dites effectrices. Celles-ci sont responsables du clivage de plusieurs molécules, comme certaines protéines de structure, ce qui se traduit par des phénomènes morphologiques et biochimiques caractéristiques se terminant par le démantèlement de la cellule : exposition de phosphatidylsérine à la surface de la membrane cellulaire, arrêt de la réplication, fragmentation du noyau et du cytosquelette entraînant la formation de corps apoptotiques phagocytés par les cellules environnantes.
Voie extrinsèque[modifier | modifier le code]
Comme son nom l'indique, la voie extrinsèque de l'apoptose est déclenchée par un signal extérieur à la cellule. Par exemple, cette voie est empruntée lorsqu'un lymphocyte T cytotoxique déclenche la mort d'une cellule indésirable. Dans ce cas, par un simple contact de membrane à membrane, la cellule immunitaire induit l'activation des récepteurs Fas et l'apoptose de la cellule ciblée. Les mécanismes induits par FasR peuvent être étendus à ceux d'autres récepteurs de mort tels que DR4/TRAIL-R1 et DR5/TRAIL-R2. L'activation de FasR par son ligand induit le recrutement d'un complexe appelé DISC (Death-Inducing Signaling Complex) composé de molécules adaptatrices FADD (Fas Associated Death Domain) et des procaspases initiatrices -8 et -10. FADD se lie par l'intermédiaire de son propre domaine de mort (Death Domain ou DD) aux DD des récepteurs Fas par des liaisons homotypiques électrostatiques20. FADD contient également un domaine effecteur de mort (Death Effector Domain ou DED) qui, par des liaisons homotypiques hydrophobes21, permet le recrutement des caspases initiatrices. La formation de ce complexe entraîne, par un effet de proximité, l'autoclivage des caspases -8 et -10 qui sont alors relarguées dans le cytosol sous une forme dimérique active. Cela permet l'activation séquentielle des caspases effectrices, parmi lesquelles la caspase-3. Les caspases initiatrices -8 et -10 peuvent activer la voie intrinsèque via le clivage de la protéine Bid et ainsi amplifier le signal apoptotique22. Dans le cas de cellules dites « de type 1 », le déclenchement de l'apoptose n'est pas dépendante de la voie intrinsèque. Inversement, dans les cellules dites « de type 2 », l'activation de la voie intrinsèque est nécessaire à l'apoptose et son blocage résulte en la résistance des cellules à Fas.
Voie intrinsèque[modifier | modifier le code]
Par opposition à la voie extrinsèque, la voie intrinsèque (ou voie mitochondriale) de l'apoptose est généralement induite par des signaux internes à la cellule. Par exemple, cette voie est déclenchée par l'activation de p53 lors des dommages importants à l'ADN. L'activation de cette voie repose principalement sur la formation de pores de transition de perméabilité dans la membrane des mitochondries par l'ouverture du PTPC (Permeability Transition Pore Complex), un complexe multiprotéique de la membrane interne mitochondriale. Ces pores sont des canaux oligo-protéiques constitués au niveau de la membrane externe par la porine (ou VDAC : Voltage Dependent Anion Channel) et sur la membrane interne par l'ANT (Adenine Nucléotide Translocator). Cette phase d'activation s'accompagne d'une diminution du potentiel transmembranaire mitochondrial (Delta Psi m), suivi du gonflement de la matrice mitochondriale, d'une interruption du métabolisme énergétique aérobique et d'un stress oxydatif. Selon les modèles, il y a rupture ou ouverture de la mitochondrie, ce qui permet la libération dans le cytosol de molécules pro-apoptotiques normalement mitochondriales, telles que le cytochrome c, Smac/DIABLO, OMI/HtrA2, l'endonucléase-G ainsi que l’Apoptosis Inducing Factor (AIF). La phase de perméabilisation de la membrane mitochondriale n'est pas encore pleinement comprise. Néanmoins, celle-ci est décrite pour être sous le contrôle d'interactions complexes et dynamiques entre les membres pro- et anti-apoptotiques de la famille de Bcl-223. Les membres anti-apoptotiques (Bcl-2, Bcl-xL, Mcl-1) forment des hétérodimères avec les membres pro-apoptotiques Bax et Bak, contrebalancent leur activité et permettent la stabilité de la mitochondrie. Lorsque la mitochondrie est activée, par exemple lors d'une activation de FasR et par l'intermédiaire de Bid, celui-ci intéragit et active directement Bax et Bak. Cela induit la perte d'interaction entre Bax, Bak et les membres anti-apoptotiques de la famille de Bcl-2, leur oligomérisation, la formation des pores et le relarguage des protéines mitochondriales24. Une fois devenus cytosoliques, les facteurs pro-apoptotiques mitochondriaux vont avoir des cibles et des effets spécifiques. Le cytochrome c cytosolique s'associe à APAF1 et la procaspase-9 pour former un complexe nommé apoptosome. La caspase-9 est activée au sein de ce complexe et est capable dʼactiver à son tour les caspases effectrices comme la caspase-325. La procaspase-9 a plus dʼaffinité pour lʼapoptosome que la caspase-9 active ce qui permet une rotation/activation des procaspases-9 au sein d'un même apoptosome26. Smac/DIABLO et OMI/HtrA2 ciblent et inhibent les protéines de la famille des IAP (Inhibitor of apoptosis) favorisant ainsi l'activité des caspases27,28. Le facteur AIF est redistribué vers le cytosol puis vers le noyau cellulaire pour induire une mort par apoptose qui a la particularité d'être indépendante des caspases et ne nécessiter aucun autre intermédiaire29.
Fragmentation de l'ADN | modifier le code]
Durant l’apoptose, l’ADN est digéré de façon très spécifique en fragments dont les tailles sont des multiples de 180 paires de bases, ce qui cause une distribution très caractéristique des fragments d’ADN en « échelle » lorsqu'ils sont séparés par électrophorèse suivant leur taille. Cette taille est révélatrice de l'espacement entre deux nucléosomes consécutifs. Cette digestion est assurée par les protéines CAD (Caspase Activated DNase), existant en temps normal sous forme inactive en association avec une ICAD (Inhibitor of Caspase Activated DNase). Cette ICAD cache la séquence NLS de CAD et le clivage de cette association par une caspase va permettre à la protéine CAD de rentrer dans le noyau, qui jouera son rôle de DNase clivant l'ADN. La fragmentation de l'ADN est utilisée pour détecter des cellules en apoptose dans un tissu grâce à la technique du TUNEL (Terminal Transferase dUTP Nick End Labeling)30.
L'un des mécanismes de l'apoptose dans les cellules cardiaques post ischémiques semble consister en la nitration des protéines cellulaires par un excès de peroxynitrites31. Ces peroxynitrites induisent également l'apoptose des monocytes32 et des lymphocytes T33.
Par exemple quand les cellules ne reçoivent pas en permanence de leurs voisines des messages inhibant leur autodestruction, elles disparaissent spontanément.
Conséquences d'un dysfonctionnement de l'apoptose[modifier | modifier le code]
Maladies ou affections induites par le blocage de l'apoptose[modifier | modifier le code]
Les cellules cancéreuses sont généralement des cellules dans lesquelles ce mécanisme ne fonctionne plus. Elles survivent et se multiplient en dépit d'anomalies génétiques survenues au cours de la vie de la cellule, alors que normalement elles auraient dû être détruites par apoptose.
La réactivation du mécanisme d'apoptose a pu toutefois être obtenue chez des cellules cancéreuses de rat34.
Certains pathogènes empêchent l'induction de l'apoptose, comme HHV8 (herpesvirus responsable du sarcome de Kaposi), qui code la protéine v-FLIP, empêchant l'apoptose induite par les récepteurs de mort.
Certaines maladies neurodégénératives comme les tauopathies, sont également des maladies où les mécanismes apoptotiques sont impliqués, conduisant à la survie de la protéine tau pathogène qui peut alors s'accumuler anormalement, jusqu'à la mort de la cellule nerveuse. C'est le cas de la paralysie supranucléaire progressive, de la maladie d'Alzheimer, etc.
Maladies ou affections causées par l’activation intempestive de l’apoptose[modifier | modifier le code]
Des recherches récentes35 semblent montrer que le développement du sida en tant que maladie serait lié au déclenchement intempestif de l’apoptose des lymphocytes gérant la réponse immunitaire, ce qui permet le développement de maladies et infections opportunes. Cela ne remet pas en cause le rôle actif du virus VIH comme cause effective de cette maladie, bien que celui-ci soit bien détecté et tué par les lymphocytes.
Toutefois le blocage du virus par les anticorps produits par les lymphocytes conduirait le virus à produire avant sa destruction complète une réponse chimique de défense destinée à provoquer l’apoptose massive de tous les lymphocytes voisins, voire à faire fabriquer par les macrophages (qui absorberaient le virus neutralisé par les anticorps en même temps que le message chimique provoquant leur apoptose) cette réponse chimique qui provoquerait « à distance » le suicide de nombreux autres lymphocytes voisins alors même qu’ils n’ont jamais été directement en contact avec le VIH. En d’autres termes, le VIH provoquerait une réponse exacerbée du système immunitaire contre lui-même. C'est alors un effet « boule de neige », où un système morphologique est détourné de ses fonctions par une réponse non contrôlée, semblable à d’autres phénomènes auto-induits comme les allergies (elles aussi liées à un facteur déclenchant externe).
En provoquant cette réaction, une partie des copies du VIH parviendrait ainsi à échapper à l’action des lymphocytes T, dont un grand nombre se sont apoptosés après que quelques-uns d'entre eux seulement ont neutralisé de nombreux virus voisins. Cela expliquerait aussi pourquoi l'éradication totale du virus par le système immunitaire n’est pas possible sans une aide extérieure non sensible au phénomène de l’apoptose (une aide apportée par les médicaments anti-rétroviraux qui s'attaquent spécifiquement au VIH pour éviter que les lymphocytes s’en chargent en activant alors l'apoptose de leurs voisins par l'action ultérieure des macrophages éliminateurs)36.
La compréhension des mécanismes chimiques de l'apoptose pourrait ainsi pallier cette fragilité intrinsèque du système immunitaire, et permettre donc le développement d'un type de vaccin particulier, non destiné à activer la réponse immunitaire contre le VIH (puisque celle-ci a bien lieu naturellement et produit de nombreux anticorps) mais à bloquer le déclenchement intempestif de l'apoptose des lymphocytes T CD4 chargés de leur neutralisation (et de la neutralisation des autres sources d'infection). Dans le cas du sida, on ne sait pas exactement quel lymphocyte possède cette fragilité (dangereuse uniquement pour les autres types de cellules mais pas lui-même directement), mais on peut penser qu'elle se situe au niveau des macrophages chargés d'éliminer les virus neutralisés par les anticorps.
Ce comportement intempestif des mêmes macrophages (les poubelles de l’organisme qui peuvent générer par leur action des tas de produits toxiques et agents chimiques difficiles à éliminer isolément) est également impliqué dans d'autres types de réactions exacerbées de l’organisme comme certaines allergies (où cette réaction, très largement autoentretenue, se fait à destination d'autres types de cellules que les lymphocytes immunitaires), et est soupçonné également dans d'autres types de maladies dégénératives (qui possèdent aussi un facteur déclenchant externe, pas nécessairement de nature infectieuse) ou certaines réactions exacerbées face à un stress (par exemple l'extension des brûlures).
L'apoptose chez les plantes à fleurs (Angiospermes)[modifier | modifier le code]
Chez les angiospermes, l'apoptose est un processus majeur de l'immunité végétale, elle est observée en réponse aux stress abiotiques, et elle est considérée comme un élément clé du développement du gamétophyte37.
DOCUMENT wikipédia LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
