|
|
|
|
 |
|
Découverte d’un nouveau mode de communication des cellules de notre cerveau |
|
|
| |
|
| |
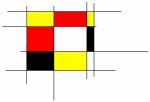
Découverte d’un nouveau mode de communication des cellules de notre cerveau
09 SEP 2021 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Une image en tissu fixé de cervelet de souris adulte, avec une cellule microgliale en vert contactant des nœuds de Ranvier en rouge, avec les paranœuds (zone d’ancrage de l’extrémité des couches de myéline, de part et d’autre du nœud) en bleu. © Inserm/Desmazieres Anne
Le cerveau révèle petit à petit les mystères de son fonctionnement. Outre l’étude des neurones, les chercheurs et chercheuses s’intéressent de plus en plus au rôle d’autres types de cellules du système nerveux qui aident les neurones dans leurs tâches quotidiennes. Une étude conduite par des scientifiques de l’Inserm, du CNRS, de l’AP-HP et de Sorbonne Université, regroupés au sein de l’Institut du Cerveau à l’hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP, montre pour la première fois une interaction entre les neurones et les microglies, des cellules immunitaires présentes dans le cerveau. Ce mode de communication jusqu’alors inconnu pourrait être clé pour mieux comprendre les mécanismes de réparation du cerveau ainsi que des pathologies comme la sclérose en plaques. Les résultats font l’objet d’une publication dans la revue Nature Communications.
Dans notre système nerveux, la transmission de l’influx nerveux (messages nerveux) se fait par le biais des prolongements des neurones, les axones, entourés d’une gaine isolante appelée myéline. Les nœuds de Ranvier, de petits domaines intercalés entre les segments de myéline sont indispensables pour la diffusion rapide de l’information, mais ils sont aussi une plaque tournante d’interactions cellulaires dans le cerveau.
Des études antérieures avaient déjà montré que certains types de cellules du cerveau, comme les oligodendrocytes et les astrocytes, formaient des contacts avec les neurones au niveau de ces nœuds de Ranvier. En revanche, les interactions avec un autre type de cellules essentielles du cerveau, les microglies, n’avait pas été explorées. Ces cellules immunitaires jouent pourtant un rôle clé de protection du cerveau ainsi que dans des processus régénératifs comme la remyélinisation, la reformation de la gaine de myéline, qui est atteinte dans des pathologies comme la sclérose en plaques.
Une étude conduite à l’Institut du Cerveau par la chercheuse Inserm Anne Desmazières et ses collègues Rémi Ronzano et Thomas Roux dans l’équipe de Catherine Lubetzki (AP-HP/Sorbonne Université) montre pour la première fois que des contacts et une communication existent entre les neurones et les cellules microgliales au niveau des nœuds de Ranvier.
Grâce à des études menées sur des modèles murins ex-vivo (cultures tissulaires) et in-vivo, notamment par des approches d’imagerie en temps réel permettant d’observer la dynamique de ces contacts, mais également sur du tissu humain, les chercheurs ont révélé une interaction particulièrement stable entre ces deux types de cellules, et un dialogue renforcé dans un contexte de régénération de la myéline. Ils ont également identifié les mécanismes sous-jacents à ce dialogue. C’est l’activité neuronale qui est le médiateur de l’interaction et la renforce.
Les microglies sont capables de « lire » l’information qui arrive au niveau des nœuds de Ranvier sous la forme de signal ionique, modulant ainsi leur état et leur interaction avec le neurone. Une altération de ce signal ionique peut maintenir les microglies dans un état pro-inflammatoire, les empêchant de jouer leur rôle pro-régénératif et pro-remyélinisant.
Dans le cas de la sclérose en plaques, cette découverte ouvre plusieurs pistes de recherche pour mieux comprendre la pathologie, notamment celle de l’impact des signaux inflammatoires existant dans cette maladie sur le dialogue neurone-microglie et le potentiel pro-remyélinisant de la microglie. La découverte de ce dialogue est d’autant plus intéressante que des thérapies à l’essai dans la sclérose en plaques tentent aujourd’hui d’agir sur la physiologie de ces microglies afin de favoriser leur caractère pro-régénératif.
Ce nouveau mode de communication mis en évidence pose aussi la question de l’impact de l’activité neuronale sur le comportement des microglies. En effet, de nombreuses pathologies neurologiques, dont l’épilepsie, sont associées à des altérations de l’activité des neurones, et les conséquences de cette altération sur les cellules microgliales sont encore à ce jour inconnues.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Identification d’un mécanisme moléculaire commun à la schizophrénie et au trouble bipolaire |
|
|
| |
|
| |

Identification d’un mécanisme moléculaire commun à la schizophrénie et au trouble bipolaire
11 OCT 2017 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
©Fotolia
Une équipe de recherche en psychiatrie au CEA-Neurospin, avec l’Institut Mondor de Recherches Biomédicales (INSERM) et les hôpitaux universitaires Henri-Mondor AP-HP, a montré qu’un variant génétique associé à de multiples troubles psychiatriques altère un réseau préfronto-limbique, ce qui augmenterait le risque de développer la schizophrénie ou un trouble bipolaire. Les résultats de cette étude sont publiés en ligne le 2 octobre 2017 dans Journal of Neuroscience.
Les auteurs ont étudié une variation allélique du gène SNAP25, impliquée dans la neurotransmission et associée à la schizophrénie, au trouble bipolaire mais également à l’hyperactivité/trouble de l’attention.
Les chercheurs ont combiné une étude d’association génétique chez 461 patients atteints de schizophrénie, une construction génétique in vitro et une approche dite d’« imagerie génétique[1] » dans deux cohortes, la première comprenant 71 sujets dont 25 patients bipolaires, la seconde comprenant 121 sujets sains. Ils ont en outre interprété l’expression génétique post mortem de SNAP25 à partir de tissu cérébral de patients schizophrènes.
Les résultats révèlent que la variation du gène SNAP25 change l’expression de la protéine associée dans le cerveau, ce qui impacterait le traitement de l’information entre les régions cérébrales impliquées dans la régulation des émotions. En lien avec ce mécanisme, l’étude d’imagerie génétique, combinant IRM anatomique et fonctionnelle de repos, montre que dans les deux cohortes, le variant à risque est associé à un plus grand volume d’une zone cérébrale, l’amygdale, et une connectivité fonctionnelle préfronto-limbique altérée.
Cette étude confirme l’existence d’un facteur de risque commun à la schizophrénie et au trouble bipolaire : la variation du gène SNAP25. Ces maladies très fréquentes touchent chacune 1 % de la population adulte et sont handicapantes. En plus d’apporter un éclairage sur leur mécanisme, les résultats de cette étude suggèrent l’existence de symptômes potentiellement présents chez des patients ayant des maladies variées dans lesquels le gène est impliqué.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Nouvelles anomalies cérébrales associées à la maltraitance infantile |
|
|
| |
|
| |
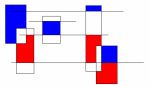
Nouvelles anomalies cérébrales associées à la maltraitance infantile
20 JAN 2022 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE | SANTÉ PUBLIQUE
Immunomarquage de neurones à parvalbumine en vert entourés par des filets perineuronaux en rouge dans le cortex préfrontal humain. © Arnaud Tanti/Inserm
En collaboration avec une équipe canadienne, des scientifiques de l’Inserm et de l’Université de Tours, au sein de l’unité 1253 Imagerie & Cerveau[1], ont montré sur des échantillons cérébraux post-mortem que les victimes de maltraitance infantile présentent des caractéristiques cérébrales particulières. Les équipes ont ainsi mis en évidence pour la première fois chez l’Homme, une augmentation du nombre et une maturation plus importante des filets perineuronaux, des structures protéiques denses entourant les neurones. Chez l’animal, ce phénomène régule la plasticité du cerveau en freinant le remodelage des réseaux neuronaux. Ce travail suggère que la maltraitance pourrait modifier durablement les trajectoires développementales de certaines régions cérébrales avec des effets potentiels sur la santé psychologique. L’étude est publiée dans le journal Molecular Psychiatry.
La maltraitance infantile a des effets sur le développement psychologique avec notamment un risque accru de dépression et de suicide au cours de la vie. Violences sexuelles, physiques ou encore négligence chronique pendant l’enfance ou l’adolescence sont suspectées d’entrainer des modifications structurelles et fonctionnelles durables sur le cerveau. C’est en effet au cours de ces périodes que les traits de personnalité, les modèles d’attachement, les fonctions cognitives et les réponses émotionnelles sont façonnés par ce que nous vivons, y compris les traumatismes.
Pour mieux comprendre les modifications neurobiologiques associées à la maltraitance infantile, des chercheurs et chercheuses de l’Inserm et de l’université de Tours, en collaboration avec l’université McGill University – Douglas Mental Health University Institute, à Montréal au Canada, se sont intéressés au cortex préfrontal ventromédian, une région cérébrale régulant les réponses émotionnelles. Ils ont tout particulièrement étudié les « filets périneuronaux », des structures particulièrement compactes et denses qui encerclent certains neurones, en particulier ceux à parvalbumine, dont l’action inhibitrice participe au contrôle de l’activité de larges ensembles de neurones.
Les filets périneuronaux apparaissent au cours de la petite enfance et se développent jusqu’à la fin de l’adolescence, augmentant en taille et en nombre. Chez l’animal, leur développement est une étape importante de la maturation cérébrale. Leur apparition marque en effet la fermeture de « périodes critiques » de plasticité pendant lesquelles le développement de la circuiterie neuronale peut être facilement modifiée par les expériences.
Les chercheurs estiment que ces filets périneuronaux pourraient jouer un rôle en cas de traumatisme pendant l’enfance, en figeant les réseaux neuronaux associés à ces souvenirs, prédisposant à des troubles dépressifs ou comportementaux par la suite.
Des filets périneuronaux plus denses
Pour étudier ces structures, les chercheurs ont analysé des coupes de cerveau post-mortem d’adultes (issus de dons de cerveau sur accord des familles), qui s’étaient suicidés au cours d’un épisode de dépression majeure. Sur les 28 sujets concernés, 12 sujets avaient eu une histoire lourde de maltraitance infantile. Ces coupes ont par ailleurs été comparées avec celles de sujets contrôles, décédés de mort naturelle et sans antécédent de maltraitance ou de maladie psychiatrique. Différents types d’analyses ont abouti à plusieurs observations.
Tout d’abord, chez les sujets maltraités au cours de l’enfance, les filets périneuronaux étaient plus denses et plus nombreux que ceux des autres individus. Ils présentaient en outre des caractéristiques de maturation plus importante, notamment un développement structurel accru autour des neurones à parvalbumine Enfin, les chercheurs ont montré que les cellules qui produisent les principales protéines qui composent les filets périneuronaux sont les progéniteurs d’oligodendrocytes, des cellules présentes partout dans le cerveau.
Les chercheurs vont maintenant préciser chez la souris, les conséquences de ces observations, notamment sur la persistance des souvenirs traumatiques liés à l’adversité précoce.
« Ces observations renforcent l’hypothèse d’une corrélation entre stress précoce et développement accru des filets périneuronaux. Reste à découvrir s’il existe un lien causal, c’est-à-dire si ces changements contribuent au développement de comportements associés à la maltraitance et de quelle façon. On pourrait peut-être à plus long terme envisager de manipuler les filets périneuronaux pour permettre de restaurer une certaine plasticité et réduire l’impact du traumatisme et le risque psychiatrique par la suite », explique Arnaud Tanti, chercheur Inserm et premier auteur de ces travaux.
[1] UMR 1253, iBrain, Inserm, Université de Tours
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Les tumeurs cérébrales |
|
|
| |
|
| |
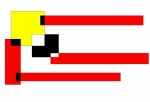
Les tumeurs cérébrales
Qu'est-ce qu'une tumeur cérébrale?
Une tumeur du cerveau est une masse résultant de la multiplication anarchique de cellules anormales. On ne sait pas, à l'heure actuelle, quelle est l'influence exacte de l'environnement du ou de la patient-e et de son bagage héréditaire sur le développement de la tumeur. Très rarement, elle apparaît en relation avec une maladie transmise génétiquement.
Certaines tumeurs cérébrales sont peu agressives, c’est-à-dire qu’elles sont constituées de cellules qui croissent lentement. Ces tumeurs dites bénignes peuvent être simplement surveillées radiologiquement ou être extirpées chirurgicalement. D'autres tumeurs sont malignes, c’est-à-dire qu’elles sont constituées de cellules se divisant relativement vite. Ces tumeurs croissent donc rapidement et peuvent envahir et endommager des zones importantes du cerveau. Elles peuvent être traitées par la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie ou une combinaison de ces différentes techniques.
En savoir plus
Quels sont les symptômes?
Une tumeur cérébrale peut se manifester de diverses façons, en fonction de son emplacement, de son volume ou de l’œdème qui y est associé.
Le ou la patient-e peut subir un ou plusieurs des symptômes suivants:
* maux de tête
* crises d’épilepsie
* vertiges et étourdissements
* déficits moteurs ou sensitifs
* nausées matinales ou vomissements
* troubles auditifs ou visuels.
Quelles sont les mesures diagnostiques?
Le médecin neuro-oncologue décide, en fonction de la situation de chaque patient-e, quels examens doivent être effectués. Il pourra recommander les mesures suivantes:
* un examen clinique
* des examens électrophysiologiques menés par le Service de neurologie, comme un électroencéphalogramme (EEG) pour analyser l’activité électrique du cerveau du ou de la
* patient-e
* des examens radiologiques menés par le Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle, comme le scanner à rayon X, l’imagerie par résonance magnétique (IRM), une spectroscopie par résonance magnétique ou une tomographie par émission de positrons (PET)
* une intervention chirurgicale menée au sein de notre service, comme une biopsie pour déterminer le stade de la tumeur et son comportement.
*
Comment se déroulent les traitements?
Dans la majorité des cas, une équipe multidisciplinaire élabore la meilleure approche à adopter afin de traiter la tumeur cérébrale. Des neurochirurgiens, des neuro-oncologues, des radio-oncologues et d’autres spécialistes se rencontrent une fois par semaine afin de partager les données médicales et radiologiques des différents patients et d'élaborer un plan de traitement à la lumière des informations suivantes:
* le type de la tumeur
* la taille et l'emplacement de la tumeur
* l’agressivité de la tumeur
* l’état physique, émotif et cognitif du ou de la patient-e
* s'il s'agit de traiter des métastases cérébrales, l’évolution de la tumeur primaire.
Le plan de traitement est ensuite discuté avec le ou la patient-e. Il peut inclure un traitement médicamenteux, une intervention chirurgicale, une radiochirurgie par Gamma Knife, une radiothérapie ou encore une chimiothérapie.
DOCUMENT chuv Lausanne LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
