|
|
|
|
 |
|
Troubles du neurodéveloppement chez l’enfant : un nouveau gène mis en cause |
|
|
| |
|
| |
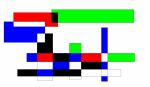
Troubles du neurodéveloppement chez l’enfant : un nouveau gène mis en cause
27 JUIN 2023 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE ET BIO-INFORMATIQUE | PHYSIOPATHOLOGIE, MÉTABOLISME, NUTRITION
© ADN double hélice – National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health.
Face aux troubles neurodéveloppementaux infantiles, comment sortir de l’impasse thérapeutique ? La réponse pourrait bien se trouver dans les gènes du protéasome, une machinerie intracellulaire responsable de l’élimination des protéines défectueuses de la cellule. Une équipe de recherche de l’Inserm, du CNRS, de Nantes Université et du CHU de Nantes, au sein de l’Institut du thorax et en collaboration avec des équipes internationales, a étudié le génome de 23 enfants atteints de troubles du neurodéveloppement. Elle a ainsi mis en évidence quinze mutations du gène PSMC3 du protéasome susceptibles d’être impliquées dans leur maladie. Ces travaux, parus dans Science Translational Medicine, ouvrent de nouvelles perspectives de recherche pour mieux comprendre ces maladies et identifier des traitements.
L’origine d’un trouble du neurodéveloppement chez l’enfant demeure encore aujourd’hui difficile à identifier et les patients et leur famille sont souvent confrontés à plusieurs années d’errance diagnostique.
Une équipe de recherche de l’Institut du thorax (Inserm/CNRS/Nantes Université/CHU de Nantes), menée par Stéphane Bézieau, chef du service de génétique médicale du CHU de Nantes, travaille depuis plusieurs années sur la génétique des troubles du neurodéveloppement chez l’enfant. Ses travaux ont notamment mené à identifier le rôle d’un gène appelé PSMD12 dans une maladie neurodéveloppementale infantile. Ce gène s’exprime dans un grand complexe de protéines situé dans les cellules et baptisé protéasome.
Le protéasome fonctionne comme une sorte d’« éboueur » au sein de la cellule. En permettant l’élimination des protéines défectueuses qu’elle contient, il joue un rôle déterminant dans un grand nombre de processus cellulaires. Les altérations qui peuvent apparaître sur certains des gènes le constituant sont susceptibles d’impacter sa capacité à dégrader les protéines défectueuses. Leur accumulation a pour conséquence l’apparition de pathologies très variées.
Dans de nouveaux travaux[1], en collaboration avec des équipes internationales, l’équipe de recherche a continué à explorer les liens entre mutations des gènes du protéasome et maladies du neurodéveloppement. Elle s’est cette fois plus spécifiquement intéressée au gène PSMC3 du protéasome et à son implication dans les troubles neurodéveloppementaux de 23 jeunes patients européens, américains et australiens, atteints de symptômes neurologiques (retard de langage, déficience intellectuelle ou problèmes comportementaux) fréquemment associés à des anomalies du visage et à des malformations du squelette, du cœur et d’autres organes.
Grâce au séquençage complet du génome de ces patients, les chercheuses et chercheurs ont ainsi mis en évidence quinze mutations du gène PSMC3 susceptibles d’expliquer l’origine des symptômes.
« Il est rapidement apparu que les cellules de patients porteuses d’un gène PSMC3 défaillant se retrouvaient littéralement surchargées de protéines inutiles et toxiques pour elles », explique Frédéric Ebstein, chercheur Inserm et premier auteur de l’étude. Il compare ce phénomène à celui observé dans certaines maladies neurodégénératives liées à l’âge, telles que les maladies d’Alzheimer ou de Parkinson.
« La découverte de l’implication d’un second gène dans les troubles du neurodéveloppement infantile apporte un éclairage inédit sur ce groupe de maladies rares encore inconnu il y a peu, précise le chercheur Sébastien Küry, ingénieur au CHU de Nantes, qui a co-signé ces travaux. Ce travail, associé à la découverte récente par l’équipe d’autres gènes impliqués [mais encore non publiés à ce jour, ndlr.], ouvre des perspectives majeures dans la compréhension de ce groupe de maladies neurodéveloppementales ainsi que des perspectives de traitement », conclut-il.
[1]Ces travaux sont soutenus financièrement par l’Agence nationale de la recherche (ANR), l’Union européenne (European Joint Programme on Rare Diseases) et la compagnie d’assurance AXA.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
AVC : nouvelles perspectives d’innovation thérapeutique et de prédiction de risques |
|
|
| |
|
| |
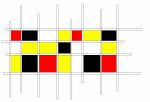
AVC : nouvelles perspectives d’innovation thérapeutique et de prédiction de risques
30 SEP 2022 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE ET BIO-INFORMATIQUE
L’AVC est la deuxième cause de décès dans le monde. © Adobe Stock
Une grande étude génomique internationale sur les accidents vasculaires cérébraux (AVC) a permis de révéler de nouveaux gènes impliqués dans la genèse de cette maladie. Cette étude fournit des informations importantes pour prédire le risque génétique d’AVC, notamment pour la première fois dans des populations d’ascendance non européenne. Elle permettra, à terme, de développer des approches personnalisées pour la prévention et le développement thérapeutique. Les résultats de cette étude génomique sur les AVC, la plus grande réalisée à ce jour et portée par des chercheurs de l’université de Bordeaux, de l’Inserm et du CHU de Bordeaux, ont été publiés en ligne dans la revue Nature.
L’AVC est la deuxième cause de décès dans le monde, responsable d’environ 12 % du nombre total de décès et un contributeur majeur aux années de vie perdues ou vécues avec une incapacité. L’incidence et la gravité des AVC sont particulièrement élevées dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où surviennent 70 % de l’ensemble des décès par AVC. Il est donc extrêmement important d’adopter une perspective globale dans la recherche visant à améliorer la prévention et le traitement de cette maladie.
L’étude, publiée aujourd’hui dans Nature, a été réalisée sur des échantillons d’ADN de près de 200 000 patients victimes d’AVC et environ 2 millions d’individus témoins d’origines géographiques très diverses. Les participants étaient d’ascendance européenne, asiatique de l’Est et du Sud, africaine et latino-américaine (un tiers des patients victimes d’AVC n’étaient pas européens). Ils sont issus de nombreuses cohortes et biobanques hospitalières et populationnelles, ainsi que de cinq essais cliniques.
Des cibles médicamenteuses prometteuses
Cette recherche révèle de nouveaux gènes impliqués dans la genèse des AVC de façon causale les mettant en évidence comme des cibles médicamenteuses potentielles en vue de prévenir ou traiter les AVC. Elle a été menée par des membres du consortium GIGASTROKE, impliquant des réseaux internationaux et des chercheurs de plus de 20 pays, et a été co-dirigée par deux centres de recherche de l’université de Bordeaux et de l’Université LMU de Munich (Allemagne).
« La contribution de participants d’ascendances ethniques diverses a été d’une importance primordiale, améliorant notre capacité à détecter de nouvelles associations génétiques, affinant notre compréhension de leur signification biologique, et améliorant la transférabilité des outils génétiques de prédiction de risque d’une ascendance ethnique à l’autre », explique Stéphanie Debette, professeur d’épidémiologie et neurologue à l’université de Bordeaux, à l’Inserm et au CHU de Bordeaux, directrice du centre de recherche Bordeaux Population Health et principale autrice de cette étude.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Une avancée majeure sur la génétique et les facteurs de risque d’une forme d’infarctus qui touche majoritairement les femmes |
|
|
| |
|
| |

Une avancée majeure sur la génétique et les facteurs de risque d’une forme d’infarctus qui touche majoritairement les femmes
31 MAI 2023 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | PHYSIOPATHOLOGIE, MÉTABOLISME, NUTRITION | SANTÉ PUBLIQUE
La SCAD est une forme d’infarctus touchant essentiellement les femmes. © Fotalia
La dissection spontanée de l’artère coronaire, plus connue sous l’acronyme SCAD, est une cause d’infarctus dont 9 victimes sur 10 sont des femmes dans la quarantaine, en apparente bonne santé. Encore mal comprise, elle est souvent sous-diagnostiquée, ce qui complique la prise en charge alors qu’elle pourrait représenter jusqu’à un tiers des cas d’infarctus chez les femmes de moins de 60 ans. Afin de comprendre les causes génétiques et les mécanismes biologiques à son origine, une nouvelle étude internationale dirigée par Nabila Bouatia-Naji, directrice de recherche à l’Inserm au Paris Centre de recherche cardiovasculaire – PARCC (Inserm/Université Paris Cité) a été mise en place. Les résultats obtenus montrent que les causes génétiques qui définissent le risque de la SCAD sont très nombreuses et réparties sur l’ensemble du génome des patients. L’étude identifie 16 régions génomiques associées à un risque plus élevé de SCAD, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des mécanismes biologiques sous-jacents à cette maladie. L’étude est parue le 29 mai 2023 dans Nature Genetics.
Contrairement à la majorité des maladies cardiovasculaires comme l’infarctus de myocarde, qui affectent principalement les hommes âgés et/ou en surpoids, la dissection spontanée de l’artère coronaire (SCAD) est une forme d’infarctus qui touche les femmes dans 9 cas sur 10. Celles-ci sont souvent dans la quarantaine, même si la maladie peut également survenir plus tôt, dans l’année qui suit un accouchement, ou plus tard, pendant la transition vers la ménopause. De plus en plus reconnue comme une forme importante d’infarctus au sein de cette population, la SCAD demeure toutefois encore assez mal documentée du fait notamment d’un manque de données et d’une méconnaissance des facteurs de risque qui lui sont spécifiques, notamment génétiques.
Dans les 20 dernières années, des progrès considérables ont été réalisés pour détailler les mécanismes du développement de pathologies coronaires comme l’athérosclérose et sur les formes très rares et syndromiques des maladies cardiovasculaires. De telles connaissances sont primordiales pour mieux appréhender ces pathologies et concevoir des stratégies de prévention et de traitements améliorés et personnalisés.
Néanmoins, la recherche a pris un retard important dans la compréhension des maladies comme la SCAD qui touchent des femmes à des étapes charnières de leur vie. Il est donc essentiel de s’intéresser maintenant à cette maladie cardiovasculaire si peu étudiée et au risque génétique qui lui est propre.
L’équipe de la généticienne Inserm Nabila Bouatia-Naji donc mené un travail de grande ampleur sur le sujet, en coordonnant une méta-analyse de 8 études d’association pangénomique (en anglais genome-wide association study, GWAS)[1]. En comparant les données génétiques de plus de 1900 patients et d’environ 9300 personnes non-malades, les scientifiques ont identifié 16 régions génomiques (ou loci) de prédisposition génétique à la SCAD.
Vers une meilleure compréhension des mécanismes biologiques
Ce travail a d’abord permis de montrer que les variations génétiques que l’on retrouve le plus souvent chez les patient(e)s ayant survécu à la SCAD jouent un rôle dans la composition du « ciment » qui entoure les cellules de l’artère coronaire.
Cependant, un des gènes identifiés est F3 et il code le facteur de coagulation tissulaire. En temps normal, le facteur tissulaire initie la coagulation au niveau des cellules afin de résorber d’éventuelles hématomes. Les résultats de l’étude suggèrent qu’un défaut d’expression de F3 est souvent retrouvé chez les patient(e)s ce qui constitue une cause potentielle d’une mauvaise réparation des artères, pouvant aboutir à leur déchirure. La mauvaise résorption de l’hématome serait donc une cause génétique de l’infarctus qui était inconnue jusqu’à présent.
L’un des autres objectifs de cette étude a été de positionner la SCAD par rapport à d’autres maladies cardiovasculaires afin de mieux connaître ses spécificités épidémiologiques. En utilisant les données qui déterminent les facteurs de risque cardiovasculaires génétiques et des méthodes de statistiques astucieuses, les scientifiques ont mis en évidence un lien robuste entre la pression artérielle élevée et le risque de la SCAD, tout en confirmant que le cholestérol élevé, le surpoids et le diabète de type 2 n’avaient aucun impact sur ce risque.
« Ce résultat pourrait donc s’avérer intéressant sur le plan clinique à plus long terme, pour encourager les médecins à surveiller de près l’évolution de la pression artérielle chez les patients et patientes qui présentent un risque génétique accru de SCAD », explique Nabila Bouatia-Naji, directrice de recherche à l’Inserm et dernière auteure de l’étude.
Finalement, ce travail met en évidence un lien génétique entre l’infarctus dû à la SCAD et l’infarctus dû à l’athérosclérose (aussi appelé infarctus athéromateux). En effet, les chercheurs ont montré qu’un grand nombre de régions génomique de prédisposition à la SCAD sont partagées avec celles de l’infarctus athéromateux.
Cependant, même s’il s’agissait des mêmes variantes génétiques, les allèles[2] qui sont plus fréquents chez les patients atteints de SCAD sont systématiquement décrites comme moins fréquents chez les sujets atteints de l’infarctus athéromateux.
« Ce résultat est très surprenant, car ils montrent que selon si l’on est face à une jeune femme sans facteurs de risques, ou un homme plus âgé et présentant des facteurs de risque, les causes génétiques et les mécanismes biologiques associés à leur infarctus peuvent être opposés. Nos résultats alertent sur le besoin de mieux comprendre les spécificités des maladies cardiovasculaires chez les femmes jeunes afin d’améliorer leur suivi qui est actuellement identique à celui de l’infarctus athéromateux », conclut Nabila Bouatia-Naji.
Forte de ces résultats, l’équipe travaille désormais au développement de nouveaux modèles cellulaires et animaux qui rendent mieux compte des facteurs génétiques impliqués dans la maladie, afin notamment de mieux étudier leur impact sur l’état des artères. Avec toujours un objectif en tête à plus long terme : celui de faire sortir de l’ombre une maladie cardiovasculaire essentiellement féminine et trop souvent négligée, et d’améliorer la manière dont elle est comprise et prise en charge.
[1] Étude d’association génétique à grande échelle (Genome-Wide Association Studies), largement pratiquées depuis plusieurs années, qui consiste à analyser le génome entier de milliers de personnes saines et malades, afin d’identifier les régions génomiques dans lesquelles doivent se trouver des gènes influençant la vulnérabilité des personnes à l’affection en cause
[2] Un allèle est une version d’une variante génétique résultant d’un changement dans la séquence de l’ADN. Toute séquence d’ADN peut avoir plusieurs allèles, qui déterminent souvent l’apparition de caractères héréditaires différents.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Une étude de cohorte permet d’identifier une cause génétique d’une forme rare du syndrome de Cushing induit par l’alimentation |
|
|
| |
|
| |

Une étude de cohorte permet d’identifier une cause génétique d’une forme rare du syndrome de Cushing induit par l’alimentation
05 NOV 2021 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE ET BIO-INFORMATIQUE | PHYSIOPATHOLOGIE, MÉTABOLISME, NUTRITION
L’équipe composée de chercheurs et chercheuses du service d’endocrinologie et des maladies de la reproduction de l’hôpital Bicêtre AP-HP, de l’Inserm et de l’Université Paris-Saclay, a mené des travaux, coordonnés par le Professeur Peter Kamenický, pour étudier la cause génétique de l’hyperplasie bilatérale macronodulaire des surrénales avec syndrome de Cushing induit par l’alimentation. Cette maladie rare touche les deux glandes surrénales situées au-dessus des reins et entraine une surproduction du cortisol, une hormone stéroïde dont l’excès a des conséquences néfastes pour l’organisme. Les chercheurs ont pu déterminer l’explication moléculaire de la survenue de cette maladie 30 ans après sa description initiale. Ces travaux ont fait l’objet d’une publication le 13 octobre 2021 dans la revue The Lancet Diabetes & Endocrinology.
Cette forme rare du syndrome de Cushing surrénalien, étudiée par ces chercheurs, est due à l’expression anormale du récepteur du GIP (Glucose-dependent insulinotropic peptide), dans les deux glandes surrénales des patients. Le GIP est une hormone produite par l’intestin grêle en réponse à l’ingestion d’aliments. Chez les patients atteints de cette forme particulière du syndrome de Cushing, les concentrations de cortisol augmentent anormalement après chaque prise alimentaire. Les patients atteints de cette maladie développent les signes cliniques typiques du syndrome de Cushing tels que la prise de poids associée à une atrophie musculaire, l’hypertension artérielle, le diabète sucrée, l’ostéoporose et la dépression. La pathologie est associée à une augmentation de la mortalité, surtout des causes cardiovasculaires.
Dans cette étude internationale impliquant les chercheurs de six pays, et reposant notamment sur une collaboration étroite franco-québécoise, l’équipe rapporte que l’hyperplasie macronodulaire des surrénales GIP-dépendante, dans ses formes familiales comme sporadiques, est une maladie génétique, causée par des mutations germinales de Lysine Déméthylase 1A (KDM1A) avec une perte secondaire du second locus de KDM1A, comportant la seconde copie du gène, dans le tissu surrénalien. KDM1A agit principalement comme un répresseur transcriptionnel (i.e. un régulateur qui empêche un gène d’être exprimé), la perte de sa fonction aboutit à une dérégulation d’expression de différents gènes dans le tissu surrénalien, incluant le récepteur du GIP mais également d’autres récepteurs couplés aux protéines G.
Cette découverte permettra de proposer un conseil génétique et une détection plus précoce de cette maladie rare aux patients et à leurs apparentés. Les maladies rares sont en général sous-diagnostiquées. Ceci est d’autant plus important que les variations pathogènes de KDM1A prédisposent également au myélome et à d’autres types de cancer.
De plus, ce nouveau rôle de KDM1A comme régulateur épigénétique de l’expression du récepteur du GIP et d’autres récepteurs couplés aux protéines G pourrait avoir des implications pharmacologiques.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
