|
|
|
|
 |
|
Traitement du cancer : identification des vaisseaux sanguins qui permettent aux lymphocytes tueurs d’accéder aux tumeurs et de les détruire |
|
|
| |
|
| |
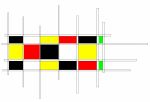
Traitement du cancer : identification des vaisseaux sanguins qui permettent aux lymphocytes tueurs d’accéder aux tumeurs et de les détruire
03 FÉV 2022 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | CANCER
Visualisation en microscopie de lymphocytes (en vert) en train de se faufiler à travers un vaisseau HEV de tumeur (en rouge) au cours du traitement par immunothérapie anti-PD-1 plus anti-CTLA-4. La flèche blanche indique un lymphocyte qui quitte la circulation sanguine et entre dans la tumeur (en noir). © Elisabeth BELLARD et Jean-Philippe GIRARD – IPBS (CNRS/UT3 Paul Sabatier)
L’immunothérapie, une stratégie thérapeutique visant à augmenter l’activité du système immunitaire pour reconnaître et détruire les cellules cancéreuses, a révolutionné le traitement du cancer ces dix dernières années. Mieux comprendre comment fonctionne cette approche thérapeutique, et en particulier comment les lymphocytes tueurs accèdent aux tumeurs lors de l’immunothérapie, pourrait permettre d’améliorer l’efficacité des traitements. L’équipe de Jean-Philippe Girard, directeur de recherche Inserm à l’Institut de pharmacologie et de biologie structurale (CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier), en collaboration avec Gustave Roussy, vient de découvrir le rôle essentiel dans ce processus de vaisseaux sanguins particuliers, appelés vaisseaux HEV associés aux tumeurs. Les scientifiques sont parvenus à filmer pour la première fois les lymphocytes se faufilant à travers la paroi des vaisseaux HEV pour entrer dans les tumeurs. De plus, les chercheurs et chercheuses ont montré dans des modèles animaux qu’augmenter la proportion de vaisseaux HEV dans une tumeur, améliore l’efficacité de l’immunothérapie et conduit à l’élimination des tumeurs. Dans un dernier temps, ils ont constaté que la probabilité de guérison de patients atteints de mélanome métastatique (cancer de la peau) et traités par immunothérapie est augmentée lorsqu’un grand nombre de vaisseaux HEV sont présents dans les tumeurs. Les résultats de cette étude sont publiés dans le journal Cancer Cell du 3 février 2022[1].
L’immunothérapie avec les anticorps thérapeutiques représente une véritable révolution pour le traitement du cancer. Elle permet notamment de guérir certains patients atteints de mélanome métastatique (cancer de la peau), qui autrefois étaient condamnés. Malheureusement, l’immunothérapie ne fonctionne pas pour tous les patients ni pour tous les cancers. Une meilleure compréhension du mode d’action du traitement pourrait permettre de l’améliorer et de le rendre efficace chez un plus grand nombre de malades.
Les « lymphocytes tueurs », des globules blancs présents dans le sang, sont capables d’éliminer les cellules cancéreuses. Il est essentiel qu’un grand nombre de ces cellules tueuses puisse accéder aux tumeurs, afin de défendre l’organisme contre le cancer. L’équipe toulousaine lève le voile sur les mécanismes qui permettent aux lymphocytes tueurs de pénétrer dans les tumeurs pour les détruire, de façon spontanée ou suite au traitement par immunothérapie avec les anticorps anti-PD-1 plus anti-CTLA-4.
Les scientifiques ont découvert que les vaisseaux HEV – pour High Endothelial Veinule – des vaisseaux sanguins très particuliers, constituent la porte d’entrée majeure des lymphocytes dans les tumeurs. En utilisant des techniques sophistiquées de microscopie, les chercheurs ont pu filmer le passage des lymphocytes du sang vers la tumeur dans des modèles animaux. Pour la première fois, ils ont ainsi pu visualiser en direct et en temps réel les lymphocytes en train de se faufiler à travers la paroi des vaisseaux HEV afin d’accéder aux cellules cancéreuses présentes dans la tumeur. « Nous pensions que les vaisseaux HEV jouaient un rôle important pour l’entrée des lymphocytes dans la tumeur, mais nous avons été surpris de constater qu’ils en constituaient la porte d’entrée quasi exclusive », souligne Jean-Philippe Girard, directeur de recherche Inserm, dernier auteur de l’étude.
Les chercheurs ont ensuite observé dans leurs modèles que la présence d’un grand nombre de lymphocytes tueurs dans les tumeurs est associée à la présence d’un grand nombre de vaisseaux HEV. De plus, ils ont apporté la preuve de concept qu’augmenter la proportion des vaisseaux HEV dans une tumeur améliore l’efficacité de l’immunothérapie anti-PD-1 plus anti-CTLA-4 et conduit à l’élimination des tumeurs.
Enfin, en collaboration avec l’équipe de Caroline Robert à Gustave Roussy[2], les scientifiques se sont intéressés à des patients atteints de mélanome métastatique. Ils ont découvert que la présence d’un grand nombre de vaisseaux HEV dans les tumeurs est associée à une meilleure réponse à l’immunothérapie anti-PD-1 plus anti-CTLA-4.
Marquage des vaisseaux HEV (en marron) sur une coupe de tumeur d’un patient atteint de mélanome métastatique et traité par immunothérapie. © Jean-Philippe GIRARD – IPBS (CNRS/UT3 Paul Sabatier)
La prochaine étape pour les chercheurs sera de développer des traitements visant à augmenter la proportion de vaisseaux HEV dans les tumeurs, afin d’améliorer l’efficacité de l’immunothérapie, en permettant un recrutement massif de lymphocytes tueurs pour éradiquer les cellules cancéreuses.
« Nos travaux pourraient permettre à plus long terme d’améliorer le traitement par immunothérapie pour les patients atteints de mélanome métastatique et d’autres types de tumeurs solides. Ils ont aussi des implications sur le plan du pronostic, les cliniciens pouvant désormais s’intéresser aux vaisseaux HEV pour prédire la réponse d’un patient à l’immunothérapie », conclut Jean-Philippe Girard.
[1] Cette étude a été financée par la Fondation ARC, la FRM, l’INCa, l’ANR et le Labex TOUCAN
[2] Et également responsable d’équipe au sein de l’unité Inserm U981
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Le cervelet, une voie d’accès alternative pour traiter les mouvements involontaires provoqués par la maladie de Parkinson |
|
|
| |
|
| |

Le cervelet, une voie d’accès alternative pour traiter les mouvements involontaires provoqués par la maladie de Parkinson
09 JUIN 2022 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Neurone du cervelet (en rouge) projetant vers le site de genèse des mouvements involontaires dans la maladie de Parkinson. La stimulation intermittente des terminaisons nerveuses (en vert) dans un modèle de Parkinson chez la souris prévient l’apparition de ces mouvements. © Daniela Popa/Inserm
Dans une nouvelle étude, des chercheuses et chercheurs de l’Inserm, de l’ENS-PSL et du Collège de France, sous la supervision de Clément Léna et Daniela Popa, directeur et directrice de recherche Inserm, montrent que des stimulations depuis la surface du cerveau, au niveau du cervelet, suffisent à supprimer les mouvements involontaires ou dyskinésies liés à la maladie de Parkinson. Ces travaux qui ont été menés chez la souris font l’objet d’une publication dans la revue Nature Communication.
Des scientifiques de l’Inserm et de l’ENS-PSL ont entrepris de tester une voie thérapeutique alternative pour traiter ces mouvements anormaux dans un modèle animal de la maladie de Parkinson. Ils ont administré des stimulations spécifiques des cellules de Purkinje du cervelet depuis la surface du cerveau, au niveau du cervelet, quelques dizaines de secondes par jour. Celles-ci se sont révélées capables de supprimer les mouvements anormaux. Mieux encore, ce traitement a normalisé l’activité des circuits moteurs, y compris au niveau du site de genèse présumée de ces dyskinésies, au sein des ganglions de la base.
En collaboration avec des chercheurs du Collège de France, les scientifiques ont montré que ce traitement met en jeu des mécanismes de plasticité, qui perdurent pendant plusieurs jours voire semaines.
Ces stimulations de la surface du cervelet, administrables de façon non invasive, fournissent une voie d’accès nouvelle pour le traitement d’affections profondes dans le cerveau.
Les mécanismes cellulaires des plasticités restent à être identifiés.
L’équipe cherche maintenant à mieux comprendre et à optimiser ces pratiques pour reproduire leurs effets bénéfiques chez les patients. Enfin, une dernière étude[1] conduite par la même équipe, en collaboration avec des chercheurs Inserm et de l’Institut du Fer à Moulin, montre un effet bénéfique de ce type de traitement dans la dystonie, une maladie rare qui produit des contractions involontaires.
La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui induit des symptômes moteurs sévères suite à la disparition dans le cerveau de certains neurones situés profondément dans le cerveau et qui produisent de la dopamine. Dans les premières années de la maladie, les symptômes sont efficacement traités par un médicament appelé le levodopa, qui compense le déficit en dopamine. Par la suite, ce traitement induit des effets secondaires invalidants sous la forme de mouvements involontaires. Ils sont générés dans la région cible des neurones libérant de la dopamine, qui est une région peu accessible, et dont la stimulation pour éviter les mouvements anormaux nécessite des approches chirurgicales invasives.
[1] Hind Baba Aïssa, Romain W Sala, Elena Laura Georgescu Margarint, Jimena Laura Frontera, Andrés Pablo Varani, Fabien Menardy, Assunta Pelosi, Denis Hervé, Clément Léna, Daniela Popa : « Functional abnormalities in the cerebello-thalamic pathways in a mouse model of DYT25 dystonia. »
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
En France, un adulte sur quatre serait concerné par une forme de déficience auditive |
|
|
| |
|
| |
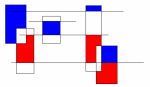
En France, un adulte sur quatre serait concerné par une forme de déficience auditive
17 JUIN 2022 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | SANTÉ PUBLIQUE
Cette étude sur la déficience auditive s’appuie sur les données de milliers de participants issus de la cohorte Constances. © Adobe Stock
La déficience auditive est un problème de santé publique qui touche des milliards de personnes, dans tous les pays. Toutefois, les données de prévalence (c’est-à-dire, schématiquement, leur fréquence dans la population), ainsi que celles décrivant le recours à des prothèses auditives, demeurent imprécises. Une nouvelle étude menée par une équipe de recherche de l’Inserm et d’Université Paris Cité au PARCC (Paris Cardiovascular Research Center, unité Inserm 970)[1], en collaboration avec l’AP-HP et l’hôpital Foch à Suresnes, montre pour la première fois qu’en France, 25 % des adultes sont touchés par une forme de déficience auditive. La déficience auditive invalidante, plus grave, concernerait 4 % des adultes. Cette prévalence varie avec l’âge et en fonction d’autres facteurs (niveau de vie, bruit au travail, pathologies cardiovasculaires…) qui sont décrits dans l’étude. Par ailleurs, les scientifiques indiquent que les appareils auditifs demeurent largement sous-utilisés, notamment chez les seniors. Ces résultats, qui s’appuient sur les données de milliers de participants issus de la cohorte Constances, sont publiés dans la revue JAMA Open Network.
Environ 1,5 milliard de personnes dans le monde sont concernées par une déficience auditive et les projections de l’OMS suggèrent que, d’ici 2050, elles seront 2,5 milliards. Il s’agit d’une problématique de santé publique majeure, d’autant que la déficience auditive est associée à une dégradation de la qualité de vie, à l’isolement social et à d’autres problèmes de santé tels que la dépression, le déclin cognitif ou encore la démence.
Cependant, il est encore difficile de prendre toute la mesure du problème et d’améliorer les mesures de prévention et le dépistage, car les données disponibles concernant la prévalence exacte de la déficience auditive, les caractéristiques des individus concernés et le recours à des prothèses auditives sont encore parcellaires.
Elles sont en effet le plus souvent dérivées d’études portant sur des petits échantillons de participants peu représentatifs, dont il est compliqué de tirer des généralités, et sur des données de surdité auto-rapportées et non mesurées.
Afin de disposer de données plus robustes permettant d’éclairer les politiques publiques, une équipe de recherche de l’Inserm, l’AP-HP, Université Paris Cité et l’hôpital Foch ont évalué la prévalence de la déficience auditive en France, en s’appuyant sur les données de 186 460 volontaires de la cohorte Constances, représentative de la population générale adulte, et chez qui la surdité a été mesurée à partir de tests auditifs.
La cohorte Constances
Constances est une grande cohorte épidémiologique française, constituée d’un échantillon représentatif de 220 000 adultes âgés de 18 à 75 ans à l’inclusion. Les participants sont invités à passer un examen de santé tous les quatre ans et à remplir un questionnaire tous les ans. Les données de ces volontaires sont appariées chaque année aux bases de données de l’Assurance maladie. Cette grande cohorte est soutenue par la Caisse nationale de l’assurance maladie et financée par le Programme d’investissement d’avenir.
Les données recueillies concernent la santé, les caractéristiques socioprofessionnelles, le recours aux soins, des paramètres biologiques, physiologiques, physiques et cognitifs et permettent d’en apprendre plus sur les déterminants de nombreuses maladies.
Pour en savoir plus : constances.fr
Ces volontaires, âgés de 18 à 75 ans, avaient remplis des questionnaires concernant leurs caractéristiques démographiques et socio-économiques, leur historique médical et celui de leurs proches, ainsi que leurs modes de vie. Ils avaient également passé un examen médical, entre 2012 et 2019, incluant un test d’audition.
Les auteurs de l’étude ont analysé l’ensemble de ces données et ont ainsi montré que 25 % des individus de l’échantillon étudié présentaient une déficience auditive. Par ailleurs, 4 % étaient concernés par une déficience auditive invalidante (voir encadré ci-dessous). De plus, ces travaux indiquent que le recours aux prothèses auditives est faible. Ainsi, seuls 37 % des patients touchés par une déficience auditive invalidante portaient un tel appareillage.
La déficience auditive
Le terme « déficiente auditive » est employé pour parler d’une personne qui n’est pas capable d’entendre aussi bien qu’une personne ayant une audition normale, le seuil étant de 20 décibels (dB) de perte dans la meilleure oreille.
Une « déficience auditive invalidante » désigne une perte auditive supérieure à 35 décibels (dB) dans la meilleure oreille.
Pour aller plus loin dans l’interprétation, les chercheurs ont ensuite tenté de définir les facteurs associés à la déficience auditive. Leurs analyses suggèrent que les personnes âgées, les hommes, les individus avec un indice de masse corporelle (IMC) élevé, la présence d’un diabète, des facteurs de risque cardiovasculaires, des antécédents de dépression ou le fait d’avoir été exposé à des nuisances sonores au travail présentaient les probabilités les plus élevées de souffrir d’une déficience auditive.
À l’inverse, le fait d’avoir un revenu ou un niveau d’éducation plus élevé, de vivre seul et d’habiter en zone urbaine était associé à des probabilités plus faibles de déficience auditive.
Le recours aux appareils auditifs était particulièrement faible chez les personnes âgées (alors qu’elles sont proportionnellement plus touchées par une déficience auditive invalidante), les hommes, les fumeurs et les personnes ayant un IMC élevé.
Mieux connaître la prévalence de la déficience auditive et le profil des personnes concernées représente un intérêt certain pour mieux cibler les patients qui présentent des risques, afin d’affiner les mesures de prévention, de les dépister et d’améliorer leur prise en charge.
« C’est la première fois en France qu’une étude sur la prévalence de la déficience auditive et l’usage des appareils auditifs est menée sur un échantillon aussi large et aussi représentatif de la population française adulte. Cela permet de dresser un état des lieux fiable et d’apporter des clés aux décideurs publics alors que des solutions efficaces (comme les appareils auditifs ou encore les implants cochléaires) existent pour prendre en charge ce problème de santé majeur », soulignent Quentin Lisan et Jean-Philippe Empana, qui ont coordonné l’étude.
Alors que la France a récemment adopté une mesure permettant le remboursement des appareils auditifs par la Sécurité sociale (ce n’était pas encore le cas au moment où cette étude a été menée), il serait intéressant que les recherches à venir évaluent l’efficacité d’un tel dispositif pour encourager le recours aux appareils auditifs.
[1] Equipe 4 Epidémiologie Intégrative des maladies cardiovasculaires
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Prédire la rapidité de l’évolution de la maladie d’Alzheimer pour une meilleure prise en charge du patient : la recherche avance |
|
|
| |
|
| |

Prédire la rapidité de l’évolution de la maladie d’Alzheimer pour une meilleure prise en charge du patient : la recherche avance
28 MAR 2022 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Près d’un million de personnes sont atteints de la maladie d’Alzheimer en France ce qui en fait la maladie neurodégénérative la plus fréquente. Elle provoque amnésie mais également aphasie (perte de la faculté de s’exprimer), agnosie (troubles de la reconnaissance des visages, des objets, etc.) et apraxie (difficulté à effectuer certains gestes). Cependant, la rapidité de son développement clinique est extrêmement variable selon les personnes et aujourd’hui, il n’existe pas de marqueurs pronostics fiables pour prédire son évolution.
Les travaux de recherche du Pr Marie Sarazin, chef du service de Neurologie de la mémoire et du langage (GHU Paris, site Sainte-Anne) et directrice des travaux de recherche dans le laboratoire d’imagerie biomédicale multimodale BIOMAPS (Inserm/CNRS/CEA/Université Paris-Saclay) au sein du Service Hospitalier Frederic Joliot et du Dr Julien Lagarde, neurologue et chercheur dans l’équipe du Pr Marie Sarazin ont démontré que l’évolution de la maladie d’Alzheimer pouvait être anticipée grâce à une technique d’imagerie spécifique. Les résultats sont publiés dans le Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.
La maladie d’Alzheimer : une évolution variable selon les patients qui complique une prise en charge adaptée
La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui se caractérise par l’accumulation anormale dans le cerveau de dépôts de protéine amyloïde à l’extérieur des cellules et de protéine tau anormale intraneuronale constituant les dégénérescences neuro-fibrillaires qui modifie le fonctionnement des neurones. Ces anomalies protéiques apparaissent des années avant la survenue des premiers symptômes de la maladie.
La répartition des lésions tau est corrélée aux symptômes cliniques. A ce jour, il n’existe pas de moyen fiable pour prédire l’évolution clinique de la maladie chez un patient donné. Certains la verront se déployer relativement lentement, alors que d’autres subiront une altération plus rapide de leurs fonctions cognitives, ce qui complique la prise en charge.
>> Lire l’article Zoom sur la maladie d’Alzheimer
Trente-six patients suivis pendant 2 ans et des résultats très encourageants
Les équipes de recherche ont suivi 36 patients présentant une maladie d’Alzheimer au stade débutant. Ces derniers ont bénéficié d’un bilan clinique détaillé explorant les fonctions cognitives et d’un premier bilan de neuro-imagerie réalisé par IRM, pour mesurer l’atrophie cérébrale (conséquence fréquente de la maladie d’Alzheimer) et par Tomographie par Emission de Positons (TEP) une technique spécifique d’imagerie cérébrale qui permet de détecter in vivo l’accumulation des protéines anormales (tau et amyloïde) ainsi que leur répartition dans le cerveau.
Les patients ont ensuite été suivis pendant 2 ans avec des bilans cliniques annuels et une deuxième IRM à la fin du suivi.
Ce que l’on a découvert : Les résultats montrent que la quantité initiale de protéine tau accumulée est associée à l’évolution des troubles cognitifs et de l’atrophie cérébrale après 2 ans dans la maladie d’Alzheimer. En clair, l’intensité des dépôts de protéine Tau, observables grâce à l’imagerie TEP, prédisent l’évolution de la maladie.
De plus, les chercheurs ont constaté que pour chaque domaine cognitif considéré, les associations entre les quantités de protéine tau observées par imagerie TEP et l’évolution des troubles cognitifs prédominent dans les régions cérébrales qui leur sont classiquement associées : le lobe temporal gauche pour la mémoire épisodique verbale, les lobes pariétaux pour les fonctions instrumentales, et les lobes frontaux pour les fonctions exécutives.
Un résultat crucial pour améliorer la prise en charge des patients et identifier les malades à haut risque évolutif pour les essais thérapeutiques.
Ce résultat souligne l’importance de la protéine tau dans le mécanisme de la maladie d’Alzheimer, et sa valeur prédictive de l’évolution de la maladie.
Elle révèle également l’intérêt de l’imagerie TEP, qui permettrait aux équipes médicales de mieux anticiper l’évolution potentielle des troubles cognitifs et d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement des patients en optimisant, par exemple, la conception des essais thérapeutiques en fonction de l’évolution attendue des troubles chez chaque patient.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
