|
|
|
|
 |
|
Thérapie cellulaire |
|
|
| |
|
| |
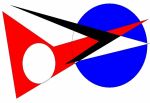
Thérapie cellulaire
Sous titre
Greffer des cellules souches pour soigner durablement
La thérapie cellulaire consiste à greffer des cellules afin de restaurer la fonction d’un tissu ou d’un organe. L’objectif est de soigner durablement le patient grâce à une injection unique de cellules thérapeutiques. Ces cellules sont obtenues à partir de cellules souches pluripotentes
cellules souches pluripotentes
Cellules capables de se différencier en n'importe quel type de cellulaire.
(pouvant donner tous types de cellules) ou multipotentes (pouvant donner un nombre limité de types de cellules) provenant du patient lui-même ou d’un donneur. De nombreuses approches de thérapie cellulaire sont en cours de développement. Quelques-unes sont en outre déjà validées.
Dossier réalisé en collaboration avec Marc Peschanski, directeur de l’Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques (I-Stem, unité Inserm 861, Genopole d'Évry), et Christian Jorgensen, directeur de l’Institut de médecine régénératrice et de biothérapies (unité Inserm 844) et coordinateur de la plateforme nationale de thérapie cellulaire ECellFrance au CHU de Montpellier.
Comprendre les problématiques associées à la thérapie cellulaire
Les différentes sortes de cellules souches
Laboratoire de culture cellulaire, observation de cellules souches embryonnaires humaines au microscope. Centre d'étude des cellules souches (CECS) © Inserm, F. Guénet
Plusieurs sortes de cellules souches sont utilisées pour obtenir des cellules différenciées et fonctionnelles adaptées à la thérapie cellulaire. Ces différents types de cellules partagent toutefois deux propriétés : celle de s’autorenouveler indéfiniment, offrant un stock illimité de matériel, et celle de pouvoir donner naissance à plusieurs types cellulaires.
Les cellules souches pluripotentes
Les cellules souches pluripotentes peuvent donner tous les types de cellules de l’organisme. Il peut s’agir de :
* cellules souches embryonnaires prélevées sur des embryons de 5 à 7 jours,
* cellules souches pluripotentes induites (IPS pour Induced Pluripotent Stem cells) prélevées chez des adultes et reprogrammées en cellules pluripotentes par génie génétique.
Les chercheurs savent aujourd’hui obtenir la différenciation des cellules pluripotentes en plusieurs types cellulaires, comme des cellules de la rétine ou de la peau. Chaque type cellulaire est obtenu grâce à un cocktail de facteurs de croissance et de différenciation spécifique, dont la recette est complexe et longue à mettre au point. Pour certains types cellulaires, comme les cellules musculaires squelettiques, le cocktail nécessaire n’a pas encore été découvert.
Qu'est-ce qu'une cellule souche? - MOOC – 4 min 57 - vidéo extraite du MOOC Ouvrez les portes du laboratoire – 2015
Les cellules souches multipotentes
La thérapie cellulaire peut également être réalisée avec des cellules souches multipotentes qui peuvent se différencier en un nombre limité de types cellulaires.
Les plus utilisées sont les cellules souches mésenchymateuses, présentes dans tout l’organisme au sein du tissu adipeux
tissu adipeux
Tissu contenant les adipocytes, cellules spécialisées dans le stockage de la graisse.
, de la moelle osseuse, des tissus de soutien des organes, mais également au sein des os, des cartilages, des muscles... Ces cellules souches sont particulièrement faciles à prélever dans le tissu adipeux ou la moelle osseuse. Elles peuvent donner naissance à des cellules cartilagineuses (chondrocytes
chondrocytes
Cellule qui synthétise les composants du cartilage, comme le collagène.
), osseuses (ostéoblastes
ostéoblastes
Cellule permettant la formation de l’os.
), graisseuses (adipocytes
adipocytes
Cellule du tissu adipeux, spécialisée dans le stockage de la graisse.
), à des fibres musculaires (myocytes), des cardiomyocytes… Elles secrètent, en outre, des facteurs de croissance favorables aux cellules environnantes et sont parfois utilisées exclusivement pour cette propriété. Elles produisent également des facteurs anti-inflammatoires qui entrainent une immunosuppression locale et favorisent la fonction de cellules régulatrices de l’immunité. Ces propriétés limitent l’inflammation locale et protègent, a priori, contre le rejet de greffe.
D’autres cellules multipotentes peuvent être utilisées en thérapie cellulaire, comme les cellules souches cutanées. Ces dernières sont utilisées depuis les années 80 pour reconstituer les différentes couches de l’épiderme et greffer les grands brûlés. Les cellules souches de l'œil, provenant du limbe (en périphérie de la cornée), permettent, quant à elles, de réparer des lésions de la cornée. Enfin, les cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse sont à l’origine de toutes les cellules du sang : en cas de cancer hématologique, elles permettent de reconstituer un stock de cellules sanguines saines chez le patient, après avoir détruit ses propres cellules malades par chimiothérapie. Cette intervention se pratique depuis les années 70.
Le sang de cordon également riche en cellules souches
Le sang de cordon ombilical contient des cellules souches hématopoïétiques naïves sur le plan immunitaire, et donc très bien tolérées en cas de greffe. Le sang de cordon est utilisé pour traiter des hémopathies malignes comme les leucémies ou des lymphomes
lymphomes
Cancer du système lymphatique qui se développe aux dépens de lymphocytes.
, ou encore des maladies génétiques comme l'anémie de Fanconi. Il offre une alternative sérieuse à la greffe de moelle en l’absence de donneur compatible. Toutefois, le nombre de cellules thérapeutiques récupérées par cordon est faible.
La conservation de sang placentaire n’est autorisée en France que pour soigner d’autres patients, de façon anonyme et gratuite. Le réseau français du sang placentaire (RFSP) coordonne la collecte et la conservation du sang de cordon, grâce à un réseau de maternités partenaires couvrant plus du quart des naissances en France. Les femmes qui acceptent de donner ce produit sanguin à l’occasion de la naissance de leur enfant, le font de manière altruiste afin d’aider des patients qu’elles ne connaissent pas, atteints de maladies mortelles du sang. A partir du quatrième mois de grossesse, si la mère est éligible, elle peut donner son consentement. Le prélèvement a lieu dans les minutes qui suivent l’accouchement lorsque le cordon ombilical vient d’être coupé et que le placenta est encore dans l’utérus. Le sang est ensuite congelé et conservé dans une banque en vue de son utilisation ultérieure.
Obtenir des cellules thérapeutiques
Adipocytes en culture obtenus à partir de cellules souches mésenchymateuses (gouttelettes lipidiques en jaune, noyaux en bleu). © Inserm, F. Blanchard
L’indication d’une thérapie cellulaire définit le plus souvent le choix des cellules souches à utiliser. Ainsi, les cellules souches embryonnaires se différencient spontanément en cellules de la rétine et sont donc particulièrement adaptées à la mise au point de traitements de maladies affectant cet organe. Pour traiter l’arthrose, le choix se porte plus spontanément vers les cellules mésenchymateuses, capables de donner des cellules de cartilage.
Des laboratoires détiennent des lignées de cellules souches et collaborent avec les équipes qui cherchent à développer des thérapies cellulaires. Toute la difficulté est de mettre au point le milieu de culture permettant d’orienter les cellules souches vers le type cellulaire désiré de façon très homogène, avec la garantie de leur stabilité après l’implantation. Une seule cellule restée indifférenciée se renouvellerait indéfiniment dans l’organisme du patient la recevant, risquant de provoquer un cancer. Une fois, ce milieu de culture adapté obtenu, les laboratoires doivent adapter leur procédure aux normes de bonnes pratiques de production (ou "GMP" pour Good Manufacturing Practices) et de conservation, afin d’obtenir des cellules thérapeutiques de "grade clinique". C’est la condition sine qua non pour que ces cellules soient agréées par les autorités de santé et que des essais cliniques puissent être menés chez l’Homme.
Dans certaines indications, les cellules souches produites pour la thérapie cellulaire peuvent être modifiées génétiquement par thérapie génique.
La thérapie cellulaire, un traitement "one shot"
Un traitement unique pour un coût qui paraît raisonnable : c’est ce qui semble se dessiner avec la thérapie cellulaire. Les coûts de production des cellules thérapeutiques sont en effet amenés à diminuer avec l’automatisation des processus. A partir de 750 000 cellules souches embryonnaires décongelées, il est aujourd’hui possible de créer une banque de 325 millions de kératinocytes (cellule majoritaire de l'épiderme) en quatre mois, sachant qu’il en faut environ 500 000 pour traiter un patient. Ce seuil devrait être décuplé dans les années à venir. Actuellement, le coût d’un médicament de thérapie cellulaire est estimé entre 10 000 à 20 000 euros. Et contrairement aux médicaments courants, une administration unique suffit pour traiter le patient.
Le problème de la compatibilité donneur-receveur
Coloration au rouge alizarine de cellules souches mésenchymateuses différenciées en ostéoblastes. Les ostéoblastes sont les cellules responsables de la formation osseuse. © Inserm, D. Noël
Le prélèvement des cellules souches utilisées en thérapie cellulaire peut être réalisé sur le patient lui-même. Il est alors dit autologue et les cellules thérapeutiques seront parfaitement tolérées par le patient sur le plan immunitaire. L’utilisation de cellules autologues est possible lorsqu’on a recours à des cellules souches multipotentes ou à des cellules IPS. Point faible de cette solution, elle allonge les délais de traitement par rapport à l’utilisation de cellules thérapeutiques prêtes à l’emploi issue de banques.
Lorsque les cellules souches thérapeutiques sont prélevées chez une autre personne que le patient, elles sont dites allogènes. Leur utilisation peut poser des problèmes de tolérance immunitaire : les cellules du donneur peuvent être reconnues par le système immunitaire du patient comme des éléments étrangers et être éliminées. Des rejets de greffe peuvent donc théoriquement avoir lieu. En cas de greffe de moelle, par exemple, le patient receveur doit suivre un traitement immunosuppresseur pour éviter ce rejet.
Concernant l’utilisation de cellules IPS allogènes, les chercheurs anticipent ce problème en créant actuellement des banques de cellules marquées selon leur profil immun (HLA
HLA
Les protéines HLA, situées à la surface des cellules, permettent au système immunitaire de distinguer les cellules de l’organisme des cellules étrangères.
), de manière à pouvoir choisir des cellules thérapeutiques compatibles avec le profil des patients receveurs. Il s’agit d’un gros travail, mis en œuvre via des collaborations internationales et coordonné par l’Alliance GAIT (Global Alliance for IPS Therapy). L’Inserm y participe.
Avec les cellules souches embryonnaires, le problème de la compatibilité donneur-receveur est moins aigu : ces cellules paraissent en effet faiblement immunogènes
immunogènes
Qui induit une réaction immunitaire.
et leur utilisation ne nécessite a priori qu’un traitement immunosuppresseur transitoire. Néanmoins, ce point crucial est suivi de près dans le cadre des essais cliniques en cours. Si l’immunogènicité de ces cellules est plus importante que prévue et nécessite un traitement immunosuppresseur prolongé, voire à vie, cela pourrait remettre en cause leur intérêt dans des indications qui ne sont pas majeures.
Quant aux cellules souches mésenchymateuses couramment utilisées dans les essais actuels, elles expriment faiblement les marqueurs HLA et, de plus, secrètent des facteurs immunosuppresseurs qui limitent les réactions immunitaires contre le greffon. Aucun traitement immunosuppresseur exogène n’est donc nécessaire lorsqu’on utilise des cellules souches mésenchymateuses allogènes. Toutefois, avant une implantation, les chercheurs vérifient que le patient receveur n’exprime pas d’anticorps contre le système HLA du donneur.
Etat de la recherche : Vers la peau universelle
Etat de la recherche : Vers la peau universelle – interview – 3 min 10 – vidéo extraite de la plateforme Corpus – 2014
Les enjeux de la thérapie cellulaire – essais cliniques
Les essais cliniques en cours à partir de cellules souches embryonnaires
Une société de biotechnologie américaine (Ocata Therapeutics) utilise des cellules souches embryonnaires humaines différenciées en cellules de la rétine pour lutter contre la DMLA et différenciées en cellules épithéliales pigmentaires de la rétine pour lutter contre la dystrophie maculaire de Stargardt. Dans les deux cas, des essais de phase I et II sont en cours pour évaluer la sécurité de cette approche et évaluer l’effet thérapeutique. Les premiers résultats sont modestes, mais positifs. Un autre essai se prépare dans la DMLA, piloté par The London Project to Cure Blindness en partenariat avec un laboratoire pharmaceutique (Pfizer). L’idée est la même : développer des cellules de la rétine à partir de cellules souches embryonnaires pour les injecter à des patients de plus de 50 ans souffrant de cette baisse d’acuité visuelle.
Sur le campus du Génopole d’Evry, des chercheurs du laboratoire I-Stem (unité Inserm 861) travaillent en étroite collaboration avec l’Institut de la vision (unité Inserm 968) et l’AFM-Téléthon sur d’autres applications de thérapie cellulaire se fondant sur l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines. Ce laboratoire développe notamment l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines différenciées en kératinocytes dans le traitement des ulcères cutanés associés à une maladie génétique, la drépanocytose. Les travaux précliniques actuellement conduits visent à vérifier la biodistribution des cellules injectées et l’absence de risque tumorigène.
Dans le domaine de la cardiologie, une équipe de l’hôpital européen Georges Pompidou (unité Inserm 970) a pratiqué en octobre 2014 une greffe de cellules cardiaques dérivées de cellules souches embryonnaires humaines, selon un procédé développé par des chercheurs de l’hôpital Saint-Louis (unité Inserm 1160). Dix semaines après, l’état de la patiente, une femme âgée de 68 ans atteinte d’insuffisance cardiaque sévère, s’était nettement amélioré, sans complication apparente. Autre maladie ciblée par ce type d’approche : le diabète de type 1. Une autre société de biotechnologie américaine (ViaCyte) prépare un essai clinique se fondant sur l’utilisation de cellules de pancréas productrices d’insuline obtenues à partir de cellules souches embryonnaires. Les cellules à greffer sont encapsulées dans un disque sophistiqué : ce dispositif permet à l’insuline et au glucose de diffuser, mais protège le greffon d’une réaction immune de l’hôte. Les résultats précliniques sont encourageants. L’objectif est de restaurer la production d’insuline à long terme chez les patients.
Les essais cliniques en cours à partir de cellules IPS
Les cellules IPS sont peu utilisées en thérapie cellulaire, en raison de l’étape de reprogrammation dont la sécurité pose question. Si les essais cliniques menés avec les cellules souches embryonnaires s’avèrent concluants, notamment sur le plan de la tolérance immunitaire, il y a peu de chances que les cellules IPS soient plus largement utilisées à l’avenir. Si en revanche, les cellules souches embryonnaires sont finalement plus immunogènes que prévu, l’utilisation de cellules IPS autologues connaîtra probablement un essor.
Un essai clinique utilisant des cellules IPS est néanmoins en cours au Japon, dans le traitement de la DMLA humide, forme quasi exclusive de DMLA dans le pays. Les cellules thérapeutiques sont prélevées chez les patients (cellules autologues), reprogrammées puis redifférenciées en cellules de la rétine, et finalement réinjectées aux patients. Une dizaine de patients seront traités dans le cadre de cet essai visant à évaluer la sécurité et la faisabilité de cette approche.
En France, INGESTEM, une infrastructure nationale coordonnée par l'Inserm et labellisée par le plan Investissements d'avenir 2012-2019, réunit cinq équipes de recherche pionnières dans le domaine de la biologie des cellules IPS et de l'ingénierie tissulaire. Leur objectif est d'utiliser les techniques de reprogrammation cellulaire pour générer des modèles de pathologies humaines et de médecine régénérative.
Cellules et Réparations – Interview - 2 min 53 - vidéo extraite de la série POM Bio à croquer – 2013
Les essais cliniques en cours à partir de cellules souches mésenchymateuses
Plus de 350 essais cliniques de thérapie cellulaire utilisant des cellules mésenchymateuses sont en cours dans le monde. Dans un tiers d’entre eux, les cellules thérapeutiques utilisées sont des cellules autologues. Les indications testées sont extrêmement variées en raison des capacités de ces cellules à se différencier en différents types cellulaires et à produire des facteurs de croissance et d’immunosuppression. Des essais concernent la rhumatologie (arthrose, polyarthrite rhumatoïde), des dégénérescences musculaires (myopathies), la cardiologie (accident vasculaire cérébrale, infarctus du myocarde, ischémie
ischémie
Diminution de l'apport sanguin artériel à un organe, entraînant une baisse de l'oxygénation de ces tissus et donc la perturbation, voire l'arrêt, de sa fonction.
des membres inférieurs), le diabète, des maladies auto-immunes (lupus), le rejet de greffe...
Au CHU de Montpellier, l’essai ADIPOA est en cours dans le traitement de l’arthrose modérée à sévère. Il est conduit auprès de 18 patients qui reçoivent une injection unique de cellules souches mésenchymateuses directement dans l’articulation. Trois doses différentes de cellules sont testées. Les premiers résultats montrent une réponse chez 80% des sujets, avec un gain de fonctionnalité et une baisse de la douleur neuf mois après l’injection. Un essai de phase II devrait être lancé d’ici la fin de l’année 2015. Il inclura 150 patients répartis en trois groupes : deux groupes de 50 patients chacun qui recevront une injection de cellules souches à des doses différentes et un groupe de 50 patients témoins qui ne recevront pas d’injection de cellules souches.
Squelette et Mouvement – Interview - 4 min - vidéo extraite de la série POM Bio à croquer – 2013
Des travaux suggèrent que les cellules souches mésenchymateuses peuvent favoriser la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, sans toutefois pouvoir se différencier en cellules de vaisseaux sanguins. Cet effet serait dû à la production de facteurs de croissance qui favorisent localement le développement de cellules. Cette propriété justifie des travaux dans le domaine cardiovasculaire, visant à favoriser la croissance des tissus lésés après un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral ou une artériopathie des membres inférieurs. Un certain nombre d’essais cliniques précoces sont en cours dans ces indications. Une étude de phase II dans l’AVC ischémique est ainsi en cours à l’hôpital de San Diego (Etats-Unis), avec des cellules souches mésenchymateuses allogéniques produites par la société Stemedica. Une autre étude est menée en Corée (au Samsung medical center), avec des cellules souches mésenchymateuses autologues.
Un essai de phase II démarre, par ailleurs, à l’Institut de recherche de l’hôpital d’Ottawa (Canada), dans la sclérose en plaques. Il vise à évaluer le bénéfice des propriétés neuroprotectrices des cellules souches mésenchymateuses autologues. A l’hôpital de Boston et à la Mayo Clinic (Rochester, Etats-Unis), un autre essai de phase II cible la sclérose latérale amyotrophique, toujours avec des cellules souches mésenchymateuses autologues.
Un réseau national d’expertises complémentaires
En France, au CHU de Montpellier, il existe une plateforme nationale de thérapie cellulaire fondée sur l’utilisation des cellules souches mésenchymateuses adultes : ECELLFRANCE. Son objectif est d’harmoniser et d’optimiser les étapes nécessaires au développement des cellules souches médicament et de la médecine régénératrice. Elle propose à toute équipe académique ou industrielle d’accélérer son programme de R&D depuis la validation du projet jusqu’aux essais cliniques de phase I et II.
Les thérapies cellulaires "validées"
Des traitements par thérapie cellulaire sont d’ores et déjà autorisés par les autorités de santé :
* L’utilisation de cellules souches cutanées pour reconstituer des feuilles d’épiderme en laboratoire et les greffer chez des grands brulés est pratiquée depuis les années 70.
* L’administration de cellules souches hématopoïétiques (greffe de moelle osseuse) est utilisée dans le traitement d’hémopathies malignes depuis les années 80.
* Au Canada, la perfusion de cellules souches mésenchymateuses allogéniques est autorisée pour lutter contre la maladie du greffon contre l’hôtemaladie du greffon contre l’hôteComplication grave qui survient suite à une greffe de moelle osseuse, lorsque les cellules immunitaires du donneur se mettent à attaquer l’organisme du receveur.
chez l’enfant (GvHD).
* En Corée, l’injection de cellules souches mésenchymateuses allogéniques est autorisée dans l’arthrose depuis 2013.
* En Europe, Holoclar est le premier médicament de thérapie cellulaire à avoir reçu une autorisation de mise sur le marché (en février 2015). Il est indiqué en cas de brûlure ou de lésions de la cornée. Il repose sur le prélèvement de cellules souches limbiques (en périphérie de la cornée) chez le patient et leur différenciation ex vivo en cellules épithéliales de la cornée destinées à être réimplantées.
Et demain
Neurones dérivés de cellules souches induites à la pluripotence à partir de prélèvements réalisés chez des patients atteints de progeria. L’ADN est marqué en bleu, les neurones en vert (marquage de la protéine Tuj1). Le marquage de la lamine A devrait être en rouge, mais il est totalement absent dans cette population cellulaire. © Inserm, X. Nissan
Les indications de la thérapie cellulaire sont innombrables et les promesses sont réelles dans de nombreux domaines. Des champs cliniques comme celui de maladies neurodégénératives (maladies de Parkinson ou d’Alzheimer) ou des dégénérescences musculaires (myopathie de Duchenne) pourraient être concernés si les chercheurs parviennent à produire différents sous-types de neurones en quantité importante et des cellules musculaires squelettiques. Et comment ne pas également imaginer la possibilité de produire des cellules sanguines, y compris des plaquettes
plaquettes
Aussi appelées thrombocytes, ces cellules du sang jouent un rôle primordial dans la coagulation.
, en quantité illimitée pour couvrir les besoins en sang des hôpitaux ? Toutes les hypothèses sont désormais permises.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
MÉMOIRE |
|
|
| |
|
| |

Mémoire
Sous titre
Une affaire de plasticité synaptique
La mémoire permet d'enregistrer des informations venant d'expériences et d'événements divers, de les conserver et de les restituer. Différents réseaux neuronaux sont impliqués dans de multiples formes de mémorisation. La meilleure connaissance de ces processus améliore la compréhension de certains troubles mnésiques et ouvre la voie à des interventions auprès des patients et de leur famille.
Dossier réalisé en collaboration avec Francis Eustache, directeur de l'unité 1077 Inserm/EPHE/UNICAEN, Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine
Comprendre le fonctionnement de la mémoire
La mémoire est la fonction qui nous permet d’intégrer, conserver et restituer des informations pour interagir avec notre environnement. Elle rassemble les savoir-faire, les connaissances, les souvenirs. Elle est indispensable à la réflexion et à la projection de chacun dans le futur. Elle fournit la base de notre identité.
Cinq systèmes interconnectés
La mémoire se compose de cinq systèmes interconnectés, impliquant des réseaux neuronaux distincts :
* La mémoire de travail (à court terme) est au cœur du réseau.
* La mémoire sémantique et la mémoire épisodique sont deux systèmes de représentation consciente à long terme.
* La mémoire procédurale permet des automatismes inconscients.
* La mémoire perceptive est liée aux différentes modalités sensorielles.
On rassemble parfois toutes les mémoires autres que celle de travail sous le nom générique de mémoire à long terme. Par ailleurs, on distingue souvent les mémoires explicites (épisodique et sémantique) des mémoires implicites (procédurale et perceptive).
La mémoire de travail
La mémoire de travail (ou mémoire à court terme) est la mémoire du présent. Elle permet de manipuler et de retenir des informations pendant la réalisation d’une tâche ou d’une acticité.
Cette mémoire est sollicitée en permanence : c’est elle qui permet par exemple de retenir un numéro de téléphone le temps de le noter, ou de retenir le début d’une phrase le temps de la terminer. Elle utilise une boucle phonologique (répétition mentale), qui retient les informations entendues, et/ou un calepin visuospatial, qui conserve les images mentales.
Elle fonctionne comme une mémoire tampon : les informations qu’elles véhiculent peuvent être rapidement effacées, ou stockées dans la mémoire à long terme par le biais d’interactions spécifiques entre le système de mémoire de travail et la mémoire à long terme.
7, le nombre magique
On estime que le nombre de chiffres, de lettres, ou de mots qu’une personne peut restituer immédiatement dans l’ordre proposé est égal à 7, plus ou moins deux (on parle de l'empan verbal). Il peut être augmenté en regroupant les données (une série de 8 chiffre est plus facile à retenir lorsqu’ils sont groupés par 2 que lorsqu’ils sont pris isolément). Par ailleurs, une série de mots est d’autant plus facile à retenir qu’ils sont courts ou qu’ils sont proches phonologiquement ou sémantiquement.
La mémoire sémantique
La mémoire sémantique est celle du langage et des connaissances sur le monde et sur soi, sans référence aux conditions d'acquisition de ces informations. Elle se construit et se réorganise tout au long de notre vie, avec l’apprentissage et la mémorisation de concepts génériques (sens des mots, savoir sur les objets), et de concepts individuels (savoir sur les lieux, les personnes…).
La mémoire épisodique
La mémoire épisodique est celle des moments personnellement vécus (événements autobiographiques), celle qui nous permet de nous situer dans le temps et l’espace et, ainsi, de se projeter dans le futur. En effet, raconter un souvenir de ses dernières vacances ou se projeter dans les prochaines font appel aux mêmes circuits cérébraux.
La mémoire épisodique se constitue entre les âges de 3 et 5 ans. Elle est étroitement imbriquée avec la mémoire sémantique. Progressivement, les détails précis de ces souvenirs se perdent tandis que les traits communs à différents événements vécus favorisent leur amalgame et deviennent progressivement des connaissances tirées de leur contexte. Ainsi, la plupart des souvenirs épisodiques se transforment, à terme, en connaissances générales.
La mémoire procédurale
La mémoire procédurale est la mémoire des automatismes. Elle permet de conduire, de marcher, de faire du vélo ou jouer de la musique sans avoir à réapprendre à chaque fois. Cette mémoire est particulièrement sollicitée chez les artistes ou les sportifs pour acquérir des procédures parfaites et atteindre l’excellence. Ces processus sont effectués de façon implicite, c’est-à-dire inconsciente : la personne ne peut pas vraiment expliquer comment elle procède, pourquoi elle tient en équilibre sur ses skis ou descend sans tomber. Les mouvements se font sans contrôle conscient et les circuits neuronaux sont automatisés.
La constitution de la mémoire procédurale est progressive et parfois complexe, selon le type d’apprentissage auquel la personne est exposée. Elle se consolide progressivement, tout en oubliant les traces relatives au contexte d’apprentissage (lieu, enseignant…).
La mémoire perceptive
La mémoire perceptive s’appuie sur nos sens et fonctionne la plupart du temps à l’insu de l’individu. Elle permet de retenir des images ou des bruits sans s’en rendre compte. C’est elle qui permet à une personne de rentrer chez elle par habitude, grâce à des repères visuels. Cette mémoire permet de se souvenir des visages, des voix, des lieux.
Avec la mémoire procédurale, la mémoire perceptive offre à l’humain une capacité d’économie cognitive, qui lui permet de se livrer à des pensées ou des activités spécifiques tout en réalisant des activités devenues routinières.
Mémorisation : De l’organisation cérébrale….
Il n’existe pas "un" centre de la mémoire dans le cerveau. Les différents systèmes de mémoire mettent en jeu des réseaux neuronaux distincts, répartis dans différentes zones du cerveau. L’imagerie fonctionnelle (tomographie
tomographie
Technique d’imagerie cérébrale permettant de reconstituer le volume en coupes d’un objet, tel que le cerveau.
par émission de positons, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle) permet aujourd’hui d’observer le fonctionnement cérébral normal impliqué dans les processus cognitifs.
Ainsi, le rôle de l’hippocampe et du lobe frontal semble particulièrement déterminant dans la mémoire épisodique, avec un rôle prépondérant des cortex préfrontaux gauche et droit dans son encodage et sa récupération, respectivement. La mémoire perceptive recrute des réseaux dans différentes régions corticales, à proximité des aires sensorielles. La mémoire sémantique fait intervenir des régions très étendues, et particulièrement les lobes temporaux et pariétaux. Enfin, la mémoire procédurale recrute des réseaux neuronaux sous-corticaux et au niveau du cervelet.
La phase de stockage de l’information nécessite des étapes répétées de consolidation. L’hippocampe semble constituer un élément important dans le processus. Enfin, la restitution d’un souvenir, quelle que soit son ancienneté, reposerait également sur cette structure cérébrale, en interaction avec différentes régions néocorticales. Pour autant, il serait moins sollicité lorsque le rappel provient de la mémoire sémantique plutôt que de la mémoire épisodique.
...à la plasticité synaptique
La mémorisation résulte d’une modification des connexions entre les neurones d’un système de mémoire : on parle de "plasticité synaptique". Les différentes formes de mémoire fonctionnent en interaction, selon que la situation requiert des informations issues de la mémoire sémantique ou épisodique, implicite ou explicite. Ainsi, un souvenir se traduit par l’intervention de neurones issus de différentes zones cérébrales et assemblés en réseaux. Ces connections interneuronales évoluent constamment au gré des expériences et sont responsables de la persistance d’un souvenir à long terme ou non, selon les cas (importance de l’évènement, contexte environnemental et émotionnel…).
Pris isolément, le souvenir correspond à une variation de l’activité électrique au niveau d’un circuit spécifique formé de plusieurs neurones interagissant par le biais des connexions synaptiques (les synapses
synapses
Zone de communication entre deux neurones.
étant les points de contacts entre les neurones). Sa formation repose sur le renforcement ou la création d’une connexion synaptique temporaire, stimulée par le biais de protéines produites puis transportées au sein des neurones, comme le glutamate
glutamate
Neurotransmetteur excitateur le plus répandu dans le système nerveux central.
, le NMDA ou la syntaxine qui va elle-même moduler la libération du glutamate.
Le souvenir est ensuite consolidé ou non en fonction la présence de médiateurs cellulaires au niveau du réseau neuronal impliqué dans les heures suivantes. L’activation régulière et répétée de ce réseau permettrait de renforcer ou de réduire ces connexions et, par conséquent, de consolider ou oublier ce souvenir. Sur le plan morphologique, cette plasticité est associée à des changements de forme et de taille des synapses, des transformations de synapses silencieuses en synapses actives, la croissance de nouvelles synapses.
Le maintien à long terme d’un souvenir repose sur la modification de la cinétique d’élimination ou de renouvellement de certains médiateurs. La phosphokinase zêta (PKM zêta) joue un rôle prépondérant dans ce mécanisme en favorisant la persistance des mécanismes impliqués dans la stabilisation et la consolidation des souvenirs. Elle possède pour cela deux propriétés spécifiques : elle n’est soumise à aucun mécanisme d’inhibition et elle s'auto-réplique.
Au cours du vieillissement, la plasticité des synapses diminue et les modifications des connexions sont plus éphémères, ce qui pourrait expliquer des difficultés croissantes à retenir des informations.
La réserve cognitive, soutien de la mémoire
Les capacités de maintien de la mémoire et d’adaptation en cas de lésions semblent variables d’un individu à l’autre. En effet, il a été décrit qu’à lésions cérébrales équivalentes en imagerie, tous ne présenteraient pas les mêmes altérations cognitives. Ces capacités dépendraient de la réserve cérébrale, relative au tissu cérébral, et de la réserve cognitive, qui repose sur sa fonctionnalité.
Selon différentes études, un volume cérébral accru, ou un nombre élevé de neurones ou de synapses est associé à une survenue plus tardive de démence. À lésions équivalentes, ceux qui présentent une réserve cérébrale plus importantes présenteraient des troubles moins sévères. Cette réserve cérébrale serait sous l’influence de paramètres génétiques et probablement environnementaux.
La réserve cognitive correspond à l’efficacité des réseaux neuronaux impliqués dans la réalisation d’une tâche et celle du cerveau à mobiliser ou mettre en place des réseaux compensatoires en cas de lésions pathologiques ou de perturbations physiologiques liées à l’âge. Elle se traduit également par une variabilité, d’un sujet à l’autre, de la tolérance des lésions cérébrales identiques. En effet, les données disponibles suggèrent que la richesse des interactions et le niveau d’éducation sont associés à une survenue plus tardive des troubles cognitifs ou des démences Alzheimer ou apparentées. À l’inverse, l’évolution du déclin cognitif chez ces derniers serait plus rapide une fois installé : elle s’expliquerait par le fait que les symptômes sont identifiés à un stade où les lésions sont plus nombreuses et importantes.
La constitution de la réserve cognitive pourrait dépendre:
* de l’importance des apprentissages
* du niveau d’éducation
* d’une stimulation intellectuelle tout au long de la vie
* de la qualité des relations sociales
* de l’alimentation
* du sommeil
* des paramètres génétiques seraient également probablement impliqués
Hygiène de vie et mémoire
Des expériences ont montré que dormir améliore la mémorisation, et ce d’autant plus que la durée du sommeil est longue. A l’inverse, des privations de sommeil (moins de 4 ou 5 heures par nuit) sont associées à des troubles de la mémoire et des difficultés d’apprentissage. Par ailleurs, le fait de stimuler électriquement le cerveau (stimulations de 0,75 Hz) pendant la phase de sommeil lent (caractérisée par l’enregistrement d’ondes corticales lentes à l’encéphalogramme) améliore les capacités de mémorisation d’une liste de mots. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ce phénomène : pendant le sommeil, l’hippocampe est au repos, évitant les interférences avec d’autres informations au moment de l’encodage du souvenir. Il se pourrait aussi que le sommeil exerce un tri, débarrassant les souvenirs de leur composante émotionnelle pour ne retenir que l’informationnelle, facilitant ainsi l’encodage. Pour en savoir plus, consulter le dossier Sommeil.
Le sommeil n'est pas le seul paramètre d’hygiène de vie qui influence notre capacité de mémorisation : l’alimentation (bénéfice du régime méditerranéen), l’activité physique et les activités sociales jouent également un rôle important.
Mémoire et émotions : de l’amélioration mnésique à la pathologie
Il est démontré que les émotions peuvent moduler la façon dont une information est enregistrée, l’émotion renforçant ponctuellement l’attention. Ainsi, une émotion positive peut se traduire par une amélioration ponctuelle des performances mnésiques. Il apparaît également que la consolidation, et donc la rétention d’une information est favorisée par l’émotion : le rappel d’un souvenir émotionnel après un long intervalle est souvent plus important que lorsque ce souvenir est neutre. L’imagerie fonctionnelle montre d’ailleurs que le rappel des souvenirs est proportionnel à leur intensité émotionnelle qui peut être observée par l’activation de l’amygdale, siège des émotions. Enfin, la récupération d’un souvenir est aussi améliorée par la présence d’une émotion positive. Chez les personnes présentant un trouble cognitif, les expériences montrent un effet protecteur des émotions positives sur les capacités résiduelles de mémoire. Ce mécanisme existe cependant uniquement dans les premiers stades de la maladie. Ensuite, l’incapacité de l’amygdale à remplir son rôle rend ce mécanisme compensatoire inefficace.
Il existe un pendant pathologique à ce processus : en effet, une émotion trop intense, notamment traumatique, entraîne une distorsion de l’encodage. L’état de stress post-traumatique (ESPT) des personnes victimes ou témoins d’un évènement dramatique en est l’illustration type. Le souvenir est mémorisé sur le long terme, avec à la fois une amnésie de certains aspects et une hypermnésie d’autres détails qui laissent la personne hantée durablement par cet événement. Il s’accompagne d’une décharge de glucocorticoïdes
glucocorticoïdes
Hormones stéroïdiennes ayant une action sur le métabolisme protéique et glucidique.
(hormone du stress), dans l’hippocampe au moment de l’événement. Cette distorsion profonde de l’encodage des événements, au contraire d’un souvenir normal, rend le souvenir persistant au cours du temps sans qu’il ne perdre de son intensité ou de sa spécificité. La victime a ainsi le sentiment de revivre continuellement la scène traumatisante, même des années après.
Dans d’autres situations ayant également trait à une émotion vive (stress, agression...), certains sujets développent plus volontiers une amnésie dissociative : véritable stratégie défensive adaptative, développée de façon inconsciente, elle repose sur l’oubli d’une partie des souvenirs autobiographiques ou sémantiques, ainsi que de l’évènement l’ayant déclenchée. Ces souvenirs peuvent être réactivés, progressivement ou brutalement, à l’issue d’une conscientisation de l’évènement déclencheur.
Sur le plan thérapeutique, la compréhension des mécanismes de stabilité des souvenirs et de l’influence émotionnelle offrent les moyens d’envisager la prise en charge thérapeutique de certaines pathologies : ainsi, le développement d’approches psychothérapeutiques fondées sur la dissociation entre les souvenirs et les émotions peut permettre de réduire le handicap lié à des maladies comme certaines formes d’anxiété ou l’état de stress post-traumatique.
Mémoire et oubli : du physiologique au pathologique
Depuis une vingtaine d’années, la prévalence
prévalence
Nombre de cas enregistrés à un temps T.
croissante des troubles de la mémoire tel que la maladie d’Alzheimer, a fait de l’oubli un symptôme. Pourtant, l’oubli est aussi un processus physiologique, indispensable au bon fonctionnement de la mémoire.
En effet, l’oubli est nécessaire pour l’équilibre du cerveau, permettant à ce dernier de sélectionner les informations secondaires qu’il est possible d’éliminer afin de ne pas saturer les circuits neuronaux. L’oubli est un corollaire de la qualité de la hiérarchisation et de l’organisation des informations stockées. Ainsi, certaines personnes souffrent d’hypermnésie idiopathique
idiopathique
Qui existe par soi-même, indépendamment d’une autre maladie.
, une pathologie de l’abstraction et de la généralisation du souvenir dans laquelle l’oubli des détails est aboli. Ces personnes rencontrent des difficultés de vie quotidienne liées à l’incapacité d’organiser leurs souvenirs en fonction de leur significativité et de leur importance.
Cependant, l’oubli peut aussi correspondre à la disparition involontaire de souvenirs acquis par apprentissage volontaire ou implicite, alors que son codage a été réalisé correctement. Ce phénomène reste physiologique tant qu’il est sporadique. Il concerne plus souvent la mémoire épisodique que la mémoire sémantique, procédurale ou sensorielle. Il devient pathologique, et prend plus volontiers le nom d’amnésie, lorsqu’il concerne des pans entiers de mémoire sémantique ou épisodique.
Les multiples troubles de la mémoire
Certaines situations entraînent des incapacités sévères et des amnésies durables. Les causes possibles sont :
* un traumatisme physique entraînant des lésions cérébrales
* un accident vasculaire cérébral hémorragique ou ischémique
* une tumeur du cerveau
* ou encore une dégénérescence neuronale comme la maladie d’Alzheimer
Dans d’autres cas, les troubles sont moins sévères et le plus souvent réversibles. Les causes possibles sont :
* des maladies mentales comme la dépression
* le stress et l’anxiété, ou la fatigue
* un événement traumatisant (deuil)
* des effets indésirables de médicaments comme des somnifères, des anxiolytiques (d’autant plus fréquent que la personne est âgée)
* l’usage de drogues
Les troubles de la mémoire ont différentes origines biologiques, comme un déficit en certains neuromédiateurs ou une faible connectivité entre les réseaux cérébraux.
Les manifestations de ces troubles sont extrêmement variables selon leur origine et les localisations cérébrales des processus pathologiques. Ainsi, des patients atteints d’une démence sémantique, dans laquelle des mots ou des informations sont oubliés, perdent également des souvenirs anciens alors qu’ils continuent à mémoriser de nouveaux souvenirs épisodiques (souvenirs "au jour le jour"). Ces troubles sont associés à une atrophie des lobes temporaux. Chez d’autres patients, notamment ceux souffrant de la maladie d’Alzheimer, les troubles concernent la mémoire épisodique : chez eux, les souvenirs les plus anciens sont épargnés plus longtemps que les plus récents. D’autres types de déficiences existent : celles affectant les neurones impliqués dans la mémoire procédurale peuvent engendrer la perte de certains automatismes, comme chez les personnes atteintes par la maladie de Parkinson ou de Huntington. Celles affectant les neurones impliqués dans la mémoire du travail, peuvent quant à elles donner des difficultés à se concentrer et à faire deux taches en même temps.
Il existe également des troubles de la mémoire sévères mais transitoires, comme l’ictus amnésique idiopathique : survenant le plus souvent entre 50 et 70 ans, il s’agit d’une amnésie soudaine et massive pendant laquelle le patient est incapable de se souvenir de ce qu’il vient de faire, sa mémoire épisodique est annihilée. Mais sa mémoire sémantique est intacte : il peut répondre à des questions de vocabulaire et évoquer des connaissances générales. Cette amnésie disparaît souvent après six à huit heures.
Les enjeux de la recherche
La mémoire et ses troubles donnent lieu à de nombreuses recherches qui font appel à des expertises variées dans un cadre pluridisciplinaire : génétique, neurobiologie, neuropsychologie, électrophysiologie, imagerie fonctionnelle, épidémiologie, différentes disciplines médicales (neurologie, psychiatrie…), mais aussi sciences humaines et sociales.
Ma mémoire et celle des autres
La mémoire a longtemps été considérée comme individuelle et étudiée comme telle. Cette approche est aujourd’hui caduque, ou du moins incomplète. Le souvenir se situe en effet à l’interface entre l’identité personnelle et les représentations collectives : il se constitue à partir des interactions entre la personne, les autres et l’environnement. Il ne peut être détaché du contexte social dans lequel il prend place. Les interactions, mais aussi les représentations sociales et les stéréotypes influencent le fonctionnement de notre mémoire.
On parle de cognition sociale : elle permet, par exemple, d’adapter son comportement selon le contexte dans lequel on se trouve, et cela grâce à la mémorisation et l’analyse des expériences passées. L’empathie découle également de cette notion interindividuelle de la mémoire : elle utilise notamment les informations de la mémoire épisodique afin de permettre un "voyage de l’esprit" se traduisant en capacité à partager la détresse de l’autre. Aussi appelée "théorie de l’esprit", cette capacité à se mettre à la place de quelqu’un et à imaginer et interpréter ses pensées fait appel à nos mémoires dont nous décentrons l’objet. Sur le plan médical, la dégénérescence des neurones au niveau frontotemporal, retrouvée dans certaines démences (Alzheimer et apparentées), se caractérise par une diminution de la cognition sociale : le malade peut présenter des troubles du comportement ou des dysfonctionnements sociaux.
Par ailleurs, sur un plan plus large, il existe aussi une mémoire collective ou culturelle, celle qui prend place autour des évènements historiques (autour de leur évocation ou de leur commémoration) et des évènements contemporains médiatisés. Il s’agit d’une mémoire partagée constituée des différentes représentations de l’évènement par l’ensemble des personnes.
Ce domaine de recherche est particulièrement novateur et rapproche les expertises en neurosciences et en psychologie de celles en sociologie, en histoire, en philosophie ou en éthique. En termes thérapeutiques, cette transdisciplinarité peut également apporter un intérêt : l’état de stress post-traumatique correspond par exemple à une hypermnésie des perceptions et émotions liées à l’évènement, à une amnésie des aspects contextuels, ainsi qu’à une perturbation de la mémoire autobiographique. À la suite d’un évènement traumatisant, une prise en charge appropriée de la charge émotionnelle associée pourrait être d’autant plus efficace que l’évènement en question est inscrit dans le cadre social, à la fois familial et professionnel. Il en serait d’autant plus question dans le cadre d’un évènement inscrit dans la mémoire collective.
Sonder la mémoire individuelle et collective des attentats
Le programme 13-Novembre, mené par des chercheurs de l’Inserm et du CNRS, associe différents volets de recherche transdisciplinaire autour du témoignages recueillis sur les attentats du 13 novembre 2015. Il cherche à évaluer comment le souvenir traumatique des attentats évolue dans les mémoires individuelles et collectives, comment les deux fonctionnent en interaction et quels sont les facteurs de vulnérabilité face à l’ESPT. À quatre reprises durant dix ans, les témoignages et les éventuels troubles (ESPT, images envahissantes, dépression…) de 1 000 personnes volontaires seront analysés selon leur proximité avec les attentats : cette cohorte rassemble des personnes exposées directement (survivants, témoins, familles), indirectement (habitants des quartiers des attentats) ainsi que des habitants franciliens ou non franciliens. Ces données seront recueillies parallèlement à une analyse de l’opinion des français sur le sujet, ainsi qu’une analyse du discours et de la textométrie des informations télévisuelles ou radiophoniques liés à ces évènements, afin d’en identifier les interactions.
La mémoire au futur
Selon le contexte, nos propres aspirations, nos projets, nous avons une capacité à élaborer des scénarios plausibles pour le futur, constitués de pensées, d’images et d’actions. Ceux-ci ne peuvent prendre forme que sur la base des représentations du passé. La mémoire du futur fait donc appel à notre mémoire épisodique et sémantique, contrairement aux idées reçues ou aux conceptions habituelles de la mémoire, traditionnellement associées au passé. Ainsi, l’imagerie permet de vérifier que l’évocation d’un souvenir autobiographique ou l’imagination d’un scénario futur font intervenir des régions cérébrales très proches les unes des autres. Par ailleurs, les études montrent que les amnésiques ne peuvent se projeter dans le futur.
La capacité à remplir une tâche à une date ou un jour précis entre aussi dans le cadre de la mémoire du futur : on l’appelle alors plus volontiers mémoire prospective, articulée autour de différents volets selon la nature des tâches à effectuer : "mémoire prospective propre" pour les actions ponctuelles (poster une lettre, aller à un rendez-vous…), "mémoire prospective habituelle" pour toutes les tâches routinières, "monitoring" pour l’attention portée à la fin d’une tâche tandis qu’une autre est en cours (penser à arrêter le four à la fin d’une cuisson, par exemple).
Cette notion de mémoire du futur peut avoir des applications thérapeutiques. Ainsi, des "thérapies orientées vers le futur" ont été développées et testées auprès de patients souffrant de dépression majeure ou de schizophrénie : menées à travers plusieurs séances réparties sur quelques semaines, elles consistent à sensibiliser les sujets sur l’importance des projections mentales dans le futur, la façon dont celles-ci peuvent être améliorées en luttant contre des mécanismes personnels de résistance, puis, progressivement à leur proposer des activités de pleine conscience et, enfin, à travailler sur l’évocation de leurs propres valeurs, leurs objectifs, et les moyens d’y arriver. Les premières études montrent que cette approche peut être plus efficace que les thérapies cognitivo-comportementales
thérapies cognitivo-comportementales
Traitement des difficultés du patient dans « l’ici et maintenant » par des exercices pratiques centrés sur les symptômes observables au travers du comportement.
conventionnelles.
Mémoires externes
Il semble clair aujourd’hui que notre mémoire interne et nos capacités de projection sont influencées par la mémoire externe : les supports de mémoire collective (livres, films…) sont un élément utile pour modeler notre mémoire du futur. La multiplication des dispositifs électroniques de stockage d’information dans notre quotidien est cependant décrite comme modifiant l’organisation et la puissance de notre mémoire, que nous sollicitons par conséquent moins. Cet équilibre entre mémoire interne et externe constitue un enjeu majeur pour l’avenir.
Sur le plan thérapeutique, les supports externes de stockage sont aujourd’hui testés sous forme d’implants cérébraux dans la prise en charge de patients amnésiques. De façon plus futuriste, l’idée de greffe de mémoire artificielle fait également l’objet de développements actuels.
Modifier la mémoire grâce à l'optogénétique
Outre l’imagerie fonctionnelle, qui fait aujourd’hui partie des modes d’exploration incontournables de l’organisation mnésique, d’autres approches sont plus récentes et en pleine évolution. C’est notamment le cas de l’optogénétique, qui est une technique alliant génétique et optique : elle consiste à modifier génétiquement des cellules afin de les rendre sensibles à la lumière et, grâce à cette dernière, d’en moduler le fonctionnement. Ainsi, l’optogénétique permet d’activer ou d’inhiber expérimentalement des groupes spécifiques de neurones dans le tissu cérébral et d’en évaluer l’impact.
Elle permet aussi de développer des méthodes de manipulation de la mémoire (implantations de faux souvenirs, oubli expérimental…). Ces travaux permettent d’envisager des approches thérapeutiques intéressantes dans la prise en charge de certains troubles psychiatriques.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Résistance aux antibiotiques |
|
|
| |
|
| |
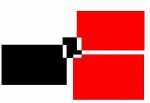
Résistance aux antibiotiques
Sous titre
Un phénomène massif et préoccupant
Les antibiotiques ont permis de faire considérablement reculer la mortalité associée aux maladies infectieuses au cours du 20e siècle. Hélas, leur utilisation massive et répétée, que ce soit en ville ou à l'hôpital, a conduit à l’apparition de bactéries résistantes à ces médicaments. Qui plus est, les animaux d'élevage ingèrent au moins autant d'antibiotiques que les humains ! Résultat : la résistance bactérienne est devenue un phénomène global et préoccupant. Pour éviter le pire, la communauté internationale, alertée en 2015 par l'OMS, se mobilise. La route est longue...
Dossier réalisé en collaboration avec Jean-Luc Mainardi, unité 1138 Inserm/Sorbonne Université/Université Paris Descartes/Université Paris Diderot, équipe Structures bactériennes impliquées dans la modulation de la résistance aux antibiotiques, Centre de Recherche des Cordeliers, Paris et Marie-Cécile Ploy, unité 1092 Inserm/Université de Limoges, équipe Anti-Infectieux : supports moléculaires des résistances et innovations thérapeutiques, Institut Génomique, environnement, immunité, santé et thérapeutiques, Limoges
Comprendre le phénomène de la résistance aux antibiotiques
Les antibiotiques sont, à l'origine, des molécules naturellement synthétisées par des microorganismes pour lutter contre des bactéries concurrentes de leur environnement. Aujourd’hui, il existe plusieurs familles d’antibiotiques, naturels, semi-synthétiques ou de synthèse, qui s’attaquent spécifiquement à une bactérie ou à un groupe de bactéries. Certains antibiotiques vont agir sur des bactéries comme Escherichia coli dans les voies digestives et urinaires, d’autres sur les pneumocoques ou sur Haemophilus influenzae dans les voies respiratoires, d’autres encore sur les staphylocoques ou les streptocoques présents au niveau de la peau ou de la sphère ORL.
Les antibiotiques sont spécifiques des bactéries
Les antibiotiques ne sont efficaces que sur les bactéries et n’ont aucun effet sur les virus et les champignons. Ils bloquent la croissance des bactéries en inhibant la synthèse de leur paroi, de leur matériel génétique (ADN ou ARN
ARN
Molécule issue de la transcription d'un gène.
), de protéines qui leur sont essentielles, ou encore en bloquant certaines voies de leur métabolisme. Pour cela, ils se fixent sur des cibles spécifiques.
L’antibiorésistance, un phénomène devenu global
L’efficacité remarquable des antibiotiques a motivé leur utilisation massive et répétée en santé humaine et animale (voir encadré). Cela a créé une pression de sélection sur les populations bactériennes, entraînant l'apparition de souches résistantes. En effet, lorsqu'on emploie un antibiotique, seules survivent – et se reproduisent – les bactéries dotées de systèmes de défense contre cette molécule. La mauvaise utilisation des antibiotiques – traitements trop courts, trop longs ou à posologies inadaptées – est également pointée du doigt.
Ponctuelles au départ, ces résistances sont devenues massives et préoccupantes. Certaines souches sont multirésistantes, c’est-à-dire résistantes à plusieurs antibiotiques. D’autres sont même devenues toto-résistantes, c’est-à-dire résistantes à quasiment tous les antibiotiques disponibles. Ce phénomène, encore rare en France mais en augmentation constante, place les médecins dans une impasse thérapeutique : ils ne disposent plus d’aucune solution pour lutter contre l’infection.
Homme, animal, environnement : un seul monde
D’après l’OMS, plus de la moitié des antibiotiques produits dans le monde sont destinés aux animaux. Aux États-Unis, à côté d’une utilisation à visée thérapeutique, les antibiotiques sont aussi utilisés de façon systématique à faibles doses comme facteurs de croissance, une pratique interdite en Europe depuis 2006. Or la surconsommation d’antibiotiques entraîne l’apparition de résistances. Et les bactéries multi-résistantes issues des élevages peuvent se transmettre à l’Homme directement ou via la chaîne alimentaire.
Par ailleurs, hommes et animaux rejettent une partie des antibiotiques absorbés, via leurs déjections. D'où la présence de bactéries résistantes dans les cours d'eau en aval des villes ou des élevages, voire dans les nappes phréatiques.
Hôpital, médecine de ville, pratiques vétérinaires, environnement : tout est désormais lié. C'est pourquoi l'OMS, suivie par les grandes organisations internationales, préconise une vision globale de la lutte contre les antibiorésistances, l’approche One World, One Health (Un monde, une santé).
Pendant longtemps, la majorité des cas de résistance était détectée à l’hôpital. Cependant le phénomène prend de plus en plus d'ampleur en ville, au détour d’antibiothérapies apparemment anodines. Ainsi, à l’occasion d’un banal traitement oral, une espèce bactérienne intestinale peut développer une résistance. L'antibiotique détruit la flore bactérienne associée et laisse le champ libre à la bactérie résistante pour se développer. Ces bactéries résistantes sont ensuite diffusées par voie manuportée, plus ou moins vite selon le niveau d'hygiène de la population.
De la résistance naturelle à la résistance acquise
La résistance aux antibiotiques peut résulter de plusieurs mécanismes :
* production d’une enzyme modifiant ou détruisant l’antibiotique
* modification de la cible de l’antibiotique
* imperméabilisation de la membrane de la bactérie
Certaines bactéries sont naturellement résistantes à des antimicrobiens. Plus préoccupante, la résistance acquise concerne l’apparition d’une résistance à un ou plusieurs antibiotiques chez une bactérie auparavant sensible. Ces résistances peuvent survenir via une mutation génétique affectant le chromosome de la bactérie, ou bien être liées à l’acquisition de matériel génétique étranger (plasmide, transposon) porteur d’un ou plusieurs gènes de résistance en provenance d’une autre bactérie. Les résistances chromosomiques ne concernent en général qu’un antibiotique ou une famille d’antibiotiques. Les résistances plasmidiques peuvent quant à elles concerner plusieurs antibiotiques, voire plusieurs familles d’antibiotiques. Elles représentent le mécanisme de résistance le plus répandu, soit 80% des résistances acquises.
YouTube (iFrames) est désactivé. Autorisez le dépôt de cookies pour accéder au contenu Autorisé
L’antibiorésistance – documentaire pédagogique – 13 min 15 - vidéo extraite de la série Grandes Tueuses (2016)
L’antibiorésistance en chiffres
Certaines résistances posent surtout problème à l’hôpital. Les souches de Staphylococcus aureus résistantes à la méticilline (SARM) sont responsables d’infections diverses, pulmonaires et osseuses, ainsi que de septicémies, en particulier dans les unités plus sensibles (soins intensifs). Toutefois, des mesures spécifiques, notamment d’hygiène, ont permis de réduire ces résistances en France (33% en 2001, 15,7% en 2015).
Acinetobacter baumannii est également redoutée à l’hôpital. La part des infections nosocomiales liées à cette bactérie résistante à l’imipenème est passée de 2 ou 3% en 2008 à 11,1% en 2011. Le phénomène est d’autant plus préoccupant que cette bactérie persiste dans l’environnement et se développe préférentiellement chez des malades immunodéprimés et vulnérables.
Deux phénomènes importants dominent l'actualité des résistances. Tout d'abord l'augmentation continue, aujourd'hui plus encore en ville qu'à l’hôpital, des entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE). Certaines espèces comme Escherichia coli ou Klebsiella pneumoniae sont devenues résistantes aux céphalosporines de troisième génération (C3G), qui constituent les antibiotiques de référence pour traiter ces espèces bactériennes. En 2014, 11% des souches de E. coli et 35% de celles de K. pneumoniae isolées de bactériémies étaient devenues résistantes à ces C3G. Dans les infections urinaires, ces chiffres sont de 7% pour E. coli et 16% pour K. pneumoniae. Les médecins doivent alors utiliser des antibiotiques "de derniers recours" : les carbapénèmes.
Or, et c'est le deuxième phénomène très inquiétant, depuis quelques années apparaissent des souches d'entérobactéries produisant des carbapénémases. Ces enzymes détruisent ces antibiotiques et confèrent ainsi une résistance à la bactérie. Cela peut conduire à des situations d’impasse thérapeutique. Ce phénomène reste relativement peu fréquent en France, ce qui n'est pas le cas dans des pays comme la Grèce, Chypre, l'Afrique du Nord, les États-Unis ou l'Inde.
Pseudomonas aeruginosa, responsable de nombreuses infections nosocomiales, présente ainsi plus de 25% de résistance aux carbapénèmes. Certaines souches toto-résistantes sont notamment retrouvées chez les patients atteints de mucoviscidose ou transplantés pulmonaires.
Résistance aux antibiotiques : le classement de l'OMS
En février 2017, l'OMS a publié une liste de bactéries résistantes représentant une menace à l'échelle mondiale.
A. baumannii, P. aeruginosa et les entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE) représentent ainsi une urgence critique car elles résistent à un grand nombre d'antibiotiques.
Six autres bactéries, dont Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori (ulcères de l’estomac), les salmonelles et Neisseria gonorrhoeae (gonorrhée), représentent une urgence élevée.
Enfin, pour Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (otites) et les Shigella spp. (dysenterie), l'urgence est modérée.
De plus l'agent de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, multirésistant dans certaines parties du monde, fait l'objet d'un programme propre de l'OMS.
La lutte s'organise
Réduire et mieux cibler la consommation d’antibiotiques
Pour préserver le plus longtemps possible l’efficacité des antibiotiques disponibles, il faut réduire leur consommation afin de limiter la pression de sélection sur les bactéries. Les plans de rationalisation des prescriptions et les campagnes de sensibilisation destinées au grand public ont fait baisser la consommation au début de ce siècle mais elle est aujourd'hui repartie à la hausse, en particulier en ville. La France reste parmi les premiers utilisateurs mondiaux.
Dans ce contexte, il est important que les médecins puissent :
* distinguer les infections virales des infections bactériennes car les antibiotiques n'affectent pas les virus. Des tests de dépistage rapide existent pour les angines, maladies très fréquentes, la plupart du temps virales et beaucoup trop souvent associées à la prescription d’antibiotiques. Malheureusement, ces tests restent sous-utilisés en France.
*
* choisir un antibiotique pertinent : en cas d'infection bactérienne, mieux vaut éviter l'utilisation systématique d'antibiotiques précieux (récents ou à large spectre) lorsque d'autres plus courants, ou à spectre plus étroit, suffisent et sont aussi efficaces. Le médecin doit pour cela savoir à quelles molécules réagit la bactérie responsable de la maladie de son patient. Il existe déjà des tests rapides de détection de la résistance à certains antibiotiques. Autre réflexion en cours : les laboratoires de microbiologie pourraient rendre des antibiogrammes "ciblés", testant la sensibilité de la souche à une gamme réduite d'antibiotiques ciblés sur la bactérie isolée chez le patient en fonction de sa pathologie et non, comme aujourd'hui, à la plupart des molécules disponibles. Il s'agit là aussi d'inciter le médecin à choisir un antibiotique courant plutôt que se diriger vers d’autres antibiotiques, comme par exemple des céphalosporines parmi les plus récentes.
*
* adapter la cure aux besoins, en particulier limiter la durée des traitements au strict nécessaire. De plus à l'hôpital, lorsqu'une antibiothérapie probabiliste est prescrite, il faut la réévaluer dans les 48-72 heures avec les résultats du laboratoire. Lorsqu'une antibiothérapie de plus de 7 jours est prescrite, cela doit se faire en accord avec un référent en antibiothérapie. Ce dernier a pour mission de diffuser la politique du bon usage des antibiotiques et son application pratique au sein des établissements de soin, en se reposant sur des recommandations élaborées par les différentes instances.
YouTube (iFrames) est désactivé. Autorisez le dépôt de cookies pour accéder au contenu Autorisé
Bactéries et infections – interview – 5 min - vidéo extraite de la série POM bio à croquer (2014)
Une prise de conscience internationale
En mai 2015, l’OMS, la FAO (Food and Agriculture Organization, l'organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) et l'OIE (Office international des épizooties, devenu l'Organisation mondiale de la santé animale) ont adopté un Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens. Il se décline en cinq axes :
* sensibiliser le personnel de santé et le public
* renforcer la surveillance et la recherche
* prendre des mesures d’assainissement, d’hygiène et de prévention des infections
* optimiser l’usage des antimicrobiens en santé humaine et animale
* soutenir des investissements durables pour la mise au point de nouveaux traitements, diagnostics ou vaccins
Déjà engagée dans la lutte, l'Union européenne a lancé des plans d'action en 2001 et 2011. Le tout dernier, datant de juin 2017, prend en compte la dimension globale du problème et vise à faire du continent une région de pointe. Il comprend, entre autres, une action conjointe, la Joint Action on Antimicrobial Resistance & Healthcare - Associated Infections, coordonnée par l'Inserm. Elle rassemble 44 partenaires institutionnels – ministères de la Santé, instituts de recherche, instituts de santé publique – et vise à passer au concret, en particulier en s'inspirant de ce qui est déjà mis en place dans certains pays.
Pour sa part, la France a décliné le plan européen (annoncé en 2016) via une feuille de route interministérielle de novembre 2016, reprenant les mêmes grandes orientations. En ce qui concerne l'usage vétérinaire des antibiotiques, le plan Ecoantibio (2012-2017) est aujourd'hui remplacé par Ecoantibio2 (2017-2021).
Les enjeux de la recherche
Nouveaux antibiotiques
De nouveaux antibiotiques sont nécessaires pour lutter contre les bactéries multirésistantes. Le marché des antibiotiques étant beaucoup moins rentable que celui de médicaments donnés au long cours, comme par exemple les antihypertenseurs, les firmes pharmaceutiques ont peu investi dans cette recherche. Cependant, quelques nouvelles molécules sont disponibles comme la ceftolozane, une nouvelle céphalosporine associée à un inhibiteur de bêta-lactamases, ou le tazobactam, disponible en France depuis 2016. Son spectre d’activité inclut les EBLSE et le bacille pyocyanique (Pseudomonas aeruginosa) multirésistant.
La piste la plus avancée aujourd'hui consiste à inhiber l’action des bêta-lactamases. Ces enzymes, produites par certaines bactéries, les rendent résistantes aux antibiotiques de la famille des bêta-lactamines (comme les céphalosporines de 3e et de 4e génération). L'avibactam, en particulier, est un inhibiteur de bêta-lactamases n’appartenant pas à la famille des bêta-lactamines, désormais commercialisé en association avec la ceftazidime, une céphalosporine de 3e génération. Cette combinaison est même efficace contre certaines bactéries résistantes aux carbapénèmes. Plusieurs inhibiteurs de la famille chimique de l'avibactam, en association avec d'autres bêta-lactamines, sont en développement et/ou en cours d’évaluation.
Autres voies thérapeutiques
phages
Virus qui n’infecte que les bactéries.
, des virus infectant et tuant spécifiquement certaines bactéries. Cette spécificité permet d’éliminer les bactéries pathogènes sans affecter les autres, contrairement aux antibiotiques à spectre large. Le développement industriel de cocktails de phages, préparés à l’avance ou "sur-mesure" pour lutter contre une bactérie spécifique, paraît néanmoins complexe.
Par ailleurs, l'administration orale d'antibiotiques présente l'inconvénient de tuer certaines bactéries commensales résidant dans le tube digestif, formant le microbiote. Différentes pistes de protection du microbiote intestinal – administration d'un antibiotique conjointement à du charbon absorbant, ou à une bêta-lactamase agissant dans le côlon – sont à l'étude. De même, la transplantation fécale (pour restaurer un microbiote sain), déjà utilisée en clinique contre les infections répétées à Clostridium difficile, est aujourd'hui évaluée pour lutter contre les entérobactéries productrices de BLSE ou de carbapénémases.
D’autres équipes tentent de développer des thérapies antivirulence : l’objectif n’est plus de tuer la bactérie responsable de l’infection, mais de bloquer les systèmes qui la rendent pathogène pour l’Homme. Des antitoxines (souvent des anticorps
anticorps
Protéine du système immunitaire, capable de reconnaître une autre molécule afin de faciliter son élimination.
monoclonaux) dirigées contre certaines toxines bactériennes sont aujourd'hui en phase expérimentale.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Le conscient et l’inconscient travaillent de concert pour trier les images |
|
|
| |
|
| |

Le conscient et l’inconscient travaillent de concert pour trier les images
COMMUNIQUÉ | 06 DÉC. 2017 - 18H47 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Notre cerveau est constamment bombardé d’informations sensorielles. Loin d’être surchargé, le cerveau est un véritable expert dans la gestion de ce flux d’informations. Des chercheurs de Neurospin (CEA/Inserm) ont découvert comment le cerveau intègre et filtre l’information. En combinant des techniques d’imagerie cérébrale à haute résolution temporelle et des algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning), les neurobiologistes ont pu déterminer la séquence d’opérations neuronales qui permet au cerveau de sélectionner spécifiquement l’information pertinente. La majeure partie de l’information est traitée et filtrée inconsciemment par notre cerveau. Au sein de ce flux, l’information pertinente est sélectionnée par une opération en trois étapes, et diffusée vers les régions associatives du cerveau afin d’être mémorisée. Ces observations sont décrites dans Nature Communications le 5.12.2017.
Les chercheurs ont mesuré l’activité du cerveau de 15 participants, pendant que ces derniers devaient repérer une image « cible » dans un flux de 10 images par seconde . Les neurobiologistes ont ainsi pu observer trois opérations successives permettant aux participants de traiter et de trier le flux d’images :
► Même si une dizaine d’images est présentée chaque seconde, chacune de ces images est analysée par les aires sensorielles du cerveau pendant environ une demi-seconde. Ceci constitue une première phase de traitement automatique, inconscient et sans effort pour nous.
► Lorsqu’on demande aux participants de porter attention et de mémoriser une image en particulier, ce n’est pas uniquement l’image ‘cible’ qui est sélectionnée, mais toutes les images qui sont encore en cours de traitement dans les régions sensorielles. L’attention du sujet aura pour effet d’amplifier les réponses neuronales induites par ces images.
► La troisième phase de traitement correspond au rapport conscient du sujet. Seule l’une des images sélectionnées induit une réponse cérébrale prolongée et impliquant les régions pariétales et frontales. C’est cette image que le sujet indiquera avoir perçue.
« Dans cette étude, nous montrons que le cerveau humain est capable de traiter plusieurs images simultanément, et ce de manière inconsciente », explique le chercheur Sébastien Marti, qui signe cette étude avec Stanislas Dehaene, directeur de Neurospin (CEA/Inserm). « L’attention booste l’activité neuronale et permet de sélectionner une image spécifique, pertinente pour la tâche que le sujet est en train d’accomplir. Seule cette image sera perçue consciemment par le sujet », poursuit le chercheur.
Assailli par un nombre toujours croissant d’informations, notre cerveau parvient ainsi, malgré tout, à gérer le surplus de données grâce à un filtrage automatique, sans effort, et un processus de sélection en trois phases.
Les avancées technologiques en imagerie cérébrale et dans les sciences de l’information ont donné un formidable coup d’accélérateur à la recherche en neuroscience, et cette étude en est un bel exemple.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
