|
|
|
|
 |
|
RENCONTRE AUTOUR DU CERVEAU : DE LA MOLÉCULE AU COMPORTEMENT |
|
|
| |
|
| |
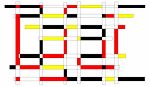
RENCONTRE AUTOUR DU CERVEAU : DE LA MOLÉCULE AU COMPORTEMENT
UNE CONFERENCE de Jean-Antoine GIRAULT, Directeur de recherche, Directeur de l’Institut du Fer-à-Moulin.
De la molécule au comportement, du comportement à la molécule… le cerveau n’a pas fini de révéler ses mystères !
Jean-Antoine Girault dirige l’Institut du Fer-à-Moulin, dédié à l’étude du développement et de la plasticité du système nerveux. Son but : associer diverses approches – biochimique, fonctionnelle, comportementale – pour mieux comprendre les mécanismes en oeuvre dans la transmission des messages entre les neurones.
Son équipe « neurotransmission et signalisation » cible ses recherches autour du striatum, une région du cerveau impliquée dans le contrôle des mouvements, la motivation, les habitudes et la mémoire procédurale.
Divers neurotransmetteurs régulent l’activité de cette structure : parmi eux, la dopamine intéresse tout particulièrement Jean-Antoine Girault, car elle joue un rôle majeur dans les comportements d’apprentissage, de récompense, voire d’addiction… jusqu’à produire certaines modifications prolongées de l’expression des gènes !
VIDEO CANAL U LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Lorsque la moelle se passe du cerveau pour commander nos artères |
|
|
| |
|
| |

Lorsque la moelle se passe du cerveau pour commander nos artères
mardi 17 juillet 2018
Comment le système nerveux moteur mobilise-t-il le système nerveux autonome pour que l’oxygénation des muscles soit adaptée à la demande physiologique? Alors que l’on pensait que l’interface entre système nerveux somatique et autonome était située dans le tronc cérébral, les chercheurs montrent que la moelle épinière est le siège d’un mécanisme de couplage entre activités somatiques et autonomes. L’activation de neurones cholinergiques intraspinaux, en produisant un rythme lent commun aux deux types de neurones, serait responsable de cette mise en cohérence.
Afin de faire face à l’augmentation des besoins physiologiques lors d’une activité physique telle que la locomotion, le système nerveux somatique (en charge des mouvements volontaires via le contrôle des muscles striés) et le système nerveux autonome (qui contrôle la vascularisation, la digestion, le muscle cardiaque, la sudation…) doivent coordonner leurs actions. Alors que l’on pensait que l’interface entre système nerveux somatique et autonome se situait dans le tronc cérébral, ce travail montre que la moelle épinière est le siège d’un mécanisme de couplage entre activités somatiques et autonomes. Pour aborder cette question, les chercheurs ont utilisé une préparation in vitro de moelle épinière isolée de rat nouveau-né, dans laquelle il est possible d’enregistrer simultanément l’activité des systèmes nerveux somatique et autonome. Ils ont montré que l’acétylcholine, un neurotransmetteur abondant dans la moelle épinière pourrait jouer un rôle clé dans ce couplage entre activités locomotrices et sympathiques.
Dans la moelle épinière sont localisés les réseaux neuronaux capables de générer l’activité locomotrice; ces réseaux coordonnent ainsi l’activité des motoneurones qui vont faire se contracter les muscles. à côté de ce système somatique, sont situés les neurones de sortie du système nerveux sympathique (appelés neurones sympathiques intermédiolatéraux ou IMLs) qui, entre autres organes cibles, connectent les fibres lisses des artères.
Grâce à un cocktail particulier de neurotransmetteurs, on peut activer les réseaux locomoteurs et enregistrer dans la moelle épinière isolée une activité de locomotion. Dans ces expériences, seuls les motoneurones innervant les muscles des pattes et du dos sont activés rythmiquement en phase avec l’activité locomotrice.
Lorsque l’on administre sur la moelle épinière isolée, un agoniste (une substance qui mime l’effet d’un neurotransmetteur) d’une sous-classe de récepteurs à l’acétylcholine (les récepteurs muscariniques), on observe l’apparition d’un rythme lent que l’on enregistre non plus exclusivement au niveau des motoneurones mais aussi dans les neurones sympathiques. Cette activité est similaire aux variations lentes de pression artérielle que l’on observe spontanément chez l’homme et l’animal. Enfin, lorsque l’activité locomotrice et l’activité lente induite par l’acétylcholine sont simultanément déclenchées on observe une fusion des deux activités couplant ainsi l’activité des systèmes nerveux somatique et autonome et contribuant à la régulation de la pression artérielle lors d’un exercice.
Figure : Au cours de l'activation de récepteurs cholinergiques muscariniques (mAchT) dans la moelle épinière thoracique, on enregistre une commande synaptique lente reçue simultanément par les neurones du système nerveux sympathique situés dans la colonne intermediolateral (IML) et par les motoneurons somatiques (MNs). Cette commande somato-sympathique pourrait être la base des variations de pression artérielle (en mm de mercure, Hg) observées chez l’homme et l’animal et appelées vagues de Mayer.
© Jean-René Cazalets & Sandrine Bertrand
Références :
* Cholinergic-mediated coordination of rhythmic sympathetic and motor activities in the newborn rat spinal cord.
* Sourioux M, Bertrand SS, Cazalets JR.
PLoS Biol. 2018 Jul 9;16(7):e2005460. doi: 10.1371/journal.pbio.2005460. [Epub ahead of print]
*
Contacts :
* Jean-René Cazalets
Tél. 05 57 57 46 26
* Sandrine Bertrand
* UMR 5287 (CNRS/Université de Bordeaux)
Zone nord Bat 2 2ème étage
146, rue Léo Saignat
33076 Bordeaux cedex
DOCUMENT CNRS LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Un nouvel acteur de la synthèse des ribosomes chez l’homme impliqué dans la dyskératose congénitale |
|
|
| |
|
| |

Un nouvel acteur de la synthèse des ribosomes chez l’homme impliqué dans la dyskératose congénitale
22 mai 2017 RÉSULTATS SCIENTIFIQUES
La synthèse des protéines est une activité vitale assurée, dans chaque cellule humaine, par 5 à 10 millions de ribosomes. Ces usines moléculaires, elles-mêmes formées d'ARN et de protéines, sont assemblées suivant une séquence complexe et très énergivore dont la défaillance est la cause de différentes pathologies. L'équipe de Pierre-Emmanuel Gleizes au Laboratoire de biologie moléculaire eucaryote, en collaboration avec l'équipe d'Ulrike Kutay à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich, révèle que la protéine PARN, une enzyme mutée dans plusieurs maladies rares, dont la dyskératose congénitale, est un acteur inattendu de l'assemblage des ribosomes. Cette étude est parue le 10 avril 2017 dans la revue Nucleic Acids Research.
Les ARN agissent dans l'ensemble du monde vivant comme médiateurs de l'information génétique, régulateurs de l'expression génique ou composants de machineries moléculaires. Ils se présentent sous forme de chaînes composées d’un alphabet de quatre lettres ou nucléotides. Les ARN les plus abondants sont ceux qui constituent les ribosomes, les machines moléculaires qui synthétisent les protéines. Chez les mammifères, quatre ARN ribosomiques s'associent avec 80 protéines pour former les deux sous-unités constituant le ribosome, appelées 40S et 60S. Plusieurs maladies génétiques, mais aussi des cancers, sont liés à des défauts de formation des ARN ribosomiques, un processus complexe dont il reste à caractériser les nombreux acteurs chez l'homme.
Les ARN ribosomiques émanent de longs ARN précurseurs (ARN pré-ribosomiques) qui sont clivés par des enzymes appelées ribonucléases agissant comme des ciseaux ou des grignoteuses. Plusieurs des ribonucléases qui cisèlent les ARN ribosomiques restent à identifier chez l’homme. La protéine PARN (Poly-Adenosine specific RiboNuclease) est une ribonucléase bien connue pour sa capacité à "grignoter" certains ARN à partir d'une de leurs extrémités (on parle d'exoribonucléase). Elle a la particularité de montrer une forte préférence pour les segments d'ARN formés d'une répétition d'adénosines, un des quatre nucléotides. Or la faible abondance d'adénosines dans les ARN pré-ribosomiques faisait de PARN un candidat improbable pour jouer un rôle dans la formation des ribosomes.
Pourtant, les chercheurs ont découvert que PARN était aussi présente dans des précurseurs de la sous-unité ribosomique 40S à des stades précoces de sa formation. Ils ont utilisé plusieurs approches pour abroger la fonction de PARN dans des cellules et ont pu ainsi observer que cette enzyme était nécessaire à la maturation correcte de l'ARN 18S, qui structure la sous-unité ribosomique 40S. Testée directement in vitrosur un ARN reproduisant l'extrémité du précurseur de l'ARN 18S, la protéine PARN purifiée s'est révélée capable de digérer ce substrat. En accord avec ces résultats, on retrouve PARN en grande quantité dans le nucléole, le domaine du noyau où sont produits les ribosomes.
Ces données font de PARN un nouvel acteur de la formation des ribosomes, une fonction inattendue pour cette enzyme. D'autres rôles ont aussi été proposés récemment pour cette enzyme dans la maturation de petits ARN non-codants, dont l'ARN de la télomérase qui assure le maintien de l'extrémité des chromosomes (télomères). Parallèlement, des mutations dans PARN ont été associées à la dyskératose congénitale ou à la fibrose pulmonaire idiopathique, des maladies génétiques caractérisées par la perte progressive des télomères. Comme PARN, deux autres protéines mutées dans la dyskératose congénitale, DKC1 et NHP2, sont requises à la fois pour la synthèse des ribosomes et la formation de la télomérase. Cette nouvelle fonction de PARN dans la production des ribosomes renforce donc l'idée encore débattue qu'un défaut de synthèse des ribosomes participe à l'étiologie de cette pathologie, en particulier dans les cas les plus sévères.
Figure : L'exoribonucléase PARN s'associe à la sous-unité 40S au cours de sa formation. Cette particule "pré-40S" est formée d’un précurseur de l’ARN ribosomique 18S replié en trois dimensions et associé à plus de 30 protéines (non figurées). La formation de l'ARN 18S (violet) demande que l'une de ses extrémités (extrémité 3', schématisée par un trait pointillé) soit raccourcie. PARN dégrade la partie surnuméraire (magenta) nucléotide par nucléotide. La structure de la particule pré-40S humaine montrée ici a été récemment déterminée par cryomicroscopie électronique (Larburu et al., 2016).
© Pierre-Emmanuel Gleizes.
En savoir plus
* Poly(A)-specific ribonuclease is a nuclear ribosome biogenesis factor involved in human 18S rRNA maturation.
Montellese C, Montel-Lehry N, Henras AK, Kutay U, Gleizes PE, O'Donohue MF.
Nucleic Acids Res. 2017 Apr 10. doi: 10.1093/nar/gkx253
*
Contact
Pierre-Emmanuel Gleizes
DR, chercheur CNRS
05 61 33 59 26
pierre-emmanuel.gleizes@ibcg.biotoul.fr
Marie-Françoise O'Donohue
05 61 33 59 50
DOCUMENT cnrs LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
LA DYNAMIQUE DU GLOBE CONTRÔLE-T-ELLE L'ÉVOLUTION DES ESPÈCES ? |
|
|
| |
|
| |

Texte de la 12ème conférence de l'Université de tous les savoirs réalisée le 12 janvier 2000 par Vincent Courtillot
La dynamique du globe contrôle-t-elle l’évolution des espèces ?
Il y a soixante-cinq millions d’années, les dinosaures occupaient toutes les niches
écologiques : l’air, les mers, les terres ; il y en avait des petits, des gros, des végétariens, des carnivores, ils étaient merveilleusement adaptés à ce monde de l’ère secondaire. Et un beau jour, il y a environ soixante-cinq millions d’années, ils ont disparu. Les théories proposées par les chercheurs depuis une centaine d’années pour expliquer ces disparitions sont extrêmement nombreuses et la plus populaire d’entre elles, qui a fait florès depuis 1980, veut qu’un jour (instantanément à l’échelle des temps géologiques), un essaim de comètes ou une grosse météorite soit tombé sur la Terre, cet impact envoyant dans l’atmosphère des quantités extraordinaires de poussières et d’aérosols qui auraient modifié le climat : une longue nuit, un hiver planétaire, suivis d’une période d’effet de serre encore plus longue. De ce passage froid/chaud, de nombreuses espèces ne seraient pas relevées. L’impact aurait interrompu les chaînes alimentaires et aurait fait disparaître de la surface de la Terre, non seulement la totalité des dinosaures, mais aussi de nombreuses autres espèces de plus petite taille .
Tout ce que les paléontologues reconstituent de la vie passée du globe est basé sur l’analyse des restes fossiles que l’on retrouve dans les roches. Pour une espèce donnée, rares sont les individus qui sont bien préservés ; l’enregistrement que nous avons de la vie sur Terre à travers ces fossiles est très incomplet. Toute théorie que l’on va construire en se basant sur ces observations est fonction du degré de complétude de cet enregistrement.
La pensée des évolutionnistes et des géologues a été dominée au XIXème et au début du XXème siècles par l’idéologie de l’uniformitarisme : au cours des temps géologiques, il ne se serait jamais passé d’événement fondamentalement différent de ce qui se passe aujourd’hui ; les transformations, les évolutions que l’on observe dans les roches ne seraient dues qu’à l‘extraordinaire longueur des temps géologiques. Les uniformitaristes refusent que l’on invoque une quelconque catastrophe pour expliquer les observations des géologues. Encore faut-il savoir ce que l’on entend par le terme de catastrophe.
Sur Terre, à cause de l’eau, de l’érosion, des climats, de la tectonique des plaques, la surface est sans cesse rajeunie et les impacts anciens de météorites, les cratères, ont très peu de chance d’être préservés. La Lune en revanche a enregistré l’histoire du début du système solaire ; astre inactif, elle a conservé, figé, l’état des lieux d’il y a trois à trois à quatre milliards d’années, et on y observe grand nombre de gigantesques cratères. Il n’y a aucune raison de penser qu’à cette époque la Terre n’ait pas subi d’impacts de même importance. La question est de savoir de quand datent les derniers très grands impacts.
Depuis 1980, l’hypothèse de la disparition des dinosaures par un grand impact de météorite domine la scène. De nombreuses autres hypothèses ont été formulées. L’une d’entre elles, dont j’ai été, avec d’autres collègues, l’un des auteurs, propose une catastrophe climatique, mais d’origine interne, qui trouverait sa source dans le volcanisme. Un volcanisme qui naturellement devrait avoir été beaucoup plus intense et volumineux que tout ce que l’on a observé de mémoire humaine. Imaginez une très longue fissure de plusieurs centaines de kilomètres de longueur, d’immenses fontaines de lave injectant dans l’atmosphère des poussières, des aérosols, des gaz (chlorhydrique, carbonique, sulfureux) qui ont la possibilité de modifier durablement le climat. Nous savons, depuis une quinzaine d’années environ,
depuis l’éruption d’El-Chichon, et plus récemment du Pinatubo, que le soufre injecté par un volcan dans l’atmosphère peut être responsable d’une évolution climatique significative. La température moyenne de l’hémisphère nord a ainsi chuté de façon mesurable pendant quelques années à la suite de l’éruption du Pinatubo, de quelques fractions de degrés Celsius, ce qui, à l’échelle de la température moyenne d’un hémisphère, est loin d’être négligeable. Ce n’est pas pour autant que dans les 15 dernières années, les espèces se soient éteintes en
masse ! Si le volcanisme doit expliquer l’extinction des espèces, c’est à une autre échelle qu’il a dû se manifester : encore faut-il le démontrer.
Qu’il faille invoquer un impact de météorite, qui ne dure qu’une fraction de seconde, ou une éruption volcanique qui s’étagerait sur quelques dizaines à quelques centaines de milliers d’années, on a là des événements très brefs en regard des temps géologiques, qui se chiffrent, eux, en millions, en dizaines de millions, voire en milliards d’années.
Il faut noter que quelques scientifiques ont fait l’hypothèse qu’il ne s’était en fait rien passé de brutal au moment de la disparition des dinosaures ; la mauvaise qualité de l’enregistrement de ces événements par les fossiles donnerait cette impression de brutalité, mais en fait, les choses se seraient passées de façon calme et régulière, sur des dizaines de millions d’années : on constate, il y a 65 millions d’années, , un vaste mouvement de régression et de retour des mers étagé sur une quinzaine de millions d’années, qui a entraîné un vaste changement de la géographie du monde.
Pour faire justice à toutes les théories existantes, une autre école pense que les extinctions ont certes été rapides, mais que c’est la dynamique interne des relations entre les espèces qui aurait conduit à une disparition en masse d’espèces. Des relations non linéaires entre les paramètres d’un système dynamique peuvent on le sait conduire à des évolutions extrêmement brutales : c’est la théorie du chaos déterministe.
A côté de ces quatre familles de théories sur la disparition des dinosaures, il en existe bien une centaine qui ont été proposées depuis un siècle. On a ainsi suggéré que leur régime alimentaire ayant changé, ils pondaient des œufs dont la coquille était fragile et qu’ils les écrasaient quand ils les couvaient...
Des données rassemblées depuis vingt ans par les géologues, les géophysiciens, les géochimistes, des spécialistes de plus d’une vingtaine de spécialités et de sous-spécialités différentes ont renouvelé l’approche de ce problème. La figure 1 montre un affleurement de calcaires au nord de la ville de Gubbio, en Ombrie, en Italie. Les calcaires en bas à droite, gris-bleu, se sont déposés dans un milieu semi-tropical à quelques centaines de mètres de fond, dans une mer assez chaude. Quand on en observe un petit morceau au microscope, on trouve des fossiles d’animaux petits et nombreux, des foraminifères. Ces animaux caractérisent l’âge des couches dans lesquelles ils sont enfermés, le Crétacé, la dernière partie de l’ère secondaire. En bas à droite de la séquence, nous sommes aux environs de moins soixante-six millions d’années. En biais au milieu de la photographie, une petite couche de deux ou trois centimètres d’épaisseur, marron foncé, faite d’argile sombre, sépare les bancs calcaires clairs de bancs calcaires plus rosâtres ; manifestement le contenu en oxyde de fer y est différent. Ce sont des calcaires qui témoignent à peu près du même milieu de dépôt ; lorsqu’on regarde au microscope une lame mince de cette roche, on s’aperçoit que, dans les premiers centimètres, elle ne contient plus de fossiles. On a l’impression que le monde s’est vidé. Puis, quand on remonte de quelques centimètres vers le haut, on observe des foraminifères pour la plupart assez différents des espèces que l’on trouvait en dessous : plus
petites, moins fines et moins décorées, ces premières espèces marines datent du début de l’ère tertiaire, il y a moins 65 millions d’années : on a traversé la fameuse limite entre ère secondaire et ère tertiaire, la limite Crétacé-Tertiaire. Depuis une vingtaine d’années les chercheurs se demandent ce qui a bien pu se passer. Quelle est la durée, la portion de mémoire de la Terre renfermée dans ce centimètre et demi d’argile noirâtre ? Un certain nombre de chercheurs américains et italiens, en particulier Walter Alvarez, ont prélevé des échantillons de ces argiles et de ces calcaires de part et d’autre de l’argile et ont analysé leur composition chimique. Surprise ! L’argile est très enrichie en iridium, un métal très rare dans la croûte terrestre. mais relativement abondant dans certains types de météorites : une telle météorite se serait vaporisée au moment de l’impact et ses produits se seraient redéposés à la surface du globe entraînant partout cette concentration anormale d’iridium. Nous sommes en 1980, l’hypothèse de la météorite est née.
Dans les années qui suivirent, les chercheurs se précipitèrent sur les coupes de la limite Crétacé-Tertiaire, partout là où elles affleuraient. La figure 2 montre ainsi un objet trouvé dans l’une de ces coupes, un tout petit grain de quartz, de un millimètre de diamètre, regardé à travers un microscope, en lumière polarisée analysée. Ce grain est traversé de familles de petits traits noirs, parallèles les uns aux autres, qui forment deux familles avec des angles très caractéristiques. Les spécialistes sont capables, en orientant ce cristal, de dire exactement à quel plan cristallin correspondent ses défauts. On ne peut produire ce type de structure qu’en faisant passer à travers un cristal de quartz une onde de choc phénoménale. Cette onde de choc désorganise le réseau cristallin et laisse derrière elle ces dislocations, ces limites entre domaines cristallographiques différents. Les grès à proximité de l’impact de la météorite de Canon Diablo en Arizona, ou les échantillons de roches provenant des sites d’explosion atomique présentent les mêmes structures. C’est un argument très fort en faveur de la météorite. Ces grains de quartz choqués ne se trouvent que dans la couche d’argile riche en iridium, mais ni au-dessus ni au-dessous.
Enfin, on a découvert la présence d’un énorme impact de météorite dans le Yucatan (au Mexique), en utilisant des mesures indirectes faites en déplaçant à la surface du sol un gravimètre (qui mesure la pesanteur). Au début des années 1970, les pétroliers ont trouvé au fond de forages effectués dans cette même région des roches qui pourraient être des restes de croûte fondue par la chaleur dégagée au moment de l’impact. Ces échantillons ont exactement soixante-cinq millions d’années, c’est-à-dire l’âge de la limite Crétacé-Tertiaire. Le cratère de Chicxulub semble bien correspondre au point d’impact de la météorite d’Alvarez.
L’iridium, les quartz choqués, la trace de l’impact au Mexique, un énorme impact qui a à peu près la bonne taille (pour une météorite qui devait faire dix kilomètres de diamètre à peu près). Le scénario en faveur de l’impact de l’astéroïde, développé entre 1980 et 1990, doit aujourd’hui être accepté.
Au début des années 1980, je me trouvais, avec mon équipe, à ramasser des cailloux quelque part entre le Tibet et l’Inde. Nous mesurions la dérive des continents. Nous avons ainsi décidé d’étudier une énorme formation volcanique, pas très loin de Bombay. On appelle cette formation géologique "les trapps du Deccan" : deux milles mètres d’épaisseur de lave affleurant sur cinq cent milles kilomètres carrés de surface. C’est donc un objet de plus d’un million de kilomètres cubes de laves empilées couche après couche, dont certaines font cent mètres d’épaisseur. On n’a jamais vu de mémoire d’homme d’éruption de cette dimension. Le travail que nous avons mené a consisté à essayer de caractériser ces roches, de les dater, en utilisant diverses techniques.
Nous avons rapporté au laboratoire des échantillons de ces basaltes du Deccan, et nous en avons mesuré l’aimantation. La plupart des roches naturelles renferment une très petite quantité d’oxydes de fer magnétiques, en général de la magnétite ou l’hématite. Nous sommes capables de mesurer la direction de cette aimantation, qui a été figée au moment où la roche s’est formée. Nous obtenons ainsi une photographie de la direction du champ magnétique terrestre ancien. Les roches naturelles se comportent donc, en gros, comme des boussoles qui ont gardé la mémoire de la direction du champ magnétique terrestre, à la fois dans le plan horizontal et dans le plan vertical, parfois depuis des centaines de millions d’années.
Nous avons par ailleurs mis en oeuvre des techniques de datation qui utilisent la décroissance naturelle des isotopes radioactifs, dont la plus connue est la méthode du carbone 14. Il existe d’autres couples d’atomes exploitables, le potassium et l’argon, le rubidium et le strontium, l’uranium, le thorium et le plomb. La géochronologie permet ainsi de dater les roches très loin dans le passé, jusqu’à l’origine du système solaire, pour peu qu’elles contiennent une quantité suffisante de ces isotopes. En utilisant l’une de ces méthodes, la méthode des isotopes de l’argon 39 et 40, nous avons montré que, du bas au haut de la falaise, les laves indiennes se sont mises en place en très peu de temps, il y a 65 à 66 millions d’années. Nous sommes capables de dire, grâce au magnétisme que cette durée n’a sans doute pas en fait excédé un demi million d’années.
Aucune des techniques que je viens de décrire ne permet à elle seule d’apporter la réponse au problème. Le magnétisme dit : « très court ». La méthode argon-argon, dit : « vers soixante- cinq millions d’années », mais même avec ces deux informations plusieurs scénarios restent envisageables. Nous avons heureusement retrouvé, « sandwichés » entre les coulées de lave, des sédiments accumulés dans un lac qui avait dû se mettre en place pendant une accalmie des éruptions. Dans ces sédiments, de tout petits restes de fossiles témoins de la toute dernière époque de l’ère secondaire. Avec l’ensemble des résultats de la géochronologie, du paléomagnétisme et de la paléontologie, il ne reste plus qu’un seul scénario possible : les gigantesques éruptions du Deccan datent bien précisément de la fameuse limite entre les ères secondaire et tertiaire.
La courbe de la figure 3 montre l’évolution dans le temps du nombre d’espèces marines fossiles découvertes par les paléontologues. On y voit la dernière et célèbre grande extinction qui, il y a soixante-cinq millions d’années, marque cette limite entre ère secondaire (ou Mésozoïque) et ère tertiaire (ou Cénozoïque). Le nombre des espèces, la diversité de la Vie sur Terre, a énormément augmenté au cours des temps géologiques, mais pas de manière uniforme. A l’ère primaire (ou Paléozoïque), après un début foudroyant (« l’explosion cambrienne »), la diversité se fixe à une valeur relativement constante, pendant des centaines de millions d’années. Et puis, il y a quelque deux cent cinquante millions d’années, s’est produite une énorme extinction en masse d’espèces. Puis la Vie a repris, a connu quelques rechutes, a repris à nouveau. Le dernier grand accident, c’est la fameuse limite Crétacé- Tertiaire.
Lors d’une pareille catastrophe, non seulement des espèces disparaissent entièrement, c’est-à- dire que tous les individus de ces espèces meurent, mais les espèces qui survivent peuvent perdre de très nombreux individus. A la limite entre les ères primaire et secondaire, il y a deux cent cinquante millions d’années, 99 % au moins de tous les individus de toutes les
espèces qui vivaient sur Terre ont disparu. C’est à peine imaginable, en termes de disparition de biomasse et en termes de catastrophe planétaire.
Retrouvons-nous pour les autres catastrophes, et en particulier, pour la grande d’il y a deux cent cinquante millions d’années, les mêmes scénarii que pour la crise Crétacé-Tertiaire ? Retrouvons-nous des traces d’impact d’astéroïde, des volcans, de grandes régressions marines ?
À travers le monde entier, plusieurs équipes se sont attachées non seulement à regarder, plus en détail, la période de la disparition des dinosaures, mais aussi toutes les autres extinctions. En même temps, les géophysiciens se sont intéressés à chercher s’il y avait d’autres endroits que l’Inde où l’on observait ces épanchements volcaniques extraordinaires. Il y a en fait une dizaine de grands « pâtés » volcaniques qui font au moins 1 million de km3 en volume, répartis à la surface de la Terre. Pour chacun d’entre eux, les chercheurs se sont livrés aux mêmes analyses que nous avions faites en Inde ; le résultat est que la quasi-totalité des formations volcaniques coïncide avec la quasi-totalité des grandes extinctions. En particulier, la grande catastrophe d’il y a deux cent cinquante millions d’années, à la fin du primaire, correspond à une énorme formation volcanique, les «trapps de Sibérie », bien connue des géologues et des économistes, parce que l’on y trouve des richesses minérales considérables, d’ailleurs liées au volcanisme.
À la question posée dans le titre de cette contribution, « La dynamique du globe contrôle-t- elle l’évolution des espèces ? », j’ai surtout tenté de répondre en parlant de l’expression du volcanisme à la surface de la Terre. Le travail du géologue et du géophysicien, c’est d’essayer de comprendre ce qui est à l’origine de ces énormes objets que sont les grandes trapps. Que s’est-il passé à l’intérieur de la Terre, sous la croûte, dans le manteau terrestre, qui a conduit à de pareils événements ? La dernière fois que s’est produite pareille monstruosité à la surface de la Terre, c’était il y a trente millions d’années. Le volcanisme correspondant forme le haut plateau éthiopien. Ce plateau volcanique, sur lequel est construit Adis Abeba, à deux mille mètres d’altitude (et dont on retrouve un fragment détaché au sud de l’Arabie, au Yémen) est un énorme volcan, formé il y a trente millions d’années, non pas au moment d’une grande disparition d’espèces, mais au moment d’une des principales crises climatiques de l’ère tertiaire. Cela correspond, en particulier, à la véritable apparition des glaciations dans l’Antarctique. Il semble qu’il y ait une relation entre le volcanisme des « trapps d’Ethiopie » et l’établissement de ce régime froid, glaciaire particulier, dans lequel nous sommes encore (même si ce moment de notre histoire est plutôt une confortable phase interglaciaire qu’une phase glaciaire à proprement parler).
Peu après la mise en place des « trapps d’Ethiopie », une déchirure est venue les traverser. Il y a donc manifestement une relation entre l’arrivée de ces bulles magmatiques à la surface et les grands moments où se déchirent les continents à la surface du globe, où s’ouvrent les bassins océaniques. Ainsi, la naissance des trois grands bassins (nord, central et sud) de l’océan Atlantique correspond-elle à l’apparition de trois points chauds et à la mise en place concomitante de trois grands trapps (Groëland-Nord des îles anglo-irlandaises, côtes est- américaine et marocaine, bassin du Parana en Amérique du Sud et d’Etendeka en Afrique).
Géophysicien, j’applique les méthodes de la physique à l’étude de la Terre pour tenter d’en comprendre la dynamique interne. Je voudrais donc vous entraîner dans un voyage difficile à imaginer : produire des images réalistes de l’intérieur de la Terre, où règnent des températures élevées, des densités fortes, une obscurité totale, n’est pas facile. D’ailleurs, les films qui ont tenté d’évoquer un voyage à l’intérieur de la Terre sont la plupart du temps assez décevants.
Nous allons cependant par la pensée nous enfoncer jusqu’à six mille quatre cent kilomètres sous le sol, jusqu’au centre de la terre.
Le champ magnétique oriente les boussoles à la surface de la Terre. Une petite masselotte empêche l’aiguille de la boussole de piquer du nez : le champ magnétique terrestre tend en effet non seulement à l’orienter vers le nord, mais aussi à la faire plonger – à Paris par exemple de 64° en dessous de l’horizontale. Or il existe une relation mathématique simple entre le plongement du champ magnétique et la latitude où l’on se trouve. C’est cette propriété qui permet de mesurer la dérive des continents. Quand le champ fossilisé par une roche provenant d’Inde est typique de ce qui se passe à 30° de latitude sud, alors qu’aujourd’hui cette roche est à 30° de latitude nord, je déduis que le sous-continent a parcouru 60° de latitude, c’est-à-dire près de sept mille kilomètres de dérive du Sud vers le Nord. Voilà comment on utilise l’aimantation fossilisée dans les roches.
Au milieu des océans arrive en permanence, par les déchirures que l’on appelle les dorsales, de la lave qui se refroidit et qui elle aussi fige la direction du champ magnétique terrestre. Si on déplace au fond des océans un magnétomètre, celui-ci révèle des alternances magnétiques, dans un sens et dans l’autre, qui témoignent que le champ magnétique de la Terre n’a pas toujours pointé vers le Nord. Le champ magnétique de la Terre s’est inversé des centaines de fois au cours de l’histoire de la Terre. La dernière fois, c’était il y a sept cent quatre-vingt milles ans. L’intensité du champ magnétique, depuis l’époque des Romains, s’est affaissée en Europe d’un facteur 2. Certains se demandent si le champ magnétique de la Terre ne va pas s’inverser dans deux milles ans. Or, c’est lui qui nous protège des rayons cosmiques. Est-ce quand le champ s’inverse que les espèces s’éteignent ?
Ces inversions successives sont peintes sur le plancher océanique, il est possible de les dater. Aujourd’hui, le champ s’inverse assez fréquemment, avec quelques inversions par million d’années. Mais, le champ ne s’est pas inversé pendant près de trente millions d’années, au cours du Crétacé.
La variation de la fréquence des inversions est très irrégulière et de longues périodes sans inversion alternent avec des périodes plus instables. Cette alternance semble se répéter au bout de deux cents millions d’années. La dernière période « immobile » a duré de moins de cent vingt à moins quatre-vingt millions d’années ; la précédente de moins trois cent vingt à moins deux cent soixante millions d’années. Il est frappant de voir que deux très gros trapps (Inde et Sibérie) et les deux plus grandes extinctions d’espèce ont suivi de peu ces périodes de grand calme magnétique. Le noyau de la Terre participerait-il au déclenchement de ces gigantesques catastrophes qui conduisent aux extinctions en masse ?
Le noyau de fer liquide de la Terre, qui fabrique le champ magnétique, a sa dynamique propre ; est-il couplé d’une certaine façon, à travers le manteau, avec la surface de la Terre ? Comment un tel couplage est-il possible?
Les sismologues, qui enregistrent en permanence les tremblements à la surface de la Terre et qui utilisent les ondes de ces tremblements de terre pour scruter, comme avec des rayons X, l’intérieur, sont capables de réaliser une tomographie du manteau. Ce manteau n’est pas homogène, comme on le croyait, mais formé de grandes masses un peu informes, plus lourdes et plus froides, qui sont sans doute des morceaux de plaques lithosphériques réinjectées à l’intérieur de la Terre. On savait depuis longtemps que ces plaques pouvaient descendre jusqu’à 700 km de profondeur ; on s’aperçoit qu’elles peuvent en fait parfois plonger jusqu’à
la base du manteau, s’empiler sous forme de véritables cimetières : des cimetières de plaques océaniques à 2900km sous nos pieds. Cette énorme masse froide et lourde vient se poser à la surface du noyau, dans lequel se fabrique le champ magnétique.
La Terre est un objet en train de se refroidir ; sa façon normale de se refroidir, c’est la convection d’ensemble du manteau, qu’accompagne la dérive des continents : la formation de la croûte, le flux de chaleur, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques sont l’expression de ce refroidissement. Apparemment, ce système ne parvient pas ainsi à se débarrasser de la chaleur de manière suffisamment efficace. De temps en temps, un autre mode de convection de la matière conduit à la formation de ces énormes instabilités qui très rapidement vont emmener une part importante de matière et avec elle, une quantité importante de chaleur, jusqu’à la surface.
Le noyau essaie de se débarrasser de sa chaleur et un isolant vient l’en empêcher. Les hétérogénéités du manteau inférieur se réchauffent alors, s’allègent et peuvent de temps en temps devenir instables et remonter. Malheureusement, la sismologie ne nous permet pas encore de voir ces instabilités. La figure 4 représente une coupe de l’intérieur de la Terre. On y voit, à la base du manteau, ces instabilités formées de matériaux légers qui, peut-être, peuvent atteindre la surface, déclencher les éruptions des trapps et provoquer nos fameuses extinctions. Tout le système « Terre » (manteau, descentes de plaques froides, remontées d’instabilités chaudes, volcanisme catastrophique, évolution des espèces biologiques) formerait alors un grand ensemble couplé.
À défaut de pouvoir voir l’intérieur de la Terre, nous sommes capables, aujourd’hui, de le modéliser soit numériquement, sur les ordinateurs, soit dans des expériences analogiques en laboratoire. On mélange ainsi des fluides qui permettent de reproduire, en modèle réduit, ce qui se passe à l’intérieur de la Terre. On observe, sous certaines conditions, qu’un liquide
léger, donc instable, placé à la base d’un liquide dense donne naissance à des instabilités en forme de champignon, avec une tête volumineuse et une tige longue et mince [figure 4].
Si l’on imagine qu’une plaque, l’Inde par exemple, dérive au-dessus d’une telle instabilité, au moment où la bulle arrive en surface, elle va former des « trapps ». Mais, quand la bulle se sera vidée, la plaque qui a dérivé se trouvera au-dessus de la tige du « champignon » qui pourra continuer, comme un chalumeau, à percer sa surface, mais avec un volume et une intensité beaucoup plus faibles. C’est bien ce qu’on observe dans l’Océan Indien [figure 5] : l’Inde, les « trapps du Deccan » en noir, vieux de soixante cinq millions d’années, puis en gris des archipels d’îles qui parfois émergent, parfois sont sous marines, les îles Chagos, Laccadives, Maldives. En allant du nord vers le sud elles sont datées de soixante millions à cinquante-cinq millions d’années, puis quarante-huit, trente-cinq, sept millions d’années à l’île Maurice ; l’île de la Réunion, elle, se forme depuis deux millions d’années. Ces archipels constituent tout simplement la trace de la brûlure laissée par la queue du panache qui, en démarrant, a créé les « trapps du Deccan ». On retrouve donc, à la surface de la Terre, l’histoire d’une ascension qui vient probablement près de trois milles kilomètres de profondeur à l’intérieur du manteau. Partis des observations du terrain pour construire un modèle, nous avons tiré de ce modèle des prédictions que le retour à l’observation valide.
En quoi la connaissance du passé peut-elle servir à une meilleure compréhension des futurs possibles? On enseigne souvent aux jeunes géologues à se servir du présent pour comprendre le passé ; ce guide est utilisé depuis plus de cent cinquante ans. Mais, nous n’avons pas, pendant l’histoire de l’humanité, échantillonné toutes les possibilités de l’histoire de la Terre, sous toutes leurs formes et sous toutes leurs amplitudes. Notre espèce n’existe pas depuis assez longtemps pour que nous soyons certains d’avoir « échantillonné » (ou subi) l’ensemble des phénomènes naturels au maximum de leur intensité. Lors de la dernière grande éruption d’un trapp, il y a trente millions d’années, l’espèce humaine n’existait pas encore. Depuis trente millions d’années la Terre n’a pas connu d’événement d’ampleur semblable. Et nous ne
savons pas quand se produira le prochain, dans quelques millions ou quelques dizaines de millions d’années, bien qu’il soit presque certain. On dit d’autre part que l’espèce humaine est en train de préparer la prochaine grande catastrophe écologique, que peut-être la sixième grande extinction a commencé, que (et peut-être n’est-ce pas depuis seulement le siècle de l’industrie, mais depuis le dernier cycle glaciaire) les hommes, en chassant les grands mammifères, les ont fait disparaître, qu’aujourd’hui, ils font disparaître, de nombreuses espèces avant même qu’on ait eu le temps de les identifier, qu’ ils exploitent trop rapidement la forêt tropicale... Comment modéliser le devenir de notre planète face à ces « agressions » ? Les géologues fournissent les scenarii passés de catastrophes au cours desquelles la nature a engendré des évènements qui, peut-être, sont de la même ampleur que ce que l’homme est en train de faire subir à sa planète. Ils fournissent aussi aux climatologues des moyens de tester leurs modèles, naturellement très incertains, en s’appuyant, de façon rétroprédictive, sur des situations qui se sont réellement produites, à ces quelques moments pendant lesquels l’évolution de la Vie sur Terre a été entièrement et définitivement réorientée par les grands soubresauts des rythmes internes de la planète.
Légendes :
Figure 1 : Affleurement de calcaires au nord de la ville de Gubbio, Ombrie, Italie. Figure 2 : Quartz choqué de Frenchman Valley (Canada, Saskatchewan), microscopie électronique en transmission x 35.000 lumière polarisée analysée.
Figure 3 : Courbe de l’évolution dans le temps du nombre d’espèces marines fossiles. Figure 4 : Coupe schématique de l’intérieur de la Terre.
Figure 5 : Trapps du Deccan.
VIDEO canal U LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
