|
|
|
|
 |
|
Régénération cérébrale : une molécule candidate identifiée, le Syndécan-1 |
|
|
| |
|
| |
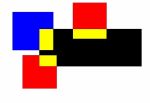
Régénération cérébrale : une molécule candidate identifiée, le Syndécan-1
COMMUNIQUÉ | 05 SEPT. 2018 - 16H58 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Le cerveau adulte a une capacité de régénération très limitée. Cependant, des chercheurs ont mis au jour le rôle d’une molécule membranaire clé dans la prolifération des cellules souches dans le cerveau murin adulte : le Syndécan-1. Une collaboration du CEA, de l’Inserm et des universités Paris-Sud et Paris Diderot a démontré que la molécule Syndécan-1, présente dans la membrane des cellules souches neurales, permet leur prolifération. Le Syndécan-1 devient ainsi un possible traceur de la régénération cérébrale, ouvrant de nouvelles perspectives dans le domaine de la médecine régénérative. Ces travaux, qui font l’objet d’un dépôt de brevet en cours, ont été publiés le 14 août dans Stem Cell Reports.
Le cerveau adulte est doté d’une capacité très réduite à se régénérer. Il renferme un petit nombre de cellules souches neurales dans des niches spécialisées. Ces cellules, qui ont la capacité de produire de nouveaux neurones fonctionnels, sont pour la plupart en dormance mais peuvent être activées en réponse à un stress.
Grâce à une technique innovante de tri cellulaire et à une analyse transcriptomique comparative, les chercheurs de l’Institut de Radiobiologie Cellulaire et Moléculaire (IRCM)[1] ont mis en évidence quelques-unes des modifications moléculaires qui accompagnent l’activation des cellules souches neurales en dormance, en réponse à une exposition du cerveau à des radiations ionisantes. Par cartographie comparative des gènes exprimés, ils ont identifié la molécule membranaire Syndécan-1 comme étant spécifiquement exprimée dans les cellules souches neurales activées.
Par des études fonctionnelles, l’équipe a aussi démontré que cette molécule jouait un rôle direct dans la prolifération de ces cellules.
Connaître les signaux moléculaires qui régulent l’activité des souches neurales présentes dans le cerveau adulte pourrait permettre de stimuler les capacités régénératives du cerveau et avoir de nombreuses applications thérapeutiques. Le Syndécan-1, ainsi que les différentes voies moléculaires identifiées dans ce travail, ouvrent de nouvelles perspectives dans ce domaine de la recherche médicale.
[1] UMR967, Institut François Jacob, CEA Paris Saclay ; Inserm ; Université Paris-Sud / Paris Saclay ; Université Paris Diderot.
POUR CITER CET ARTICLE :
COMMUNIQUÉ – SALLE DE PRESSE INSERM
Régénération cérébrale : une molécule candidate identifiée, le Syndécan-1
LIEN :
https://presse.inserm.fr/regeneration-cerebrale-une-molecule-candidate-identifiee-le-syndecan-1/32367/
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Résistance aux antidépresseurs : des neurones capables de s’autoréguler |
|
|
| |
|
| |

Résistance aux antidépresseurs : des neurones capables de s’autoréguler
COMMUNIQUÉ | 25 JUIL. 2018 - 10H20 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Pourquoi certains patients déprimés présentent-ils une résistance quasi-totale aux antidépresseurs les plus courants ? C’est sur cette question que se sont penchés des chercheurs de l’Inserm et de Sorbonne Université au sein de l’Institut du Fer à Moulin qui ont pu mettre en évidence le rôle majeur des neurones sécréteurs de sérotonine – la cible médicamenteuse privilégiée dans les dépressions – dans la régulation de leur propre activité. En cause, un récepteur à la sérotonine porté par ces neurones dont la déficience pourrait être déterminante dans l’absence de réponse aux antidépresseurs les plus prescrits. Ces travaux, parus dans la revue Neurospychopharmacology ouvrent la voie à une meilleure compréhension de l’implication de la sérotonine dans les maladies psychiatriques.
La sérotonine est un neurotransmetteur – une substance chimique produite par certains neurones pour en activer d’autres – impliqué dans de nombreuses maladies psychiatriques telles que la dépression, l’addiction, l’impulsivité ou la psychose. Elle est sécrétée par des neurones spécifiques appelés neurones sérotoninergiques.
La libération de sérotonine hors de la cellule neuronale permet d’activer des neurones possédant des récepteurs spécifiques à ce neurotransmetteur. Lorsque ces récepteurs détectent une quantité suffisante de sérotonine dans le milieu extracellulaire, ils envoient un message d’activation ou d’inhibition au neurone qui les exprime. Les neurones sérotoninergiques possèdent également plusieurs types de récepteur à la sérotonine, qu’on appelle alors autorécepteurs et qui leur permettent d’autoréguler leur activité.
Des chercheurs de l’Inserm et de Sorbonne Universités/UPMC au sein de l’Institut du Fer à Moulin (Inserm, UPMC), se sont intéressés au rôle d’un des autorécepteurs des neurones sérotoninergiques appelé 5-HT2B, dans la régulation de leur activité, afin de mieux comprendre l’absence d’effet de certains traitements antidépresseurs.
En temps normal, lorsqu’un neurone sérotoninergique sécrète de la sérotonine dans le milieu extracellulaire, il va être capable d’en recapturer une partie qu’il pourra de nouveau relarguer a posteriori. Ce mécanisme assuré par un transporteur spécifique lui permet de réguler la quantité de sérotonine présente dans le milieu extracellulaire. Le transporteur est la cible privilégiée des médicaments antidépresseurs utilisés pour traiter les pathologies psychiatriques impliquant la sérotonine. Ceux-ci sont appelés « inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine » (ISRS) car ils empêchent la recapture par le transporteur. Dans le contexte de la dépression où la sécrétion de la sérotonine est trop réduite, les ISRS permettent donc de conserver une concentration normale de sérotonine dans le milieu extracellulaire.
L’équipe de recherche est partie de l’observation que, chez la souris, lorsque le neurone sérotoninergique ne porte pas d’autorécepteur 5-HT2B, d’une part l’activité des neurones sérotoninergiques est inférieure à la normale et d’autre part les molécules bloquant l’activité du transporteur comme les antidépresseurs ISRS sont sans effet sur la quantité extracellulaire de sérotonine. Les chercheurs ont ainsi montré que pour avoir un effet, ces molécules nécessitaient la présence et une expression normale du récepteur 5-HT2B à la sérotonine.
Ils ont également découvert que lorsqu’un neurone sécrète de la sérotonine, son autorécepteur 5-HT2B détecte la quantité présente dans le milieu extracellulaire et envoie un signal au neurone pour qu’il sécrète d’avantage de sérotonine. Pour éviter une sécrétion excessive de sérotonine, le neurone sérotoninergique possède un régulateur négatif : l’autorécepteur 5-HT1A qui détecte également la quantité de sérotonine extracellulaire et va envoyer un signal d’inhibition de la sécrétion au neurone sérotoninergique. Afin de conserver une activité neuronale normal, 5-HT2B permet de maintenir ainsi un certain niveau d’activité, en agissant comme un autorégulateur positif.
Ces résultats, à confirmer chez l’humain, mettent en évidence un mécanisme d’autorégulation fine des neurones sérotoninergiques avec une balance entre des autorécepteurs activateurs et des autorécepteurs inhibiteurs. Ils constituent une avancée dans l’identification de nouvelles cibles médicamenteuses, dans la compréhension de l’implication de la sérotonine dans certaines pathologies psychiatriques et dans l’appréhension de l’inefficacité de certains traitements antidépresseurs.
DOCUMENT inserm.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Programmer des comportements cellulaires complexes devient possible |
|
|
| |
|
| |

Programmer des comportements cellulaires complexes devient possible
SCIENCE 09.04.2019
La programmation de populations de cellules vivantes permettrait d’effectuer des tâches complexes dans de nombreux domaines de santé : diagnostic, thérapies ou encore ingénierie de tissus et de matériaux. A Montpellier, des chercheurs du Centre de biochimie structurale (CBS) viennent de développer un nouveau type de circuits génétiques qui permet justement de programmer des opérations complexes à l’échelle d’un groupe de bactéries.
Contrôler l’action de cellules à des fins diagnostiques ou thérapeutiques est déjà une réalité. Les scientifiques savent par exemple modifier des lymphocytes T d’un patient pour les "dresser" contre sa tumeur. Mais ce travail est hautement spécifique, applicable à un type de cellules et pour une indication particulière. Une équipe Inserm propose aujourd'hui d’aller beaucoup plus loin dans la biologie synthétique, grâce à un nouveau système de circuits génétiques contrôlables de l’extérieur et permettant de générer des fonctions complexes. Ce système automatisé est à priori utilisable pour tous types d’applications. Un peu à l’image d’un logiciel informatique qui permet d’effectuer des tâches variées selon les souhaits des utilisateurs.
Concrètement, le laboratoire de Biologie synthétique, codirigé par de Jérôme Bonnet au Centre de biochimie structurale de Montpellier*, incorpore dans des bactéries de l’ADN synthétique permettant de reprogrammer leur comportement. Cet ADN porte des séquences indépendantes, sensibles à des signaux extérieurs différents, qui contrôlent l’expression d’enzymes pouvant eux-mêmes activer ou au contraire inhiber certains gènes. Ces séquences sont organisées de façon logique afin d’obtenir des réponses variées en fonction de la combinaison des signaux extérieurs utilisée. "Nous nous sommes inspirés des systèmes électroniques, qui grâce à une combinaison de signaux binaires - 0 et 1 - permettent d’aboutir à des fonctions variées, explique Jérôme Bonnet. En outre, pour démultiplier les possibilités, nous ne demandons pas à une seule cellule d’effectuer un programme complexe : nous divisons le travail entre plusieurs souches bactériennes, chacune effectuant une partie du programme. Nous exploitons ainsi la puissance des bactéries à travailler de manière collective en milieu naturel".
14 populations de bactéries et 65 000 programmes possibles
Pour prouver que cette approche fonctionne, le laboratoire a construit 14 bactéries différentes, chacune capable d'exécuter un "sous-programme" spécifique, dont il est possible de suivre l'exécution grâce à l’utilisation de gènes témoins produisant des protéines fluorescentes. En associant ces souches selon différentes combinaisons, ce sont plus de 65 000 possibilités d’activation ou d’inhibition de gènes qui peuvent être obtenues selon les signaux extérieurs appliqués (à ce stade, les signaux utilisés sont l'administration d'antibiotiques et de sucres).
Une autre caractéristique importante de ce travail est qu'il autorise l’automatisation de ce système pour obtenir la fonction souhaitée. Il repose en effet sur un algorithme qui génère les séquences d’ADN du circuit génétique selon les désidératas du chercheur. "Jusqu'à présent, la plupart des circuits biologiques étaient conçus sur mesure, ce qui rendait leur élaboration lente et réservée à un petit nombre d’initiés. A l’inverse, nos circuits génétiques multicellulaires peuvent être générés de manière automatisée, en fonction des besoins des utilisateurs à partir de l'outil CALIN, disponible en ligne. Notre but est vraiment de démocratiser la bioprogrammation", explique Sarah Guiziou, l’auteure principale de ce travail. "Nous avons créé un système logique garantissant une réponse prévisible. Maintenant les chercheurs peuvent l’utiliser pour des applications particulières".
Le laboratoire montpelliérain entend utiliser ce système pour développer des bactéries à visée thérapeutique. "Le microbiote a un rôle essentiel pour la santé, ajoute la chercheuse. Nous pourrions modifier des bactéries de la flore intestinale pour leur permettre de détecter des marqueurs et activer des processus thérapeutiques afin de lutter par exemple, contre les maladies métaboliques. Autre exemple, des bactéries se logent dans des tumeurs immunodéprimées et y sont à l’abri du système immunitaire. Il serait intéressant de les programmer pour détruire les cellules cancéreuses".
Note :
*unité 1054 Inserm/CNRS/Université de Montpellier, Centre de biochimie structurale, Montpellier
Source : S Guiziou et coll, Hierarchical composition of reliable recombinase logic devices. Nature Communications, édition en ligne du 28 janvier 2019, https://doi.org/10.1038/s41467-019-08391-y
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Les Nanoblades : des navettes pour opérer le génome |
|
|
| |
|
| |

Les Nanoblades : des navettes pour opérer le génome
COMMUNIQUÉ | 27 MARS 2019 - 16H12 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION | IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION, INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE
Pour éditer le génome de façon précise, les chercheurs disposent désormais des « ciseaux génétiques » CRISPR/Cas9, outil très prometteur pour la thérapie génique. Le défi technologique aujourd’hui est d’amener cet outil jusqu’au génome de certaines cellules. Dans cet objectif, une équipe associant l’Inserm, le CNRS, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’École normale supérieure de Lyon au sein du Centre international de recherche en infectiologie (CIRI) ont développé des capsules permettant d’amener CRISPR/Cas9 jusqu’à l’ADN cible : les Nanoblades. Décrites dans Nature Communications, elles ouvrent des perspectives pour la recherche sur l’édition du génome des cellules souches humaines.
Depuis 2012, la communauté scientifique dispose d’une méthode révolutionnaire pour « opérer » le génome de façon précise : le système CRISPR/Cas9. Ces ciseaux moléculaires sont capables de couper l’ADN à un endroit précis dans une grande variété de cellules. Ils offrent par conséquent des perspectives considérables pour la recherche et pour la santé humaine. Cependant, amener ces « ciseaux génétiques » jusqu’à leur cible – notamment le génome de certaines cellules souches – reste un défi technique.
C’est sur cette problématique que travaillent des équipes de recherche de l’Inserm, du CNRS, de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et de l’École normale supérieure de Lyon qui ont développé les Nanoblades[1], des particules qui permettent de délivrer CRISPR/Cas9 dans de nombreuses cellules, y compris des cellules humaines.
Les scientifiques ont eu l’idée d’encapsuler le système CRISPR/Cas9 dans des structures ressemblant beaucoup à des virus et assurer ainsi sa livraison au sein d’une cellule cible, en fusionnant avec la membrane de cette dernière.
Pour concevoir ces Nanoblades, les chercheurs ont exploité les propriétés de la protéine rétrovirale GAG, qui a la capacité de produire des particules virales non infectieuses car dénuées de génome. L’équipe de recherche a fusionné la protéine GAG d’un rétrovirus de souris avec la protéine CAS9 – le ciseau du système CRISPR. Cette nouvelle protéine dite « fusion » fait l’originalité des Nanoblades.
Par conséquent, et à l’inverse des techniques classiquement utilisées pour modifier le génome, les Nanoblades encapsulent un complexe CRISPR/Cas9 immédiatement fonctionnel ; elles ne délivrent donc aucun acide nucléique codant le système CRISPR/Cas9 dans les cellules traitées. « L’action de CRISPR/Cas9 dans les cellules est ainsi temporaire. Elle est également plus précise et préserve les régions non ciblées du génome, atout particulièrement important dans le cadre d’applications thérapeutiques », précisent les auteurs.
Enfin, les chercheurs ont utilisé une combinaison originale de deux protéines d’enveloppe virales à la surface des Nanoblades pour leur permettre d’entrer dans une large gamme de cellules cibles.
Les scientifiques ont démontré l’efficacité des Nanoblades in vivo, dans l’embryon de souris, pour un large spectre d’applications et dans un large panel de cellules cibles où d’autres méthodes sont peu performantes. « Les Nanoblades s’avèrent notamment efficaces pour corriger le génome des cellules souches humaines, cellules d’un grand intérêt thérapeutique (notamment dans la reconstitution de tissus) mais restant difficiles à manipuler par les méthodes habituelles », précisent les auteurs de ces travaux.
[1] Les Nanoblades ont été testées chez la souris et brevetées en 2016 par Inserm Transfert.
Consultez le portrait d’Emiliano Ricci, chercheur Inserm et dernier auteur de cette étude, en ligne sur le site de l’Inserm
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
