|
|
|
|
 |
|
Des neurones en ébullition pendant le sommeil |
|
|
| |
|
| |
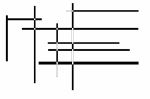
Des neurones en ébullition pendant le sommeil
COMMUNIQUÉ | 27 JUIN 2019 - 11H11 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Une équipe Inserm décrit pour la première fois le comportement et le langage des neurones qui assurent la consolidation de la mémoire pendant le sommeil. Bien loin de l’organisation statique et linéaire supposée, les chercheurs de l’Inserm montrent que le rôle des neurones varie rapidement au cours du temps et que le trajet de l’information change en permanence. Ces travaux sont parus dans Science Advances.
Les cellules du cerveau échangent constamment des informations. Pendant le sommeil, cela sert notamment à consolider la mémoire. Mais la façon dont ces échanges se font reste encore mal connue. L’électroencéphalogramme, qui permet de mesurer l’activité électrique globale du cerveau, montre des ondes régulières plus ou moins rapides selon les phases de sommeil, mais il ne permet pas de savoir comment est traitée l’information à l’échelle du neurone. Voilà qui est fait grâce à l’équipe de Christophe Bernard (Institut de Neuroscience des Systèmes – Inserm U1106). Pour y parvenir, l’équipe a utilisé des électrodes afin d’enregistrer l’activité électrique d’une centaine de neurones concentrés dans une région donnée. Ce sont ces signaux électriques qui portent l’information. Trois zones connues pour être impliquées dans la mémoire ont été enregistrées chez des rats pendant leur sommeil : l’hippocampe, le cortex préfrontal et le cortex entorhinal.
« D’après la régularité des ondes dans l’encéphalogramme, nous imaginions que les neurones fonctionnaient selon un schéma bien précis et répétitif pour transmettre les informations ou les stocker (un peu à la manière d’une machine industrielle bien réglée). Or les enregistrements montrent qu’il n’en est rien », clarifie Christophe Bernard.
Des groupes de neurones s’organisent entre eux pendant des temps très courts pour stocker et transmettre de l’information, et se relaient en permanence au cours du temps. Et au sein de chaque groupe, seuls quelques neurones jouent un rôle prépondérant. « Il y a ainsi une succession de sous-états avec au final, environ la moitié des neurones de ces trois régions qui jouent un rôle clé dans le traitement de l’information à un moment ou à un autre. Autrement dit, il n’y a pas de hiérarchie établie au sein des neurones, mais plutôt une répartition équilibrée des rôles », explique Christophe Bernard.
Une circulation fluide
L’autre découverte majeure est que, pendant un sous-état donné, l’information ne suit pas toujours le même chemin. « Ce fut une surprise car la théorie dominante était que le transfert de l’information suivait un trajet fixe. Or, nous constatons que ce n’est pas le cas. Dans le cerveau, les partenaires avec lesquels un neurone échange fluctuent d’un instant à l’autre. Cela se passe un peu comme sur internet, illustre le chercheur.
Un mail qui part de Paris vers Sydney, passera par des serveurs situés dans différents pays au cours de son acheminement et ces serveurs varieront au cours de la journée en fonction du trafic. Dans le cerveau c’est pareil : même quand l’information est la même, les itinéraires qu’elle emprunte ne sont pas fixes et les partenaires changent sans arrêt ».
Enfin, ces travaux ont permis de décoder le type de langage que les neurones parlent. Si un sous-état correspond à un « mot », la séquence de sous-états constitue une phrase. Même si la signification des mots et des phrases échappe encore aux chercheurs, ces derniers ont pu établir que le langage parlé par les neurones est complexe, ce qui permet d’optimiser le traitement de l’information. Un langage simple contient très peu de mots ; il est facile à apprendre mais il est difficile de convoyer des notions complexes. Un langage chaotique contient un mot pour chaque situation possible, et est impossible à apprendre. Le langage des neurones est complexe, comme pour les langues humaines. A noter que cette complexité est supérieure lors du sommeil paradoxal (celui des rêves) que pendant le sommeil lent.
Les chercheurs vont maintenant regarder ce qu’il en est en cas d’éveil, de réalisation de taches particulières ou encore en cas de pathologies. Ils vont notamment étudier le lien possible entre les pertes mnésiques chez les sujets épileptiques et la complexité du langage neuronal.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Un outil pour prédire le déclin cognitif dans la maladie de Parkinson 10 ans après son apparition |
|
|
| |
|
| |

Un outil pour prédire le déclin cognitif dans la maladie de Parkinson 10 ans après son apparition
COMMUNIQUÉ | 29 JUIN 2017 - 14H21 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Une étude internationale à laquelle ont participé des médecins de l’AP-HP et des chercheurs de l’Inserm, de l’UPMC, et du CNRS au sein de l’ICM s’est penchée sur l’identification d’un score clinico-génétique prédictif du déclin cognitif chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Le déclin cognitif est une des caractéristiques les plus handicapantes qui se manifeste chez certains patients au cours de la maladie de Parkinson. Pouvoir prédire son apparition dix ans après le déclenchement de la maladie représente un intérêt majeur pour la prise en charge et la mise en place d’essais cliniques ciblés pour ces patients.
Cette étude, publiée dans The Lancet Neurology et financée notamment par les NIH, associe des équipes américaines de la Harvard Medical School et de Brigham and women’s hospital (Boston).
Après quelques années de vie avec la maladie de Parkinson, les patients peuvent souffrir de déficits des fonctions cognitives, en plus des troubles du mouvement qui caractérisent la maladie. Dans cette étude, les chercheurs ont construit un algorithme pour identifier les patients les plus sujets au déclin cognitif. Il a été conçu à partir des données cliniques et génétiques issues de 9 cohortes de patients atteints de la maladie de Parkinson en Europe et en Amérique du Nord, soit près de 3200 patients suivis pendant 30 ans, de 1986 à 2016.
En France, la cohorte DIG-PD promue par l’AP-HP et coordonnée par le Pr Jean-Christophe Corvol du Département de Neurologie et responsable du Centre d’Investigation Clinique à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, est issue du projet, appelé « Interaction gène/médicament et maladie de Parkinson – DIG-PD ». La cohorte française a suivi plus de 400 patients annuellement pendant 6 années.
Plusieurs facteurs ont été pris en compte et analysés. L’âge de déclenchement de la maladie, la sévérité motrice et cognitive, le niveau d’éducation, le sexe, la dépression ou encore la mutation du gène de la β-glucocérébrosidase s’avèrent être les prédicteurs les plus importants du déclin cognitif et ont été ajoutés au modèle prédictif développé par les chercheurs. L’étude révèle également que l’éducation aurait un rôle dans la survenue du déclin et que ce facteur serait associé à une « réserve cognitive » dont les patients disposeraient.
A partir de ces données, le score clinique développé par les chercheurs prédit de manière précise et reproductible l’apparition des troubles cognitifs dans les 10 ans qui suivent le déclenchement de la maladie. Il a été mis au point grâce à des analyses génétiques et cliniques issues des 9 cohortes, soit plus de 25 000 données associées analysées.
Cet outil représente un intérêt majeur pour le pronostic du déclin cognitif chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Il pourrait également permettre d’identifier de manière plus précise les patients à haut risque de développer de tels troubles pour leur permettre d’anticiper une prise en charge adaptée ou de participer à des essais cliniques ciblés.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Troubles du spectre de l’autisme: une étude d’imagerie cérébrale inédite semble remettre en cause le modèle théorique dominant. |
|
|
| |
|
| |

Troubles du spectre de l’autisme: une étude d’imagerie cérébrale inédite semble remettre en cause le modèle théorique dominant.
| 13 NOV. 2018 - 16H40 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Dans le cadre du programme scientifique InFoR-Autism*, soutenu par l’Institut Roche, une étude de neuroimagerie IRM s’est intéressée aux liens entre la connectivité anatomique locale et la cognition sociale chez des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme (TSA). Fruits de la collaboration entre la Fondation FondaMental, des chercheurs de l’Inserm, NeuroSpin (CEA Paris-Saclay) et les Hôpitaux universitaires Henri Mondor, AP-HP, les résultats semblent remettre en question le modèle théorique dominant selon lequel les TSA proviendraient d’un déficit de connexions « longue-distance » entre des neurones situés d’un bout à l’autre du cerveau, associé à une augmentation de la connectivité neuronale à « courte distance », entre des zones cérébrales adjacentes. Publiés dans Brain, ces travaux pourraient, s’ils étaient confirmés à plus large échelle, ouvrir la voie à l’exploration de nouvelles approches thérapeutiques.
Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont des troubles du neuro-développement qui se caractérisent par des troubles de la communication, une altération des interactions sociales et des anomalies sensorielles et comportementales. Les travaux menés en génétique et en imagerie cérébrale suggèrent que des anomalies du développement du cerveau, concernant notamment la formation des réseaux neuronaux et le fonctionnement des synapses, pourraient participer à la survenue des TSA.
Ces dernières années, des travaux de neuroimagerie ont mis en évidence, chez des personnes présentant des TSA, des anomalies du fonctionnement de certaines aires cérébrales que l’on sait responsables du traitement des émotions, du langage ou encore des compétences sociales. Des travaux sur la connectivité cérébrale des personnes avec TSA ont notamment mis en évidence un déficit de connexions « longue distance » contrastant avec une augmentation de la connectivité « courte distance ». Ces résultats ont servi de base à l’élaboration d’un modèle théorique de compréhension des TSA, selon lequel le défaut d’attention sociale et de traitement de l’information observé (difficulté à appréhender une situation dans son ensemble, attention portée à certains détails) s’explique par une saturation d’informations traitées par le cerveau, liée à l’augmentation de la connectivité neuronale entre des zones cérébrales adjacentes.
Pour autant, le Pr Josselin Houenou, professeur de psychiatrie à l’UPEC, chercheur au sein de l’Inserm, praticien aux Hôpitaux universitaires Henri Mondor, AP-HP et dernier auteur de l’étude publiée dans Brain, précise : « ce modèle repose sur l’étude de populations pédiatriques hétérogènes, comprenant des enfants autistes d’âges variables et à la symptomatologie très variée, et sur des méthodes de neuroimagerie peu spécifiques ne permettant pas de mesurer avec fiabilité la connectivité ‘’courte distance’’. »
Afin de tester le modèle actuel, les auteurs de cette étude ont utilisé une innovation conçue par Miguel Gevara, Jean-François Mangin et Cyril Poupon à NeuroSpin, à savoir un atlas spécifiquement dédié à l’analyse par tractographie de 63 connexions « courte distance » à partir d’images obtenues par IRM de diffusion (IRMd). L’IRMd permet de mettre en évidence in vivo les faisceaux de matière blanche du cerveau en mesurant la diffusion des molécules d’eau, notamment le long des axones. Il est alors possible par tractographie de reconstituer de proche en proche les trajets des faisceaux de fibres nerveuses représentés sous la forme d’un tractogramme.
Les auteurs ont pu ainsi étudier les liens entre la connectivité « courte distance » et la cognition sociale chez une population adulte homogène de personnes présentant des TSA, issues de la cohorte InFoR-Autism* (27 personnes présentant des TSA sans déficience intellectuelle et 31 personnes contrôle), cohorte offrant l’une des bases de données les plus riches par patient et par témoin.
« La puissance de la cohorte InFoR-Autism* réside dans la grande richesse des données recueillies pour chaque sujet inclus. Nous avons pu ainsi mettre en lien les résultats de neuroimagerie obtenus avec les scores de cognition sociale, mesurant l’habileté sociale, l’empathie, la motivation sociale, etc.) », rappelle le Dr Marc-Antoine d’Albis, Hôpital Henri Mondor, Inserm U955, premier auteur de l’étude.
Découverte d’un déficit de la connectivité cérébrale « courte distance » associé à un déficit d’interaction sociale et d’empathie
Les résultats obtenus montrent que les sujets souffrant de TSA présentent une diminution de la connectivité dans 13 faisceaux « courte distance », en comparaison avec les sujets contrôles. De plus, cette anomalie de la connectivité des faisceaux « courte distance » est corrélée au déficit de deux dimensions de la cognition sociale (à savoir, les interactions sociales et l’empathie) chez les sujets présentant des TSA.
Ces résultats préliminaires sont bel et bien en opposition avec le modèle théorique actuel selon lequel le défaut d’attention sociale et de traitement de l’information chez les personnes présentant des TSA s’explique par une augmentation de la connectivité neuronale entre des zones cérébrales adjacentes. Ils nécessitent maintenant d’être confirmés par des études menées chez des enfants présentant des TSA ainsi que l’explique le Pr Josselin Houenou.
Pour le Pr Josselin Houenou, « ces résultats sont préliminaires mais ils suggèrent que ces anomalies de la connectivité ‘’courte distance’’ pourraient être impliquées dans certains déficits de la cognition sociale présents chez les sujets autistes. Il est maintenant nécessaire de conduire des études similaires chez des enfants afin de confirmer les résultats obtenus chez les adultes. Les cohortes pédiatriques permettent des études chez des enfants d’âges – et donc de maturations cérébrales – variés et cela implique de prendre en compte une population de sujets bien plus importante.
Si ces premières conclusions étaient confortées, cela permettrait d’envisager le développement de nouvelles approches thérapeutiques pour les déficits de la cognition sociale. Par exemple, la stimulation magnétique transcrânienne pourrait être explorée car la connectivité cérébrale entre des zones adjacentes est localisée en superficie du cerveau. »
* InFoR-Autism
La Fondation FondaMental, l’Inserm, Inserm Transfert et l’Institut Roche sont partenaires depuis fin 2012 dans le cadre du programme scientifique InFoR Autism, dont l’objectif est de réaliser un suivi des variables cliniques, biologiques et d’imagerie cérébrale afin d’étudier la stabilité et l’évolution des TSA. Au total, 117 patient·e·s et 57 volontaires sain·e·s, âgé·e·s de 6 à 56 ans, ont été inclus dans l’étude. Il s’agit de l’une des cohortes proposant l’une des bases de données (cliniques, biologiques, eye tracking, et imagerie) les plus riches par patient et témoin.
POUR CITER CET ARTICLE :
SALLE DE PRESSE INSERM
Troubles du spectre de l’autisme: une étude d’imagerie cérébrale inédite semble remettre en cause le modèle théorique dominant.
LIEN :
https://presse.inserm.fr/troubles-du-spectre-de-lautisme-une-etude-dimagerie-cerebrale-inedite-semble-remettre-en-cause-le-modele-theorique-dominant/32971/
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Une nouvelle cible thérapeutique pour traiter les ataxies spinocérébelleuses ? |
|
|
| |
|
| |
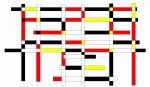
Une nouvelle cible thérapeutique pour traiter les ataxies spinocérébelleuses ?
COMMUNIQUÉ | 25 JUIN 2019 - 15H55 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Les ataxies spinocérébelleuses font partie des maladies génétiques neurodégénératives du cervelet et du tronc cérébral qui entrainent de nombreux troubles moteurs, et dont la forme la plus connue est la SCA3 aussi appelée maladie de Machado-Joseph. Dans ses travaux parus le 14 juin dans Acta Neuropathologica, Nathalie Cartier-Lacave, chercheuse Inserm au sein de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, a découvert avec son équipe le rôle crucial d’une enzyme qui permet d’améliorer les symptômes de la maladie chez la souris.
Certaines maladies neurodégénératives sont dues à une mutation qui entraine la production de protéines malformées et possédant des acides aminés en excès (expansion de polyglutamines). C’est le cas de la maladie de Huntington et de certaines formes d’ataxies spinocérébelleuses.
Dans cette étude, une équipe de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (Inserm/Sorbonne Université/ APHP) dirigée par Nathalie Cartier-Lacave s’est intéressée à un autre groupe de maladies présentant cette production de protéines à expansion de polyglutamines, les ataxies spinocérébelleuses, et plus spécifiquement la SCA3. Dans cette maladie qui touche 1 à 2 personnes sur 100 000, c’est la protéine ataxine 3 qui est mutée et qui s’agrège dans les neurones provoquant leur mort et entrainant ainsi des troubles moteurs. Les chercheurs ont pu montrer qu’apporter une enzyme clé du métabolisme cérébral du cholestérol, CYP46A1, dans les zones atteintes par la maladie, améliorait les symptômes. Cette stratégie pourrait également être efficaces dans les autres ataxies liées à des expansions de polyglutamines.
Pour commencer, les chercheurs ont étudié le métabolisme du cholestérol chez des souris atteintes de SCA3 et mis en évidence un déséquilibre du métabolisme du cholestérol et une diminution de l’enzyme CYP46A1. Ces premiers résultats ont conduit les chercheurs à tester si restaurer l’expression de cette enzyme chez des souris atteintes de SCA3 pouvait être bénéfique. Ils ont réalisé une injection unique d’un vecteur de thérapie génique portant le gène CYP46A1 dans le cervelet de souris SCA3 et ont mis en évidence une diminution de la dégénérescence des neurones de Purkinje du cervelet, une amélioration des troubles moteurs, et la diminution des agrégats d’ataxine 3 par rapport aux souris malades non traitées.
« Ces résultats montrent que CYP46A1 est une cible thérapeutique importante pour restaurer ce métabolisme, diminuer les agrégats de protéines mutées toxiques et ainsi améliorer les symptômes de la maladie », explique Nathalie Cartier-Lacave, directrice de recherche Inserm.
Pour aller plus loin dans la compréhension du phénomène, ils ont mis en évidence que la voie qui permet d’évacuer les protéines malformées ou mutées, la voie de l’autophagie, est perturbée chez des souris SCA3. Cela leur a permis de conclure que les ataxines 3 s’agrègent à cause du dysfonctionnement de cette voie. En revanche, si on arrive à réinstaller un niveau normal de CYP46A1, l’autophagie est restaurée, atténuant ainsi les symptômes de la maladie.
De façon intéressante, les chercheurs ont observé que les agrégats d’ataxine 2 sont également mieux évacués lors de la surexpression de l’enzyme, ouvrant des espoirs thérapeutiques, un seul produit pouvant potentiellement être efficace pour plusieurs pathologies rares sévères.
Un programme européen (Erare) est actuellement en cours coordonné par l’Inserm à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (N. Cartier, A. Durr) pour confirmer ces résultats sur d’autres modèles d’ataxies et évaluer la faisabilité et la tolérance d’une application thérapeutique potentielle chez des patients atteints de ces pathologies génétiques sévères.
POUR CITER CET ARTICLE :
COMMUNIQUÉ – SALLE DE PRESSE INSERM
Une nouvelle cible thérapeutique pour traiter les ataxies spinocérébelleuses ?
LIEN :
https://presse.inserm.fr/une-nouvelle-cible-therapeutique-pour-traiter-les-ataxies-spinocerebelleuses/35420/
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
