|
|
|
|
 |
|
Troubles du spectre de l’autisme: une étude d’imagerie cérébrale inédite semble remettre en cause le modèle théorique dominant. |
|
|
| |
|
| |

Troubles du spectre de l’autisme: une étude d’imagerie cérébrale inédite semble remettre en cause le modèle théorique dominant.
| 13 NOV. 2018 - 16H40 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Dans le cadre du programme scientifique InFoR-Autism*, soutenu par l’Institut Roche, une étude de neuroimagerie IRM s’est intéressée aux liens entre la connectivité anatomique locale et la cognition sociale chez des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme (TSA). Fruits de la collaboration entre la Fondation FondaMental, des chercheurs de l’Inserm, NeuroSpin (CEA Paris-Saclay) et les Hôpitaux universitaires Henri Mondor, AP-HP, les résultats semblent remettre en question le modèle théorique dominant selon lequel les TSA proviendraient d’un déficit de connexions « longue-distance » entre des neurones situés d’un bout à l’autre du cerveau, associé à une augmentation de la connectivité neuronale à « courte distance », entre des zones cérébrales adjacentes. Publiés dans Brain, ces travaux pourraient, s’ils étaient confirmés à plus large échelle, ouvrir la voie à l’exploration de nouvelles approches thérapeutiques.
Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont des troubles du neuro-développement qui se caractérisent par des troubles de la communication, une altération des interactions sociales et des anomalies sensorielles et comportementales. Les travaux menés en génétique et en imagerie cérébrale suggèrent que des anomalies du développement du cerveau, concernant notamment la formation des réseaux neuronaux et le fonctionnement des synapses, pourraient participer à la survenue des TSA.
Ces dernières années, des travaux de neuroimagerie ont mis en évidence, chez des personnes présentant des TSA, des anomalies du fonctionnement de certaines aires cérébrales que l’on sait responsables du traitement des émotions, du langage ou encore des compétences sociales. Des travaux sur la connectivité cérébrale des personnes avec TSA ont notamment mis en évidence un déficit de connexions « longue distance » contrastant avec une augmentation de la connectivité « courte distance ». Ces résultats ont servi de base à l’élaboration d’un modèle théorique de compréhension des TSA, selon lequel le défaut d’attention sociale et de traitement de l’information observé (difficulté à appréhender une situation dans son ensemble, attention portée à certains détails) s’explique par une saturation d’informations traitées par le cerveau, liée à l’augmentation de la connectivité neuronale entre des zones cérébrales adjacentes.
Pour autant, le Pr Josselin Houenou, professeur de psychiatrie à l’UPEC, chercheur au sein de l’Inserm, praticien aux Hôpitaux universitaires Henri Mondor, AP-HP et dernier auteur de l’étude publiée dans Brain, précise : « ce modèle repose sur l’étude de populations pédiatriques hétérogènes, comprenant des enfants autistes d’âges variables et à la symptomatologie très variée, et sur des méthodes de neuroimagerie peu spécifiques ne permettant pas de mesurer avec fiabilité la connectivité ‘’courte distance’’. »
Afin de tester le modèle actuel, les auteurs de cette étude ont utilisé une innovation conçue par Miguel Gevara, Jean-François Mangin et Cyril Poupon à NeuroSpin, à savoir un atlas spécifiquement dédié à l’analyse par tractographie de 63 connexions « courte distance » à partir d’images obtenues par IRM de diffusion (IRMd). L’IRMd permet de mettre en évidence in vivo les faisceaux de matière blanche du cerveau en mesurant la diffusion des molécules d’eau, notamment le long des axones. Il est alors possible par tractographie de reconstituer de proche en proche les trajets des faisceaux de fibres nerveuses représentés sous la forme d’un tractogramme.
Les auteurs ont pu ainsi étudier les liens entre la connectivité « courte distance » et la cognition sociale chez une population adulte homogène de personnes présentant des TSA, issues de la cohorte InFoR-Autism* (27 personnes présentant des TSA sans déficience intellectuelle et 31 personnes contrôle), cohorte offrant l’une des bases de données les plus riches par patient et par témoin.
« La puissance de la cohorte InFoR-Autism* réside dans la grande richesse des données recueillies pour chaque sujet inclus. Nous avons pu ainsi mettre en lien les résultats de neuroimagerie obtenus avec les scores de cognition sociale, mesurant l’habileté sociale, l’empathie, la motivation sociale, etc.) », rappelle le Dr Marc-Antoine d’Albis, Hôpital Henri Mondor, Inserm U955, premier auteur de l’étude.
Découverte d’un déficit de la connectivité cérébrale « courte distance » associé à un déficit d’interaction sociale et d’empathie
Les résultats obtenus montrent que les sujets souffrant de TSA présentent une diminution de la connectivité dans 13 faisceaux « courte distance », en comparaison avec les sujets contrôles. De plus, cette anomalie de la connectivité des faisceaux « courte distance » est corrélée au déficit de deux dimensions de la cognition sociale (à savoir, les interactions sociales et l’empathie) chez les sujets présentant des TSA.
Ces résultats préliminaires sont bel et bien en opposition avec le modèle théorique actuel selon lequel le défaut d’attention sociale et de traitement de l’information chez les personnes présentant des TSA s’explique par une augmentation de la connectivité neuronale entre des zones cérébrales adjacentes. Ils nécessitent maintenant d’être confirmés par des études menées chez des enfants présentant des TSA ainsi que l’explique le Pr Josselin Houenou.
Pour le Pr Josselin Houenou, « ces résultats sont préliminaires mais ils suggèrent que ces anomalies de la connectivité ‘’courte distance’’ pourraient être impliquées dans certains déficits de la cognition sociale présents chez les sujets autistes. Il est maintenant nécessaire de conduire des études similaires chez des enfants afin de confirmer les résultats obtenus chez les adultes. Les cohortes pédiatriques permettent des études chez des enfants d’âges – et donc de maturations cérébrales – variés et cela implique de prendre en compte une population de sujets bien plus importante.
Si ces premières conclusions étaient confortées, cela permettrait d’envisager le développement de nouvelles approches thérapeutiques pour les déficits de la cognition sociale. Par exemple, la stimulation magnétique transcrânienne pourrait être explorée car la connectivité cérébrale entre des zones adjacentes est localisée en superficie du cerveau. »
* InFoR-Autism
La Fondation FondaMental, l’Inserm, Inserm Transfert et l’Institut Roche sont partenaires depuis fin 2012 dans le cadre du programme scientifique InFoR Autism, dont l’objectif est de réaliser un suivi des variables cliniques, biologiques et d’imagerie cérébrale afin d’étudier la stabilité et l’évolution des TSA. Au total, 117 patient·e·s et 57 volontaires sain·e·s, âgé·e·s de 6 à 56 ans, ont été inclus dans l’étude. Il s’agit de l’une des cohortes proposant l’une des bases de données (cliniques, biologiques, eye tracking, et imagerie) les plus riches par patient et témoin.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
DOCUMENT inserm LIEN |
|
|
| |
|
| |

Une protéine essentielle à la réplication du virus chikungunya identifiée
COMMUNIQUÉ | 25 SEPT. 2019 - 19H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION, INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE
Le chikungunya est une maladie infectieuse causée par un virus transmis à l’homme par les moustiques. Ce virus originaire d’Afrique a causé de récentes épidémies en Amérique, Asie, et dans l’Océan Indien, notamment sur l’Île de la Réunion. La maladie se caractérise par une forte fièvre et par des douleurs articulaires et musculaires intenses qui peuvent persister plusieurs mois. Les mécanismes de l’infection des cellules humaines par le virus chikungunya restent très mal compris. Sous la direction d’Ali Amara (Inserm, CNRS, Université de Paris) à l’Institut de Recherche de l’Hôpital Saint-Louis AP-HP, en collaboration avec l’équipe de Marc Lecuit (Institut Pasteur, Inserm, département des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP et Université de Paris), des chercheurs ont identifié une protéine cruciale pour la réplication du virus dans ses cellules cibles. Ces travaux, publiés dans la revue Nature, ouvrent des perspectives thérapeutiques dans la lutte contre le chikungunya.
Originaire d’Afrique, le chikungunya porte bien son nom. Il signifie en langue makondée « l’Homme qui marche courbé », car les douleurs musculaires et articulaires sévères dont souffrent les patients les empêchent de se déplacer normalement et de mener leurs activités quotidiennes.
Si les manifestations cliniques de la maladie sont bien décrites, les mécanismes permettant au virus d’infecter les cellules humaines et de se multiplier sont encore mal compris. Plusieurs travaux avaient déjà identifié certains facteurs des cellules hôtes impliqués dans la réplication du virus. Cependant, aucun n’avait réussi à expliquer pourquoi le virus cible les cellules musculaires et celles des articulations de manière préférentielle, et engendre ces signes cliniques.
Les chercheurs viennent de montrer que la protéine FHL1 est un facteur cellulaire clé pour la réplication et la pathogénèse du virus chikungunya. FHL1 est une molécule présente majoritairement dans les cellules musculaires et les fibroblastes, les cibles privilégiées du virus. En temps normal, FHL1 participe au fonctionnement du muscle sain, et serait détournée de cette fonction par le virus pour assurer sa réplication dans les cellules cibles.
Pour conduire cette étude, l’équipe d’Ali Amara a effectué un criblage systématique du génome de cellules humaines par la technologie dite de CRISPR-Cas9 afin d’identifier les facteurs de l’hôte nécessaires à la réplication virale. Elle a ainsi isolé le gène codant pour la protéine FHL1. L’équipe a ensuite conduit une série d’expériences montrant l’incapacité du virus à infecter des cellules dont l’expression de FHL1 a été abolie.
De plus, les chercheurs ont montré que le virus était incapable de se multiplier dans des cellules issues de patients souffrant d’une pathologie génétique rare, la dystrophie musculaire d’Emery Dreifuss. Chez ces malades, la pathologie musculaire dont ils souffrent résulte de mutations du gène FHL1 responsables de la dégradation de la protéine FHL1. Les chercheurs ont montré que les cellules de ces patients sont résistantes au virus.
Enfin, les chercheurs ont effectué des expériences in vivo chez des souris dont le gène Fhl1 est invalidé. Ils ont montré que ces animaux sont totalement résistants à l’infection et ne développent pas de maladie, alors que le virus se multiplie et induit d’importantes lésions musculaires chez les souris exprimant une protéine FHL1 fonctionnelle. Ces observations démontrent que la protéine FHL1 joue un rôle clé dans la réplication et la pathogénèse du virus chikungunya.
Le rôle précis de FHL1 dans l’infection virale n’est pas encore entièrement compris. Les chercheurs ont découvert que FHL1 interagit avec une protéine virale connue sous le nom de nsP3. C’est en se liant à celle-ci que FHL1 participe à la réplication du virus.
« Nous voulons maintenant comprendre les détails moléculaires de cette interaction. La prochaine étape est de définir pourquoi FHL1 est si spécifique du virus chikungunya, et de déchiffrer au niveau moléculaire son mode d’action. La résolution de la structure moléculaire du complexe FHL1-nsP3 pourrait constituer une avancée majeure dans le développement d’antiviraux bloquant la réplication du virus », soulignent Ali Amara et Laurent Meertens, chercheurs Inserm responsables de l’étude.
A l’heure actuelle, seuls des traitements symptomatiques sont disponibles pour les patients souffrant d’une infection par le virus chikungunya.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Résistance aux antibiotiques |
|
|
| |
|
| |

Résistance aux antibiotiques
Sous titre
Un phénomène massif et préoccupant
Les antibiotiques ont permis de faire considérablement reculer la mortalité associée aux maladies infectieuses au cours du 20e siècle. Hélas, leur utilisation massive et répétée, que ce soit en ville ou à l'hôpital, a conduit à l’apparition de bactéries résistantes à ces médicaments. Qui plus est, les animaux d'élevage ingèrent au moins autant d'antibiotiques que les humains ! Résultat : la résistance bactérienne est devenue un phénomène global et préoccupant. Pour éviter le pire, la communauté internationale, alertée en 2015 par l'OMS, se mobilise. La route est longue...
Dossier réalisé en collaboration avec Jean-Luc Mainardi, unité 1138 Inserm/Sorbonne Université/Université Paris Descartes/Université Paris Diderot, équipe Structures bactériennes impliquées dans la modulation de la résistance aux antibiotiques, Centre de Recherche des Cordeliers, Paris et Marie-Cécile Ploy, unité 1092 Inserm/Université de Limoges, équipe Anti-Infectieux : supports moléculaires des résistances et innovations thérapeutiques, Institut Génomique, environnement, immunité, santé et thérapeutiques, Limoges
Comprendre le phénomène de la résistance aux antibiotiques
Les antibiotiques sont, à l'origine, des molécules naturellement synthétisées par des microorganismes pour lutter contre des bactéries concurrentes de leur environnement. Aujourd’hui, il existe plusieurs familles d’antibiotiques, naturels, semi-synthétiques ou de synthèse, qui s’attaquent spécifiquement à une bactérie ou à un groupe de bactéries. Certains antibiotiques vont agir sur des bactéries comme Escherichia coli dans les voies digestives et urinaires, d’autres sur les pneumocoques ou sur Haemophilus influenzae dans les voies respiratoires, d’autres encore sur les staphylocoques ou les streptocoques présents au niveau de la peau ou de la sphère ORL.
Les antibiotiques sont spécifiques des bactéries
Les antibiotiques ne sont efficaces que sur les bactéries et n’ont aucun effet sur les virus et les champignons. Ils bloquent la croissance des bactéries en inhibant la synthèse de leur paroi, de leur matériel génétique (ADN ou ARN
ARN
Molécule issue de la transcription d'un gène.
), de protéines qui leur sont essentielles, ou encore en bloquant certaines voies de leur métabolisme. Pour cela, ils se fixent sur des cibles spécifiques.
L’antibiorésistance, un phénomène devenu global
L’efficacité remarquable des antibiotiques a motivé leur utilisation massive et répétée en santé humaine et animale (voir encadré). Cela a créé une pression de sélection sur les populations bactériennes, entraînant l'apparition de souches résistantes. En effet, lorsqu'on emploie un antibiotique, seules survivent – et se reproduisent – les bactéries dotées de systèmes de défense contre cette molécule. La mauvaise utilisation des antibiotiques – traitements trop courts, trop longs ou à posologies inadaptées – est également pointée du doigt.
Ponctuelles au départ, ces résistances sont devenues massives et préoccupantes. Certaines souches sont multirésistantes, c’est-à-dire résistantes à plusieurs antibiotiques. D’autres sont même devenues toto-résistantes, c’est-à-dire résistantes à quasiment tous les antibiotiques disponibles. Ce phénomène, encore rare en France mais en augmentation constante, place les médecins dans une impasse thérapeutique : ils ne disposent plus d’aucune solution pour lutter contre l’infection.
Homme, animal, environnement : un seul monde
D’après l’OMS, plus de la moitié des antibiotiques produits dans le monde sont destinés aux animaux. Aux États-Unis, à côté d’une utilisation à visée thérapeutique, les antibiotiques sont aussi utilisés de façon systématique à faibles doses comme facteurs de croissance, une pratique interdite en Europe depuis 2006. Or la surconsommation d’antibiotiques entraîne l’apparition de résistances. Et les bactéries multi-résistantes issues des élevages peuvent se transmettre à l’Homme directement ou via la chaîne alimentaire.
Par ailleurs, hommes et animaux rejettent une partie des antibiotiques absorbés, via leurs déjections. D'où la présence de bactéries résistantes dans les cours d'eau en aval des villes ou des élevages, voire dans les nappes phréatiques.
Hôpital, médecine de ville, pratiques vétérinaires, environnement : tout est désormais lié. C'est pourquoi l'OMS, suivie par les grandes organisations internationales, préconise une vision globale de la lutte contre les antibiorésistances, l’approche One World, One Health (Un monde, une santé).
Pendant longtemps, la majorité des cas de résistance était détectée à l’hôpital. Cependant le phénomène prend de plus en plus d'ampleur en ville, au détour d’antibiothérapies apparemment anodines. Ainsi, à l’occasion d’un banal traitement oral, une espèce bactérienne intestinale peut développer une résistance. L'antibiotique détruit la flore bactérienne associée et laisse le champ libre à la bactérie résistante pour se développer. Ces bactéries résistantes sont ensuite diffusées par voie manuportée, plus ou moins vite selon le niveau d'hygiène de la population.
De la résistance naturelle à la résistance acquise
La résistance aux antibiotiques peut résulter de plusieurs mécanismes :
* production d’une enzyme modifiant ou détruisant l’antibiotique
* modification de la cible de l’antibiotique
* imperméabilisation de la membrane de la bactérie
Certaines bactéries sont naturellement résistantes à des antimicrobiens. Plus préoccupante, la résistance acquise concerne l’apparition d’une résistance à un ou plusieurs antibiotiques chez une bactérie auparavant sensible. Ces résistances peuvent survenir via une mutation génétique affectant le chromosome de la bactérie, ou bien être liées à l’acquisition de matériel génétique étranger (plasmide, transposon) porteur d’un ou plusieurs gènes de résistance en provenance d’une autre bactérie. Les résistances chromosomiques ne concernent en général qu’un antibiotique ou une famille d’antibiotiques. Les résistances plasmidiques peuvent quant à elles concerner plusieurs antibiotiques, voire plusieurs familles d’antibiotiques. Elles représentent le mécanisme de résistance le plus répandu, soit 80% des résistances acquises.
L’antibiorésistance – documentaire pédagogique – 13 min 15 - vidéo extraite de la série Grandes Tueuses (2016)
L’antibiorésistance en chiffres
Certaines résistances posent surtout problème à l’hôpital. Les souches de Staphylococcus aureus résistantes à la méticilline (SARM) sont responsables d’infections diverses, pulmonaires et osseuses, ainsi que de septicémies, en particulier dans les unités plus sensibles (soins intensifs). Toutefois, des mesures spécifiques, notamment d’hygiène, ont permis de réduire ces résistances en France (33% en 2001, 15,7% en 2015).
Acinetobacter baumannii est également redoutée à l’hôpital. La part des infections nosocomiales liées à cette bactérie résistante à l’imipenème est passée de 2 ou 3% en 2008 à 11,1% en 2011. Le phénomène est d’autant plus préoccupant que cette bactérie persiste dans l’environnement et se développe préférentiellement chez des malades immunodéprimés et vulnérables.
Deux phénomènes importants dominent l'actualité des résistances. Tout d'abord l'augmentation continue, aujourd'hui plus encore en ville qu'à l’hôpital, des entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE). Certaines espèces comme Escherichia coli ou Klebsiella pneumoniae sont devenues résistantes aux céphalosporines de troisième génération (C3G), qui constituent les antibiotiques de référence pour traiter ces espèces bactériennes. En 2014, 11% des souches de E. coli et 35% de celles de K. pneumoniae isolées de bactériémies étaient devenues résistantes à ces C3G. Dans les infections urinaires, ces chiffres sont de 7% pour E. coli et 16% pour K. pneumoniae. Les médecins doivent alors utiliser des antibiotiques "de derniers recours" : les carbapénèmes.
Or, et c'est le deuxième phénomène très inquiétant, depuis quelques années apparaissent des souches d'entérobactéries produisant des carbapénémases. Ces enzymes détruisent ces antibiotiques et confèrent ainsi une résistance à la bactérie. Cela peut conduire à des situations d’impasse thérapeutique. Ce phénomène reste relativement peu fréquent en France, ce qui n'est pas le cas dans des pays comme la Grèce, Chypre, l'Afrique du Nord, les États-Unis ou l'Inde.
Pseudomonas aeruginosa, responsable de nombreuses infections nosocomiales, présente ainsi plus de 25% de résistance aux carbapénèmes. Certaines souches toto-résistantes sont notamment retrouvées chez les patients atteints de mucoviscidose ou transplantés pulmonaires.
Résistance aux antibiotiques : le classement de l'OMS
En février 2017, l'OMS a publié une liste de bactéries résistantes représentant une menace à l'échelle mondiale.
A. baumannii, P. aeruginosa et les entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE) représentent ainsi une urgence critique car elles résistent à un grand nombre d'antibiotiques.
Six autres bactéries, dont Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori (ulcères de l’estomac), les salmonelles et Neisseria gonorrhoeae (gonorrhée), représentent une urgence élevée.
Enfin, pour Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (otites) et les Shigella spp. (dysenterie), l'urgence est modérée.
De plus l'agent de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, multirésistant dans certaines parties du monde, fait l'objet d'un programme propre de l'OMS.
La lutte s'organise
Réduire et mieux cibler la consommation d’antibiotiques
Pour préserver le plus longtemps possible l’efficacité des antibiotiques disponibles, il faut réduire leur consommation afin de limiter la pression de sélection sur les bactéries. Les plans de rationalisation des prescriptions et les campagnes de sensibilisation destinées au grand public ont fait baisser la consommation au début de ce siècle mais elle est aujourd'hui repartie à la hausse, en particulier en ville. La France reste parmi les premiers utilisateurs mondiaux.
Dans ce contexte, il est important que les médecins puissent :
* distinguer les infections virales des infections bactériennes car les antibiotiques n'affectent pas les virus. Des tests de dépistage rapide existent pour les angines, maladies très fréquentes, la plupart du temps virales et beaucoup trop souvent associées à la prescription d’antibiotiques. Malheureusement, ces tests restent sous-utilisés en France.
*
* choisir un antibiotique pertinent : en cas d'infection bactérienne, mieux vaut éviter l'utilisation systématique d'antibiotiques précieux (récents ou à large spectre) lorsque d'autres plus courants, ou à spectre plus étroit, suffisent et sont aussi efficaces. Le médecin doit pour cela savoir à quelles molécules réagit la bactérie responsable de la maladie de son patient. Il existe déjà des tests rapides de détection de la résistance à certains antibiotiques. Autre réflexion en cours : les laboratoires de microbiologie pourraient rendre des antibiogrammes "ciblés", testant la sensibilité de la souche à une gamme réduite d'antibiotiques ciblés sur la bactérie isolée chez le patient en fonction de sa pathologie et non, comme aujourd'hui, à la plupart des molécules disponibles. Il s'agit là aussi d'inciter le médecin à choisir un antibiotique courant plutôt que se diriger vers d’autres antibiotiques, comme par exemple des céphalosporines parmi les plus récentes.
*
* adapter la cure aux besoins, en particulier limiter la durée des traitements au strict nécessaire. De plus à l'hôpital, lorsqu'une antibiothérapie probabiliste est prescrite, il faut la réévaluer dans les 48-72 heures avec les résultats du laboratoire. Lorsqu'une antibiothérapie de plus de 7 jours est prescrite, cela doit se faire en accord avec un référent en antibiothérapie. Ce dernier a pour mission de diffuser la politique du bon usage des antibiotiques et son application pratique au sein des établissements de soin, en se reposant sur des recommandations élaborées par les différentes instances.
Bactéries et infections – interview – 5 min - vidéo extraite de la série POM bio à croquer (2014)
Une prise de conscience internationale
En mai 2015, l’OMS, la FAO (Food and Agriculture Organization, l'organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) et l'OIE (Office international des épizooties, devenu l'Organisation mondiale de la santé animale) ont adopté un Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens. Il se décline en cinq axes :
* sensibiliser le personnel de santé et le public
* renforcer la surveillance et la recherche
* prendre des mesures d’assainissement, d’hygiène et de prévention des infections
* optimiser l’usage des antimicrobiens en santé humaine et animale
* soutenir des investissements durables pour la mise au point de nouveaux traitements, diagnostics ou vaccins
Déjà engagée dans la lutte, l'Union européenne a lancé des plans d'action en 2001 et 2011. Le tout dernier, datant de juin 2017, prend en compte la dimension globale du problème et vise à faire du continent une région de pointe. Il comprend, entre autres, une action conjointe, la Joint Action on Antimicrobial Resistance & Healthcare - Associated Infections, coordonnée par l'Inserm. Elle rassemble 44 partenaires institutionnels – ministères de la Santé, instituts de recherche, instituts de santé publique – et vise à passer au concret, en particulier en s'inspirant de ce qui est déjà mis en place dans certains pays.
Pour sa part, la France a décliné le plan européen (annoncé en 2016) via une feuille de route interministérielle de novembre 2016, reprenant les mêmes grandes orientations. En ce qui concerne l'usage vétérinaire des antibiotiques, le plan Ecoantibio (2012-2017) est aujourd'hui remplacé par Ecoantibio2 (2017-2021).
Les enjeux de la recherche
Nouveaux antibiotiques
De nouveaux antibiotiques sont nécessaires pour lutter contre les bactéries multirésistantes. Le marché des antibiotiques étant beaucoup moins rentable que celui de médicaments donnés au long cours, comme par exemple les antihypertenseurs, les firmes pharmaceutiques ont peu investi dans cette recherche. Cependant, quelques nouvelles molécules sont disponibles comme la ceftolozane, une nouvelle céphalosporine associée à un inhibiteur de bêta-lactamases, ou le tazobactam, disponible en France depuis 2016. Son spectre d’activité inclut les EBLSE et le bacille pyocyanique (Pseudomonas aeruginosa) multirésistant.
La piste la plus avancée aujourd'hui consiste à inhiber l’action des bêta-lactamases. Ces enzymes, produites par certaines bactéries, les rendent résistantes aux antibiotiques de la famille des bêta-lactamines (comme les céphalosporines de 3e et de 4e génération). L'avibactam, en particulier, est un inhibiteur de bêta-lactamases n’appartenant pas à la famille des bêta-lactamines, désormais commercialisé en association avec la ceftazidime, une céphalosporine de 3e génération. Cette combinaison est même efficace contre certaines bactéries résistantes aux carbapénèmes. Plusieurs inhibiteurs de la famille chimique de l'avibactam, en association avec d'autres bêta-lactamines, sont en développement et/ou en cours d’évaluation.
Autres voies thérapeutiques
Bactériophages © Inserm / Lydia Lapchine
La phagothérapie reste en développement. Elle consiste à administrer des phages
phages
Virus qui n’infecte que les bactéries.
, des virus infectant et tuant spécifiquement certaines bactéries. Cette spécificité permet d’éliminer les bactéries pathogènes sans affecter les autres, contrairement aux antibiotiques à spectre large. Le développement industriel de cocktails de phages, préparés à l’avance ou "sur-mesure" pour lutter contre une bactérie spécifique, paraît néanmoins complexe.
Par ailleurs, l'administration orale d'antibiotiques présente l'inconvénient de tuer certaines bactéries commensales résidant dans le tube digestif, formant le microbiote. Différentes pistes de protection du microbiote intestinal – administration d'un antibiotique conjointement à du charbon absorbant, ou à une bêta-lactamase agissant dans le côlon – sont à l'étude. De même, la transplantation fécale (pour restaurer un microbiote sain), déjà utilisée en clinique contre les infections répétées à Clostridium difficile, est aujourd'hui évaluée pour lutter contre les entérobactéries productrices de BLSE ou de carbapénémases.
D’autres équipes tentent de développer des thérapies antivirulence : l’objectif n’est plus de tuer la bactérie responsable de l’infection, mais de bloquer les systèmes qui la rendent pathogène pour l’Homme. Des antitoxines (souvent des anticorps
anticorps
Protéine du système immunitaire, capable de reconnaître une autre molécule afin de faciliter son élimination.
monoclonaux) dirigées contre certaines toxines bactériennes sont aujourd'hui en phase expérimentale.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
ÉPILEPSIE |
|
|
| |
|
| |
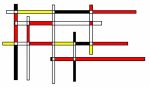
Épilepsie
Sous titre
Un ensemble de maladies complexe, encore mal compris
Une diversité de symptômes et d’évolution : Il n’y a pas une mais des épilepsies. Ensemble, elles constituent la troisième maladie neurologique la plus fréquente, derrière la migraine et les démences. Aux yeux du grand public, l’épilepsie est associée à des crises avec convulsions, absences, rigidité musculaire… Mais chaque syndrome épileptique peut se manifester par une grande variété de symptômes et être accompagné de troubles de l’humeur, de la cognition, du sommeil... Chacun est en outre associé à une évolution qui lui est propre.
Les enjeux de la recherche : La complexité de ces maladies motive une forte dynamique de recherche, aussi bien expérimentale que clinique. Afin d’améliorer les options de traitement, qui restent insatisfaisantes pour près d’un tiers des malades, il est indispensable de trouver de nouvelles approches fondées sur la compréhension fine et exhaustive des mécanismes à l’origine de la maladie, puis de chaque crise.
Dossier réalisé en collaboration avec Stéphanie Baulac, unité 1127 Inserm/CNRS/UPMC, équipe Génétique et physiopathologie des épilepsies familiales, Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière, Paris, Antoine Depaulis et Philippe Kahane, unité 1216 Inserm/Université Grenoble Alpes, équipe Synchronisation et modulation des réseaux nerveux dans l'épilepsie, Grenoble Institut des neurosciences (GIN).
Comprendre l’épilepsie
Bien qu’elle soit reconnue depuis l’Antiquité, l’épilepsie revêt encore beaucoup de mystères. Toutefois, sa compréhension ne cesse d’évoluer. Si dans l’imaginaire collectif elle se limite souvent à des crises épisodiques, elle constitue en réalité une maladie du cerveau englobant différents symptômes, dont les plus spectaculaires sont effectivement ces fameuses crises. Ainsi, les troubles cognitifs ou psychiatriques que l’on considérait auparavant comme des comorbidités
comorbidités
Maladie associée à une pathologie principale.
font désormais partie intégrante de la maladie épileptique. Dans ce contexte, la crise ne constituerait que la partie émergée de l’iceberg, avec parallèlement des conséquences neurobiologiques, cognitives, psychologiques et sociales.
Aujourd’hui, on estime qu’il existe environ une cinquantaine de maladies épileptiques (ou syndromes épileptiques) qui sont définies en fonction de leur âge d’apparition, de leur cause sous-jacente (présumée ou avérée) et de la présentation clinique des crises qui y sont les plus fréquemment associées. Quelques-unes ont une composante génétique certaine, mais la plupart sont d’origine multifactorielle, liées à des composantes héréditaires, lésionnelles et/ou environnementales.
In fine, on ne parle donc plus de l’épilepsie mais des épilepsies, un ensemble de maladies dont les manifestations et l’origine sont très variées. Elles ont cependant toutes un point commun : une excitation synchronisée et anormale d’un groupe de neurones plus ou moins étendu du cortex cérébral, qui peut secondairement se propager à (ou faire dysfonctionner) d’autres zones du cerveau. Il en résulte une activité électrique - de survenue brutale, intense et prolongée - qui engendre les symptômes de la crise (mouvements involontaires, hallucinations auditives ou visuelles, absences…). L’expression de ces symptômes dépend :
* de la/des zones cérébrales dans lesquelles sont situées les neurones impliqués
* du rôle de ces cellules nerveuses dans les systèmes qui gèrent notre motricité, notre cognition, nos émotions ou nos comportements
Ainsi les épilepsies sont des maladies qui affectent des circuits nerveux plus ou moins étendus, pouvant conduire à la modification de leur fonctionnement physiologique.
Des maladies fréquentes qui affectent l’espérance de vie
On estime que 600 000 personnes souffrent d’épilepsie en France. Près de la moitié d’entre elles sont âgées de moins de 20 ans. À l’échelle internationale, l’incidence de la maladie serait de 50 à 100 cas pour 100 000 habitants (selon le niveau de revenu et le système de soins du pays), soit 60 millions de malades.
Globalement, la durée de vie moyenne d’un patient épileptique est légèrement inférieure à celle de la population générale, principalement du fait du risque de décès accidentel au décours d’une crise (noyade, chute, accident). Quant aux morts subites inattendues (Sudden Unexpected Death in Epilepsy), spécifiques de certaines formes d’épilepsie, elles restent rares (30 000 par an dans le monde, 115 en 5 ans en France).
Selon la nature de la maladie épileptique, le pronostic est variable : certaines sont des maladies chroniques qui perdurent tout au long de la vie, certaines sont limitées à la période néonatale ou à l’enfance, d’autres n’apparaissent qu’au cours de la vie adulte, tandis que d’autres encore sont amenées à disparaître à l’âge adulte, une fois la maturation cérébrale accomplie. Enfin, dans certains cas, lorsque la cause initiale de l’épilepsie peut être traitée, la maladie peut être guérie.
De la crise aux manifestations associées
La manifestation la plus typique de l’épilepsie est la crise épileptique, dont on distingue deux types : la crise généralisée et la crise focale. Mais les troubles associés de la cognition, du sommeil ou du langage... font aussi partie du syndrome épileptique. Toutes ces manifestations ont des conséquences délétères sur le bien-être, l’insertion scolaire et socioprofessionnelle, la vie quotidienne et la qualité de vie des personnes malades.
Les crises généralisées
Elles sont liées à l’excitation et à la synchronisation de neurones issus d’emblée de plusieurs zones réparties dans les deux hémisphères cérébraux. Elles associent une perte de conscience transitoire (absence de quelques secondes à quelques minutes) à des signes moteurs toniques (contractions musculaires), myocloniques (secousses musculaires), tonicocloniques (associant les deux) ou atoniques (sans tonus musculaire).
Les crises que l’on a longtemps appelées "grand mal" ou "petit mal" constituent les formes les plus connues de crises généralisées. La première, la plus impressionnante, correspond à une crise motrice touchant l’ensemble de la musculature squelettique (raidissement brutal puis secousses), associée à une perte de conscience et à des manifestations végétatives (respiratoires, urinaires...). La seconde, désormais appelée "absence", se caractérise par une rupture brutale de la conscience, parfois accompagnée de légères contractions musculaires des membres ou des paupières, ou encore d’une chute du tonus musculaire.
Les crises focales (ou partielles)
Selon la région cérébrale impliquée, elles engendrent différentes manifestations cliniques : une décharge au niveau du cortex moteur peut par exemple engendrer un raidissement ou des secousses des doigts, selon les neurones incriminés, et peut (ou non) se propager au bras puis au reste du corps. De la même façon, la crise épileptique peut engendrer des fourmillements dans un membre, des hallucinations auditives ou des hallucinations visuelles selon que la décharge électrique touche une région corticale sensitive, auditive ou visuelle...
Pour résumer, les symptômes d’une crise épileptique focale sont innombrables et aussi variés que des troubles du langage, des manifestations de déjà-vu ou déjà-vécu, des signes émotionnels (peur, rire, extase...), des douleurs, des signes végétatifs (salivation, apnée, tachycardie
tachycardie
Rythme cardiaque trop rapide.
...) des gestes automatiques ou des comportements moteurs étranges et souvent explosifs. Une perte de conscience (ou du contact avec l’extérieur) est aussi souvent observée.
L’hyperexcitation de la crise focale peut se propager et, ainsi, engendrer une crise secondairement généralisée.
Les autres manifestations de l’épilepsie
Troubles cognitifs (troubles de la mémoire, du langage, de l’attention…), troubles de l’humeur (dont la dépression) ou troubles du comportement… : les autres manifestations de l’épilepsie sont nombreuses. Lorsqu’elles surviennent durant l’enfance et l’adolescence, période de maturation cérébrale, les crises à répétition peuvent engendrer des troubles neuropsychologiques et neurodéveloppementaux parfois sévères.
Par ailleurs, les crises en tant que telles, par leurs conséquences directes, peuvent entraîner des complications : chutes et risque associé de fractures, de traumatismes voire de décès.
L’épilepsie chez l’enfant
La maladie revêt un certain nombre de spécificités chez l’enfant, qu’elles soient épidémiologiques, étiologiques, cliniques ou thérapeutiques. L'âge auquel débute la maladie détermine souvent le type du syndrome épileptique, dont la gravité varie en fonction de divers facteurs (état de maturation cérébrale, agression cérébrale sous-jacente, prédisposition génétique...).
Ainsi, le syndrome de West (spasmes et troubles du développement psychomoteur) ou le syndrome de Dravet (épilepsie myoclonique sévère) qui apparaissent dès les premiers mois du nourrisson, ou le syndrome de Lennox-Gastaut (absences et crises toniques), qui survient durant les toutes premières années, sont des formes rares mais assez sévères, pouvant être associées à une composante génétique et/ou anatomique (anomalie cérébrale).
À l’inverse, l’épilepsie-absence est une des formes les plus fréquentes de la maladie chez les enfants, dont l’évolution est plus bénigne et qui disparaît souvent à l’adolescence ou chez l’adulte jeune. Elle survient souvent entre 5 et 7 ans, plus particulièrement chez les filles. Cette maladie, qui présente sans doute une composante génétique, est aussi favorisée par les lumières intermittentes ou l’hyperventilation. Elle se manifeste par des absences de quelques dizaines de secondes, dont l’enfant n’a pas mémoire, et s’accompagne de modifications motrices très discrètes (myoclonies, automatismes, diminution du tonus musculaire). Ces crises peuvent se répéter de nombreuses fois au cours d’une même journée.
Enfin, on estime que 2 à 5% des enfants souffrent un jour d’une crise ou de convulsions liée à un épisode fébrile au cours de leurs premières années de vie. Pour la grande majorité d’entre eux, cet épisode n’aura pas d’incidence ultérieure. Cependant, pour quelques-uns, ces premières crises peuvent constituer les prémices d’une épilepsie à venir, en particulier d’une épilepsie mésio-temporale, la forme la plus fréquente d’épilepsie focale de l’adulte.
Une origine polyfactorielle
Des facteurs comme une anomalie métabolique (hypoglycémie, hypocalcémie…), la prise d’un médicament épileptogène (neuroleptiques
neuroleptiques
Médicaments utilisés pour combattre les troubles mentaux.
, certains antidépresseurs, certains antalgiques…) ou l’exposition à un toxique épileptogène (monoxyde de carbone, gaz neurotoxiques…) peuvent expliquer la survenue d’une crise épileptique unique et ponctuelle.
Mais lorsqu’une telle cause accidentelle n’est pas impliquée, il n’est pas toujours facile d’identifier l’origine des épilepsies : la plupart du temps, leur origine est considérée comme polyfactorielle, liée à :
* des facteurs génétiques
* des facteurs environnementaux
* des maladies métaboliques
* des lésions du cerveau (traumatiques, vasculaires, tumorales, malformatives, inflammatoires ou infectieuses)
On parle d’épilepsie cryptogénique lorsque aucune cause évidente n’a pu être identifiée.
L'existence d’une composante génétique dans deux tiers des épilepsies est désormais reconnue, bien qu’elle reste incomplètement élucidée. Certaines formes de la maladie sont clairement associées à la transmission de mutations affectant un gène unique (maladie monogénique) ou à l’apparition d’une mutation de novo, mais la plupart sont probablement d’origine polygénique. Et si certaines mutations ne favorisent que des crises isolées, d’autres inscrivent l’épilepsie dans un tableau clinique plus complexe, associant un retard psychomoteur ou une déficience intellectuelle. Actuellement, plus d’une centaine de gènes impliqués ont déjà été identifiés, et la plupart d’entre eux font l’objet d’une recherche diagnostique en routine.
L’épigénétique joue probablement aussi un rôle dans l’étiologie de la maladie, mais les études qui lui sont dédiées restent encore rares.
À l’échelle du neurone
La crise épileptique correspond à la survenue transitoire de signes et/ou de symptômes dus à une activité neuronale cérébrale intense (hyperexcitabilité) et anormalement synchrone dans les réseaux neuronaux impliqués. L’image la plus parlante serait celle d’un court-circuit troublant le fonctionnement cognitif et/ou le comportement normal du sujet.
La transmission d’information d’un neurone à l’autre se fait habituellement par le cheminement du message nerveux le long de l’axone du premier d’entre eux, via l’activation de différents canaux ioniques. À l’extrémité de l’axone, au niveau de la synapse
synapse
Zone de communication entre deux neurones.
, des échanges d’ions et la libération de neurotransmetteurs
neurotransmetteurs
Petite molécule qui assure la transmission des messages d'un neurone à l'autre, au niveau des synapses.
permettent d’activer différents récepteurs et canaux ioniques localisés sur le second neurone. Une modification de l’activité électrique est alors générée sur ce dernier, conduisant ainsi à la transmission du message nerveux.
L’épilepsie résulterait en partie d’anomalies concernant l’activation des canaux ioniques ou celle des neurotransmetteurs. Ainsi, lors d’une crise, le taux de GABA
GABA
Principal neurotransmetteur inhibiteur.
(un neurotransmetteur inhibiteur) au niveau synaptique est inférieur au taux habituel, tandis que celui du glutamate
glutamate
Neurotransmetteur excitateur le plus répandu dans le système nerveux central.
(excitateur) est anormalement élevé. Pendant longtemps, on a considéré que l’épilepsie était le fruit du déséquilibre entre ces deux neurotransmetteurs. Aujourd’hui, cette seule hypothèse ne suffit plus : d’autres voies cellulaires sont incriminées dans la genèse des crises. C’est notamment le cas dans certaines épilepsies d’origine génétique, pour lesquelles la mutation de gènes codant pour des protéines présentes à la surface des neurones et impliquées dans la transmission nerveuse a été identifiée.
Par ailleurs, l’embrasement électrique (ou kindling) associé aux crises favoriserait la pérennisation de l’épilepsie grâce à l’activation de certains récepteurs à l’acide glutamique (récepteurs NMDA), capables de se réactiver ultérieurement plus facilement, mais également grâce à d’autres modifications structurelles et fonctionnelles qui caractérisent la plasticité neuronale.
Ainsi, réduire les épilepsies à un dysfonctionnement d’un neurotransmetteur ou d’un canal ionique est sans doute simpliste : c’est en général un réseau complexe qui est modifié par la maladie.
L’électroencéphalogramme : examen incontournable
Parce que 10% de la population aura une crise isolée au cours de sa vie, la démarche diagnostique doit permettre de différencier ces évènements d’une véritable maladie épileptique.
La suspicion clinique d’une épilepsie repose sur la survenue d'au moins deux crises non provoquées par un facteur déclenchant et espacées de plus de 24 heures. Une seule crise suffisamment typique et associée à une forte probabilité de récurrence peut parfois suffire à poser l’hypothèse. Plusieurs examens complémentaires permettent ensuite d’écarter d’autres pathologies pouvant provoquer des crises, de poser le diagnostic d’épilepsie, de localiser la région épileptogène et/ou de rechercher et localiser une lésion responsable de l’épilepsie :
* L’examen clinique et un bilan biologique permettent d’écarter la plupart des crises épisodiques liées à un facteur précipitant aigu. Un second bilan biologique, défini selon le bilan clinique et les données de l’EEG et de l’imagerie (cf. ci-dessous) permet de rechercher, par exemple, un désordre métabolique, auto-immun ou génétique.
* L’électroencéphalogramme (EEG) est incontournable, tant pour le diagnostic que pour le suivi la maladie. Il consiste à enregistrer l’activité électrique cérébrale grâce à des électrodes posées sur le scalp durant une vingtaine de minutes. L’aspect, la fréquence et la topographie des anomalies enregistrées en dehors des crises (pointes ou pointes-ondes) aident à caractériser le syndrome épileptique et/ou à localiser la zone cérébrale impliquée. L'EEG standard peut cependant s'avérer normal en dehors des crises. Dans ce cas, il est complété par un enregistrement sur une période plus longue (plusieurs heures) ou après exposition à un facteur favorisant (privation de sommeil…). En cas de doutes sur la nature épileptique des crises, sur le type de crises ou sur leur localisation, des enregistrements d’une semaine à 15 jours sont utilisés. Dans ce cas, un monitorage vidéo est associé à l’EEG afin de corréler les manifestations cliniques et les modifications correspondantes de l’EEG.
* La tomodensitométrie cérébrale (TDM) ou – mieux – l’imagerie par résonance magnétique (IRM) sont les principales méthodes de neuroimagerie utilisées pour éliminer une cause tumorale ou hémorragique, ou pour rechercher une lésion cérébrale épileptogène.
Des traitements essentiellement médicamenteux
Les traitements des épilepsies sont médicamenteux dans la grande majorité des cas. Leur but est de réverser les altérations de la transmission synaptique excitatrice ou inhibitrice et de limiter la propagation des crises. Grâce à ces traitements, la maladie peut être contrôlée (absence de crises) dans 60 à 70% des cas.
Ils agissent à différents niveaux : blocage des canaux synaptiques sodium, potassium ou calcium, inhibition de certains acides aminés excitateurs, stimulation d’autres molécules ayant un effet inhibiteur comme le GABA. Parmi les plus fréquemment utilisés, le phénobarbital, le valproate de sodium, la carbamazépine, l'oxcarbazépine, la lamotrigine, le lacosamide, le topiramate, le zonisamide… Toutes ces molécules ont un profil d’efficacité qui diffère selon le type de syndrome épileptique. Le choix est donc établi selon le diagnostic syndromique, mais aussi en fonction de l'âge, du sexe, de l'existence d'éventuelles comorbidités associées, tout en tenant compte du profil de tolérance de la molécule.
En cas de pharmacorésistance, la chirurgie peut être envisagée à condition que la zone responsable des crises (zone épileptogène), soit focale, unique et suffisamment à distance de régions hautement fonctionnelles (impliquées dans le langage, la motricité...). Dans ce cas, des examens approfondis sont conduits pour évaluer le rapport bénéfice/risque d’une telle opération. Lorsqu’elle est dite curative, l'intervention consiste à enlever (chirurgie de résection) ou à détruire (Gamma-Knife, ablation laser, thermocoagulation) la zone épileptogène. En pratique, ceci n’est envisageable que chez une minorité de patients souffrant d’épilepsie partielle pharmacorésistante.
Pour les autres, des approches dites palliatives, faisant notamment appel à des méthodes de neurostimulation, sont développées depuis une trentaine d’années. L’objective est alors de diminuer la fréquence des crises. Schématiquement, ces approches consistent à agir directement sur le réseau neuronal responsable des crises, ou à en moduler l'excitabilité à distance. Plusieurs techniques sont aujourd’hui proposées : non invasives (stimulation magnétique transcrânnienne, stimulation transcutanée du nerf trijumeau), semi-invasives (stimulation du nerf vague
nerf vague
Nerf reliant le cerveau à divers organes pour assurer la régulation des fonctions autonomes de l'organisme, comme la digestion, la respiration ou la fonction cardiaque.
) ou invasives (stimulation du noyau antérieur du thalamus, stimulation corticale en boucle fermée). Leur utilisation varie en fonction de la problématique soulevée par chaque patient.
Les enjeux de la recherche
Continuer à décrypter...
... l’origine génétique de la maladie
Facilitées par l’avènement du séquençage haut débit, les avancées dans ce domaine sont particulièrement importantes depuis une quinzaine d’années. Identifier l’origine génétique d’une épilepsie permet de stopper les recherches d’une étiologie non génétique, d’identifier les mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans les manifestations cliniques et dans la maladie, de développer des modèles animaux pour tester de futurs traitements et de proposer un conseil génétique, voire un dépistage génétique prénatal, aux parents qui ont déjà eu un enfant souffrant d’une forme sévère.
Ces cinq dernières années, le séquençage de l’exome de parents et de leurs enfants malades a permis d’identifier de nombreuses mutations dites de novo, impliquées dans des formes sévères d’épilepsie, telles que les encéphalopathies épileptiques. La plupart de ces mutations touchent des gènes codant pour des sous-unités de canaux ioniques ou de récepteurs aux neurotransmetteurs (gène SCN1A, HCN1, KCNQ2…)
Un gène impliqué dans différentes formes d’épilepsie focale
Beaucoup d’épilepsies focales (frontale, temporale, à foyer variable…) sont secondaires à une lésion cérébrale ou à une malformation du développement cortical. Mais il semble de plus en plus évident que certaines sont également liées à des facteurs génétiques parfois uniques (monogéniques). Si des mutations familiales ont pu être identifiées, l’équipe Génétique et physiopathologie des épilepsies familiales de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM – unité Inserm 1127) a montré que certaines sont somatiques, c’est-à-dire acquises au cours du développement, uniquement par les cellules composant le tissu cérébral. En étudiant les différentes formes d’épilepsies focales, l’équipe a identifié des mutations touchant le gène DEPDC5, qui est impliqué dans la voie de signalisation cellulaire
signalisation cellulaire
Ensemble de mécanismes de communication qui régissent le fonctionnement et l’activité des cellules.
mTOR. Cette découverte ouvre potentiellement la voie vers de nouvelles approches thérapeutiques : la voie mTOR constitue en effet déjà la cible de plusieurs médicaments développés en cancérologie, comme l’évérolimus et ses dérivés.
Pour en savoir plus sur ces travaux
... la naissance et la récurrence des crises
Si elle constitue un phénomène cérébral normal face à certaines agressions, ou pour assurer l’apprentissage au cours du sommeil, la synchronisation des neurones est anormalement efficace et prolongée dans l’épilepsie : aussi, la recherche se consacre activement à élucider les mécanismes de l’épileptogenèse, qui aboutit à la formation d’un réseau neuronal propice à la manifestation d’une crise initiale puis à ses récidives. Un autre pan de la recherche vise à décrypter les fondements de l’ictogenèse, le mécanisme déclenchant la crise.
Les données actuelles permettent de penser que l’installation du terrain épileptique est progressive et favorisée par la plasticité cérébrale
plasticité cérébrale
Mécanismes au cours desquels le cerveau est capable de se modifier en réorganisant les connexions et les réseaux neuronaux, dans la phase embryonnaire du développement ou lors d’apprentissage.
importante au cours du développement. Une fois structuré, ce réseau neuronal dysfonctionnel déclencherait les premières crises visibles et resterait ensuite relativement stable dans le temps.
Un modèle animal de l’épilepsie-absence
Les modèles animaux sont indispensables pour avancer dans la compréhension des épilepsies : ils peuvent mimer des épilepsies d’origine lésionnelle, ou des épilepsies pour lesquelles les modifications morphologiques ou fonctionnelles sont idiopathiques
idiopathiques
Qui existe par soi-même, indépendamment d’une autre maladie.
ou d’origine génétique.
À l’Institut des neurosciences de Grenoble (GIN – unité Inserm 1216), l’équipe Synchronisation et modulation des réseaux neuronaux épileptiques a développé un modèle animal permettant d’étudier les mécanismes neurobiologiques de l’épilepsie-absence (anciennement "petit mal"). Il s’agit de la plus fréquente des épilepsies de l’enfant, qui se caractérise par des absences très stéréotypées de plusieurs secondes, associées à des pointes-ondes typiques lors d’un enregistrement l’EEG. La lignée des rats GAERS (Genetic Absence Epilepsie Rats from Strasbourg) a été développée en sélectionnant des lignées de rats naturellement épileptiques, qui présentent le même type d’anomalies comportementales et EEG que l’humain.
Ces travaux ont permis de suggérer que l’épileptogenèse reposerait sur un mécanisme progressif, s’établissant à bas bruit durant plusieurs années avant la crise inaugurale et le diagnostic proprement dit. En effet, des anomalies EEG cliniquement non visibles sont mises en évidence précocement chez le raton GAERS dès 15 jours après la naissance. Elles évoluent et se structurent au cours des semaines suivantes pour aboutir aux premiers symptômes typiques vers l’âge de 30 jours.
On pense également désormais que la maladie ne repose pas uniquement sur le dysfonctionnement des neurones : les cellules gliales, qui les entourent et participent à leur maturation, alimentation et synchronisation, pourraient jouer un rôle. Les astrocytes
astrocytes
Cellule gliale en forme d’étoile qui assure le support et la protection des neurones.
semblent en particulier dysfonctionner dans certains modèles animaux. Une inflammation locale pourrait notamment en modifier le fonctionnement.
Pour avancer sur cette voie, les modèles animaux sont indispensables : ils peuvent mimer des épilepsies d’origine lésionnelle, ou des épilepsies pour lesquelles les modifications morphologiques ou fonctionnelles sont idiopathiques ou d’origine génétique.
Dans le cerveau en développement
Habituellement, au cours du développement, les neurones réorganisent les connexions qu’ils créent entre eux pour n’en privilégier que quelques-unes. Des chercheurs de l’Institut de neurobiologie de la Méditerranée (Inmed - unité Inserm 1249, équipe Bases moléculaires et physiopathologie des malformations du cortex cérébral) ont observé que ce tri n’est pas réalisé chez les patients épileptiques. En conséquence, ces derniers garderaient des réseaux de communication très développés, propices à la synchronisation des neurones. Plus récemment, dans un modèle animal d’épilepsies infantiles sévères transmissibles, ils ont décrit un retard de migration et de maturation des cellules neuronales au cours du développement cérébral in utero, lié à la présence d’une mutation du gène TBC1D24.
… le lien entre crises et symptômes associés
Il semble aujourd’hui établi qu’une relation bidirectionnelle existe entre l’épilepsie et les troubles associés aux crises (cognition, humeur, sommeil…), suggérant l’existence de mécanismes neurobiologiques communs. Des anomalies structurelles, fonctionnelles et neuropathologiques similaires ont ainsi été identifiées chez les sujets souffrant d’épilepsie et ceux sujets à d’autres troubles. Il pourrait aussi exister une composante génétique, certaines familles présentant par exemple des antécédents de dépression et d’épilepsie plus fréquents que la population générale. Enfin, il est probable que, conjointement à ces mécanismes communs, des bouleversements neuronaux secondaires aux crises initient ou amplifient les troubles associés.
Une mutation associée à plusieurs troubles
En cherchant à comprendre les liens entre certaines épilepsies pédiatriques, les encéphalopathies épileptiques, et les troubles cognitifs et comportementaux qui leur sont associés (déficience intellectuelle, trouble du langage…), des chercheurs de l’Inmed (équipe Épilepsies et encéphalopathies néonatales, du nourrisson et de l’enfance) ont identifié une mutation commune : elle affecte le gène GRIN2A, qui code pour les récepteurs NMDA régissant la communication interneuronale.
Épilepsie et dépression
Des chercheurs de l’Institut de neurosciences des systèmes (INS - unité Inserm 1106, Marseille) ont développé un modèle animal d’épilepsie du lobe temporal
lobe temporal
Région latérale inférieure du cerveau qui se trouve au niveau des tempes.
, une forme de la maladie associée à une dépression dans 30% des cas chez l’humain. Dans ce modèle, les animaux qui présentaient un faible taux de BDNF (un facteur de croissance
facteur de croissance
Molécule qui favorise ou inhibe la multiplication des cellules.
du cerveau) avant la première crise étaient ensuite plus vulnérables face à la dépression. Rétablir le taux de BDNF initial, pharmacologiquement ou en limitant la survenue d’antécédents de stress intense, permettrait d’éviter le développement de ce trouble de l’humeur.
Trouver de nouveaux traitements
Si 60 à 70% des patients répondent favorablement aux médicaments, la recherche thérapeutique est encore nécessaire. En effet, la mise à disposition de molécules plus efficaces ou présentant moins d’effets secondaires (fatigabilité, somnolence, tremblement, troubles cognitifs ou de l’humeur, prise ou perte de poids…) permettrait d’améliorer le contrôle de la maladie et la qualité de vie des malades. Par ailleurs, ceux qui répondent peu ou pas aux traitements médicamenteux ont besoin de solutions alternatives.
Ainsi, de nombreux essais cliniques sont aujourd’hui conduits soit avec des molécules déjà utilisées dans d’autres maladies neurologiques (évérolimus, fenfluramine, nalutozan...), soit avec de nouvelles molécules ciblant les mécanismes d’action des antiépileptiques actuels (selurampanel, CPP115, cenobamate, ganaxolone...). Mais l’important effort de compréhension des mécanismes neurobiologiques de la maladie a aussi permis l’émergence d’une nouvelle génération de traitements expérimentaux visant à interagir avec des cibles thérapeutiques inédites (huperzine A, cannabidiol, tonabersat, 2-deoxyglucose, pitolisant...).
De nouvelles approches galéniques, permettant de délivrer les médicaments au site même du foyer épileptogène (nanoparticules, nanotechnologies), améliorant ainsi la balance bénéfice-risque des médicaments antiépileptiques, sont également en développement.
Enfin, l’identification de marqueurs prédictifs des crises et la compréhension des mécanismes de résistance aux traitements (pharmacogénétique) permettront d’optimiser les stratégies de prévention et de prise en charge des crises.
Un cerveau virtuel pour décrypter l’épilepsie
Des chercheurs de l’Institut de neurosciences des systèmes (INS, Marseille) ont participé au développement d’un modèle in silico de cerveau virtuel, permettant de reconstituer le cerveau d’une personne atteinte d’épilepsie.
Ce modèle de base peut être implémenté par les informations propres au patient, pour mimer les spécificités de ses crises (initiation, propagation). Cet outil, capable de reconstruire en imagerie 3D dynamique les régions du cerveau, leurs connexions et l’activité électrique, génère des crises similaires aux crises réelles du patient. Il pourrait aider à évaluer de nouvelles stratégies thérapeutiques.
En savoir plus
D’autres approches, moins conventionnelles, pourraient en outre bouleverser l’offre thérapeutique dans l’épilepsie à moyen terme, comme la thérapie génique, l’optogénétique (qui consiste à intégrer des protéines naturellement sensibles à la lumière dans les neurones pour en contrôler l’activité), l’implantation de capteurs permettant de prédire la survenue des crises, ou le développement d’antagonistes (baptisés antagomirs) de certains microARN, ces petits ARN
ARN
Molécule issue de la transcription d'un gène.
non codants circulants dont le rôle a été décrit dans l’épilepsie...
Le traitement chirurgical, aujourd’hui proposé lorsque la région épileptogène est localisée dans une partie du cerveau accessible et opérable sans risque majeur, est aujourd’hui complété par de nombreuses approches de stimulation électrique cérébrale ou périphérique : aux sites d’implantation actuellement confirmés pourraient s’ajouter certaines approches ciblant notamment le cervelet ou l’hippocampe.
Des rayons X contre les crises
L’équipe Synchronisation et modulation des réseaux neuronaux épileptiques (GIN, Grenoble) s’intéresse également à l’utilisation de rayons X générés par synchrotron
synchrotron
Grand instrument électromagnétique destiné à l’accélération à haute énergie de particules élémentaires.
dans le traitement des épilepsies : l’équipement européen ultra-puissant basé à Grenoble est capable de délivrer des microfaisceaux de quelques dizaines de microns qui restent bien tolérés par le tissu nerveux. Ainsi, l’irradiation sous plusieurs angles de la région corticale génératrice de crises chez le rat GAERS (modèle génétique d'épilepsie-absence) a permis de supprimer les crises pendant plusieurs mois.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
